Premier livre sur le Goulag, c’est-à-dire le système concentrationnaire soviétique inauguré dès 1918 et qui perdurera en tant que système jusqu’à la fin de l’ère Brejnev. C’est en quelque sorte la « version historique » du monumental « Archipel du Goulag » de Soljenytsine paru en 1974. C’est un peu à mon sens l’équivalent-toutes proportions gardées- du maître-livre de R.HILLBERG sur l’extermination des Juifs d’Europe. Ce grand livre apparaît tout à la fois comme un livre d’Histoire et un mémorial pour les millions de victimes du système communiste soviétique, en l’absence totale- il est important de le souligner- de tout travail officiel de mémoire côté russe comme il y en eut un dès 1945 côté allemand. L’Etat russe actuel, héritier direct de son homologue soviétique ne serait-ce qu’en la personne de son leader, ancien haut responsable du KGB, se positionne implicitement dans une sorte de négationnisme par omission, s’en tenant aux condamnations (au demeurant très limitées comme nous le verrons infra) du XX° Congrès du PCUS en 1956, mais n’ayant jamais envisagé la totalité « ontologique » du totalitarisme communiste soviétique et en particulier de son système concentrationnaire. Notons que l’on utilise jamais ce dernier terme pour qualifier l’univers du Goulag et plus généralement de la terreur systématique des années 1918-1953 sous forme d’exécutions massives, de déportations de populations entières, de famines artificiellement entretenues (cas de l’Ukraine des années 1930) et d’utilisation générale et permanente des « Zeks » (détenus du Goulag) sur les grands chantiers économiques volontaristes de la période stalinienne.
Livre matriochka donc, à l’image des poupées russes, où l’histoire du Goulag contient l’histoire de cette histoire (la mémoire des rescapés) et l’histoire de l’absence d’histoire sous forme d’une analyse, en fin de volume, de l’amnésie volontaire dont « souffre » non seulement la Russie mais une bonne partie de la « conscience » occidentale, sans oublier l’histoire d’une mémoire broyée, en l’occurrence celle des écrivains et poètes, pour la plupart petersbourgeois de l « âge d’argent » (1900-1917), tels Anna AKHMATOVA, Iossip MANDELSTAM, Alexandre BLOCH ou Marina TSVETAIEVA pour ne citer que les principaux. Aussi le livre d’Anne APPLEBAUM, dédié « à ceux qui ont raconté ce qui est arrivé », s’ouvre-t-il sur un extrait de la préface de « REQUIEM » d’Anna Akhmatova :
« Dans les années terribles de la « Iéjovchtchina », j’ai passé dix-sept mois à faire la queue devant les prisons de Léningrad. Un jour, quelqu’un a cru m’y reconnaître. Alors une femme aux lèvres bleuâtres, qui était derrière moi et à qui mon nom ne disait rien, sortit de cette torpeur qui nous était coutumière et me demanda à l’oreille (là-bas, on ne parlait qu’en chuchotant) :
-Et cela, pourriez-vous le décrire ?
Et je répondis :
-Oui, je le peux.
Alors, une espèce de sourire glissa sur ce qui avait été jadis son visage. »
Anna Akhmatova, « En guise de préface »
Requiem, 1935-1940 (trad. Paul Valet).
- Les camps pour « contre-révolutionnaires ».
Pour Victor Likhatchev, une vague répressive dès 1918 et qui se poursuit et « ne fera que s’amplifier jusqu’à la mort de Joseph Staline ». De fait, dès juin 1918, TROTSKI demande qu’un groupe de prisonniers tchèques soit placé dans un « Konstlager », c’est-à-dire un camp de concentration. Au cours de l’été 1918, à la suite du traité de Brest-Litovsk, les camps de prisonniers de guerre furent remis à la Tchéka (police politique léninienne) qui va se charger d’incarcérer les « ennemis » dans des camps « spéciaux ». La terreur rouge prévoit donc pour tous les « contre-révolutionnaires » « l’isolement dans des camps de concentration ». Il y aura 20 puis 107 camps déclarés entre 1919 et 1920. De 1929 à 1953, on passe à 476 ensembles concentrationnaires. La taxinomie est précise administrativement et floue idéologiquement : on parle de KR (contre-révolutionnaires) puis d « ennemis du peuple ». De son côté, Staline n’hésite pas à user des termes de « vermines », « pollution », « ordure »…aux résonances ressortissant d’un autre univers concentrationnaire. Au cours de la Grande Terreur de 1936-1938, on ordonne de réprimer les « anciens koulaks, voleurs et autres éléments anti-soviétiques », assorti d’un quota d’exécutions pour les détenus du Goulag. Dès les débuts de la « révolution », il est clair que Lénine entend se débarrasser physiquement des non bolcheviks : « On pendra le premier menchevik après que nous aurons pendu le dernier socialiste-révolutionnaire ». La répression contre les minorité nationales commence très tôt elle aussi (cf mon article « Camp de concentration ») et A.A l’étudie dans les pages 472 à 476.
Pire, les communistes étrangers, ou les Russes ayant vécu ou combattu à l’étranger sont systématiquement éliminés car considérés comme dangereux, soit parce-qu’il peuvent évoluer vers d’autres formes de socialismes, soit du fait qu’ils ont pu constater de visu la meilleure qualité de vie dans le monde « capitaliste » et devenir « contre-révolutionnaires ». Très cruellement, A.A note que les communistes allemands ont davantage souffert de Staline que d’Hitler !! Sur les 68 dirigeants communistes allemands réfugiés en URSS à partir de 1933, 41 trouvèrent la mort dans les camps ou furent exécutés. Le PC polonais fut particulièrement décimé, sans doute du fait de son patriotisme et environ 5000 communistes polonais seront exécutés au cours du printemps et de l’été 1937.
- Vers un système concentrationnaire.
Le système en tant que tel, c’est-à-dire élevé au rang de régulateur socio-économique et politique au-delà de la simple répression des « ennemis de la révolution », prend naissance en 1920 dans l’archipel des Solovetski sur la mer Blanche. Le « travail forcé comme méthode de rééducation » y débute dès 1926. A cette époque, il semble que la conception très cynique de « rééducation » coexiste avec la prise de conscience de l’usage économique que l’on peut faire des détenus à la veille du premier plan quinquennal. De fait, en novembre 1925, on reconnaît au plus haut niveau la nécessité de « faire un meilleur usage des détenus ». Le bolchevik Piatakov écrit à Dzerjinski (chef de la police politique) : « j’en suis arrivé à la conclusion qu’afin de créer les conditions les plus élémentaires d’une culture du travail, il faudra établir dans certaines régions des colonies de travail obligatoire… ».
Le système prend tout son sens avec la collectivisation forcée entraînant des famines en Ukraine et en Russie méridionale provoquant la mort de 6 à 7 millions de personnes de 1932 à 1934, à ajouter aux 2 millions de koulaks déportés en Sibérie et au Kazakhstan entre 1930 et 1933. Le SLON (camps du nord à destination spéciale) ne reconnaît plus de détenus « privilégiés » mais voit dans tous les détenus des travailleurs en puissance. A partir de 1929-1930, soit au tout début de la collectivisation forcée et de l’industrialisation à outrance, le Goulag devient partie intégrante du système économico-politique… Libéré du goulag, on reste au goulag et on fait partie de la main-d’œuvre forcée aux dires mêmes de IAGODA, chef de l’OGPEOU : « Par toute une série de mesures, tant administratives qu’économiques, nous pourrons forcer les détenus libérés à rester dans le Nord, et ce faisant peupler nos régions périphériques ». De fait, entre 1928 et 1930, le nombre de détenus contrôlés par l’OGPEOU passe de 30 000 à 300 000. C’est la naissance véritable du goulag, à la fois machine répressive et instrument commode d’industrialisation à moindre frais !
- Camps et économie volontariste.
Ce n’est pas le moindre des intérêts du livre de montrer indirectement comment la promotion de l’URSS au rang de troisième puissance mondiale à la veille de la seconde guerre mondiale, fierté de Staline et des communistes mondiaux doit surtout à l’incarcération de millions d’hommes et de femmes transformés en esclaves de l’intérieur, un esclavage cyniquement déguisé en rééducation !
-Le BAMLAG (chemin de fer reliant le lac Baïkal au fleuve Amour) a coûté la vie à quelques 10 000 détenus et le canal de la mer Blanche au moins autant.
-Le camp de VORKOUTA, un des plus grands et des plus rudes, compte 15 000 détenus et une production de charbon de 188 206 tonnes.
On assiste bientôt à une spécialisation économique :
-OUKHTPETCHLAG et OUKHTIJEMLAG : pétrole et charbon.
-OUSTVYMLAG : abattage des arbres.
-VORKOUTA et INTA : mines de charbon.
-SEVJELDORLAG : voies ferrées.
…et pourtant, on reste attaché à la révolution et on vibre à la seule mention du mot camarade ! Voir ici JACQUES ROSSI, « Manuel du Goulag ».
-Parmi les chapitres les plus poignants, celui sur le transport et l’arrivée aux camps pp 203 et suivantes.
4.Bilan et chiffres. (cf la première note en fin de volume).
De 1921 à 1951, 3 777 380 personnes sont reconnues « coupables » de fomenter la contre-révolution par les collèges de l’OGPEOU, les troïkas du MVD, les commissions spéciales de tous les collèges et tribunaux militaires qui avaient massivement infligé des condamnations tout au long des trois décennies. Sur ce nombre, 2 369 220 ont été internées dans des camps, 765 180 exilées et 642 980 exécutées.
Selon les archives, le nombre de morts au Goulag et dans les villages d’exil s’élèverait à 2 749 163, auquel il faut ajouter les 786 998 exécutions politiques de 1934 à 1953.
Tout en notant l’espoir que recelait le XX° Congrès de 1956 et le tournant que les déclarations de Khrouchtchev amorça, A.A dénonce les limites d’un discours tendancieux qui focalise sur les seules victimes de 1937 et 1938 et ne dit rien de la collectivisation, de la famine en Ukraine, des répressions massives en Ukraine occidentale et dans les Etats baltes ou de la déportation des Tchétchènes en particulier, opérations dans lesquelles il avait personnellement trempé. Focalisant sut les 7 679 réhabilitations, il ne dit rien des millions de gens dont il savait qu’ils avaient été arrêtés à tort.
-On lira avec profit, de ce point de vue, les récits des procès des années 1960, celui du poète BRODSKI en 1964 et des écrivains SINIAVSKI et DANIEL en 1966.
A PROPOS DE GORBATCHEV pp 604 et suivantes.
A.A montre bien que G., comme Khrouchtchev, croyait profondément au régime soviétique et qu’il ne fut jamais dans ses intentions de remettre en cause les principes élémentaires du marxisme soviétique ni l’œuvre de Lénine. Son but a toujours été de réformer et de moderniser l’URSS, non pas de la détruire. Même s’il en est arrivé à juger important de dire la vérité sur le passé, au départ, il ne parut pas voir le lien entre le passé et le présent. De fait, nommé secrétaire général du parti en mars 1985, ce n’est qu’en avril 1986, après l’explosion du complexe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine que G. se montra disposé à de véritables changements. On pu lire les écrivains proscrits comme Mandelstam, Akhmatova, Pasternak ou Soljenitsyne. Des rescapés du Goulag devinrent célèbres après la parution de leurs témoignages, comme EVGUENIA GUINZBOURG, LEV RAZGON, VARLAM CHALAMOV dont les « Récits de la Kolyma » (Seuil) sont un des témoignages les plus terribles sur le Goulag et le camp extrême-oriental de la KOLYMA.
Surtout, on a pu voir naître la SOCIETE DU MEMORIAL, initiative d’un groupe de jeunes historiens qui recueillaient depuis des années des témoignages oraux et parmi eux Arseni ROGUINSKI, fondateur de la revue PAMYAT (Mémoire).
En conclusion, A.A. élève l’analyse au niveau de notre rapport à l’Histoire et dénonce les mémoires sélectives incapables d’aboutir à une vision globale du destin de l’Homme et de l’Humanité. « Si nous persistons à oublier la moitié de l’histoire de l’Europe, c’est une partie de ce que nous savons de l’humanité elle-même qui sera déformé ». Surtout, une telle amnésie exclue toute tentative tant soit peu efficace pour lutter contre la récurrence des barbaries. « Chaque grande tragédie du XX° siècle est unique : le Goulag, l’Holocauste, le massacre des Arméniens, le massacre de Nankin, la révolution culturelle, la révolution cambodgienne, les guerres bosniaques, parmi tant d’autres. Chacun de ces événements a eu des origines historiques, philosophiques et culturelles différentes, chacun s’est produit dans des circonstances locales particulières qui ne se reproduiront jamais. Seule notre capacité d’avilir, de détruire et de déshumaniser nos semblables s’est répétée- et se répétera- maintes et maintes fois ; la transformation de nos voisins en « ennemis », la réduction de nos adversaires en poux, vermines ou herbes toxiques, la réinvention de nos victimes sous la forme d’êtres mauvais plus vils et plus insignifiants juste dignes d’être incarcérés, expulsés ou tués ». A son échelle, A.A. prend le contre-pied de l’attitude mémorielle sélective et des lois récurrentes qui en sont issues, soucieuse qu’elle est de hausser son analyse à l’universel. Jusqu’à récemment, les grands génocides du XX° siècle furent niés ou « sélectionnés ». On ne parle pas de génocide pour l’URSS ou pour la Chine parce que, consciemment ou inconsciemment, le « peuple de gauche » ne peut convenir que des hommes de gauche aient pu commettre les mêmes forfaitures que les fascistes. J’ai moi-même douloureusement fait l’expérience de ce phénomène d’amnésie militante entre 1990 et 1995, durant le long conflit des Balkans opposant la Serbie à la Slovénie, puis à la Croatie et à la Bosnie. Nous fûmes peu nombreux à dénoncer le nettoyage ethnique enclenché par Milosevic et il me souvient que lorsque nous sollicitâmes le soutient des universitaires de gauche, ceux-ci, se dissimulant sous la « science » historique, nous rétorquèrent que Milosevic n’était pas fasciste, sous-entendu qu’il ne pouvait commettre les mêmes actes de barbarie qu’Hitler. On connaît la suite… !Dans cette optique, on comprend mieux l’acharnement des historiens de gauche à assurer la diabolisation du seul Hitler, véritable bouc-émissaire ontologique du mal absolu. Or, contrairement à la vision socialiste, il n’existe pas de bons et de méchants, il existe une nature humaine qui transcende les idéologies. C’est la conclusion d’A.A. :
« Plus nous serons capables de comprendre comment les différentes sociétés ont transformé leurs voisins et concitoyens d’hommes en objets, plus nous en saurons sur les circonstances spécifiques qui ont conduit à chaque épisode de torture et de massacre en masse, mieux nous comprendrons la face cachée de notre nature humaine. Ce livre n’a pas été écrit « pour qu’on ne voit plus jamais ça », suivant la formule consacrée. Il a été écrit parce que, très certainement, cela se reproduira. Les philosophies totalitaires ont eu, et continueront d’exercer, un attrait profond sur des millions et des millions de gens. La destruction de l « ennemi objectif » , comme dit un jour Hanna Arendt, reste l’objectif fondamental de nombreuses dictatures. Il nous faut savoir pourquoi- et chaque histoire, chaque mémoire, chaque document de l’histoire du goulag est une pièce du puzzle, un élément de l’explication. Sans cela, nous nous réveillerons un jour pour nous apercevoir que nous ne savons pas qui nous sommes.
QUELQUES POEMES SUR LE THEME DU GOULAG.
Je porte un toast- au layon,
A ceux qui tombent en chemin
A ceux qui sont épuisés
Que l’on force à se traîner.
Aux lèvres bleuies et crevassées
A l’identité des visages
Aux pelisses trouées et givrées,
Aux moufles qu’ils n’ont pas.
Au quart d’eau, à la boîte de conserve
Au scorbut pris dans leurs dents
Aux dents des chiens gras et nourris
Qui les houspillent dès le matin.
Au soleil qui du ciel louche
Sur ce qui se passe à l’entour.
Aux blanches sépultures de neige,
Don charitable de la tourmente.
A la ration de pain gluant
Engloutie en toute hâte
Au ciel pâlot, et trop haut,
A la rivière Aian-Uriah !
VARLAN CHALAMOV .
Staline vu par Ossip Mandelstam.
Nous vivons sans sentir sous nos pieds de pays,
Et l’on ne parle plus que dans un chuchotis,
Si jamais l’on rencontre l’ombre d’un bavard
On parle du Kremlin et du fier montagnard.
Il a les doigts épais et gras comme des vers
Et des mots d’un quintal précis comme des fers.
Quand sa moustache rit, on dirait des cafards,
Ses grosses bottes sont pareilles à des phares.
Les chefs grouillent autour de lui- la nuque frêle.
Lui, parmi ces nabots, se joue de tant de zèle.
L’un siffle, un autre miaule, un autre encore geint-
Lui seul pointe l’index, lui seul tape du poing.
Il forge des chaînes, décret après décret…
Dans les yeux, dans le front, le ventre et le portrait.
De tout supplice, sa lippe se régale.
Le Géorgien a le torse martial.
OSSIP MANDELSTAM.
Ceux qui sont malades, bons à rien,
Trop faibles pour les mines,
Sont rabaissés, relégués
Au camp d’en bas
Pour abattre les arbres de la Kolyma.
Sur le papier,
C’est tout simple.
Mais comment oublier
La chaîne des traîneaux sur la neigne
Et des hommes harnachés,
La poitrine creuse tendue,
Qui tirent les chariots ?
Ils s’arrêtent pour se reposer
Ou vacillent sur les pentes raides…
Leur fardeau dévale
Et à chaque instant
Menace de les emporter.
Qui n’a vu un cheval qui trébuche ?
Mais nous nous avons vu des hommes attelés…
ELENA VLADIMIROVA ; « Kolyma ».






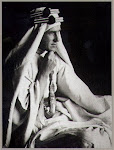
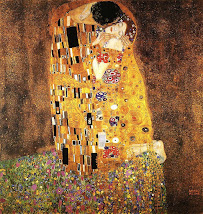


1 commentaire:
J'ai appris des choses interessantes grace a vous, et vous m'avez aide a resoudre un probleme, merci.
- Daniel
Enregistrer un commentaire