1947
Autre plan possible : | « Année terrible » (Michel Winock), « année où le monde a tremblé » (Dominique Desanti), 1947 est présentée comme l’année matrice de la guerre froide. Nous allons étudier comment s’amorça au cours de cette année 1947 l’engrenage de la décolonisation et surtout de la Guerre froide qui ont ensemble structuré la seconde partie du XXe siècle. L’Europe, coincée entre les deux « Grands », détruite par la guerre, vit sa puissance coloniale remise en cause et sa division entérinée par, d’une part, la politique américaine de containment du communisme et, d’autre part, la riposte politique soviétique. |
L’année 1947 dans les relations internationales.
1947 : une année charnière
1. La doctrine Truman
a. Une volonté d'arrêter la progression du communisme
b. La Grèce : première application de la nouvelle volonté américaine
2. Le plan Marshall
a. Un plan autant idéologique qu'économique
b. Le refus soviétique
3. La riposte soviétique
a. La création du Kominform
b. L'action révolutionnaire
Les événements :
Truman expose sa doctrine
Devant le Congrès américain, le président Harry Truman présente sa doctrine dite de "containment" (endiguement). Il propose de mettre en place des aides économiques et financières notamment pour l’Europe afin que ces pays puissent conserver leur indépendance. Visant explicitement les communistes et la main mise de l’URSS sur certains pays de l’Europe centrale, la doctrine Truman affirme que les Etats-Unis doivent être les défenseurs du monde libre face aux tentatives d’asservissement de l’URSS. Il aboutit à la mise en place du plan Marshal. L’URSS répondra par le rapport Jdanov en septembre, fustigeant l’impérialisme américain.
Mouvements indépendentistes à Madagascar
Une insurrection contre la présence française à Madagascar débute dans la nuit. 150 français sont tués. La rébellion indépendantiste inspirée par le Mouvement démocratique de rénovation malgache sera sévèrement réprimée par le France. Cette dernière enverra un corps expéditionnaire de 18 000 hommes pour y mettre fin. La répression entraînera la mort de 1 900 malgaches et 550 européens.
Voir aussi : Soulèvement - Histoire de la Décolonisation - Histoire de Madagascar - Histoire de France - Le 29 Mars - Année 1947
1947
14 avril
Fondation du Rassemblement du Peuple Français
Afin de promouvor ses idées, Charles de Gaulle crée son parti qui n'en est pas un. Le Rassemblement du peuple (RPF) rassemble autour du général de nombreux hommes politiques qui appartiennent en fait à d'autres formations. De surcroît, luttant contre le "régime des partis", de Gaulle ne souhaite pas que son mouvement soit considéré comme tel. Le RPF connaîtra le succès électoral lors des municipales de 1947 mais s'affaiblira pour ne faire qu'un score moyen aux Législatives de 1951. Finalement, de Gaulle quittera la politique en 1953, entamant ainsi sa "traversée du désert".
Une nouvelle Constitution au Japon
Deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon se dote d'une nouvelle Constitution. Approuvée par la Diète et proclamée par l'empereur, elle instaure un régime parlementaire, proche des monarchies constitutionnelles européennes. Elle repose sur 3 principes : la souveraineté nationale, la garantie des droits fondamentaux de l'homme et le pacifisme. Ainsi, par l'article 9, le Japon renonce à la guerre et s'engage à ne plus entretenir d'armée. L'interprétation de cet article est l'objet de nombreuses polémiques.
Voir aussi : Constitution - Empereur - Histoire de l'Etat - Histoire du Japon - Le 3 Mai - Année 1947
1947
5 mai
Exclusion des communistes du gouvernement français
Alors qu’il doit faire face à des grèves et à une vague de contestation face à la guerre d’Indochine, le socialiste Ramadier, alors président du Conseil, décide d’exclure les communistes du gouvernement. Dans un contexte économique encore difficile et en pleine Guerre froide, les grèves s’amplifient et font craindre un soulèvement communiste. Cependant, les tensions s’apaiseront dans les mois suivants.
Le plan Marshall pour reconstruire l'Europe
Le secrétaire d'Etat américain George Catlett Marshall propose un programme d'aide destiné à stimuler la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Mis en place dans le cadre de la doctrine Truman, cette aide est refusée par l’URSS qui fait d’ailleurs pression sur les pays d’Europe centrale pour qu’ils en fassent de même. Par contre, l’aide est très bien accueillie en Europe occidentale qui crée l’Organisation européenne de coopération économique pour se répartir l’aide.
L'Exodus refoulé en Palestine
Les Britanniques, administrateurs de la Palestine depuis la fin de la Première guerre mondiale, arraisonnent le navire "Exodus" dans le port de Haïfa. A son bord 4500 juifs survivants des camps de la mort, partis du port de Sète le 10 juillet et fuyant vers la terre d'Israël. Les Anglais qui interdisent toute immigration juive sur leur protectorat, font ramener de force les passagers en France et en Allemagne à bord de bateaux-prisons. Les affrontements provoqueront la mort de 3 personnes et feront 146 blessés. Quatre mois plus tard l"ONU prendra le décision de créer l'Etat d'Israël.
Voir aussi : Histoire du Sionisme - Histoire d'Israël - Histoire de la Palestine - Histoire du Judaïsme - Histoire du Royaume-Uni - Histoire de la Palestine - Le 18 Juillet - Année 1947
1947
15 août
Indépendance de l'Inde et du Pakistan
La Grande-Bretagne accorde à l'Inde le statut de dominion indépendant associé au Commonwealth. Après deux siècles de colonisation britannique, de très longues négociations et des affrontement religieux, l'ancien empire des Indes est divisé entre la république de l'Inde et celle du Pakistan. De violents affrontement éclateront entre hindous, musulmans et sikhs aux endroits où la frontière est encore à déterminer.
Rapport Jdanov
Répondant à la doctrine Truman qui prône l’endiguement du communisme, Jdanov présente son rapport qui définit la position de l’URSS face aux Etats-Unis. L’impérialisme de ce dernier y est dénoncé avec virulence et Jdanov définit les nouvelles lignes idéologiques des Soviétiques. Les mesures qui suivent sont notamment le durcissement du contrôle des PC occidentaux via le Kominform.
Pacte national
Le Liban adopte le Pacte national qui définit les partages de pouvoir entre les différentes communautés. Les chrétiens maronites obtiennent la présidence de la République tandis que les musulmans sunnites reçoivent la tête du gouvernement et les chiites la direction de l’Assemblée. Cette répartition communautaire est destinée à enrayer les risques de guerre civile et s’accompagne de l’abandon des ambitions panarabes du côté musulman. Quant aux chrétiens, ils doivent renoncer à la protection occidentale. Dans les relations extérieures, arabes et occidentaux seront ménagés. Toutefois, la rigueur et les concessions de ce pacte n’empêcheront pas la guerre civile d’éclater vingt ans plus tard.
Création du Kominform
Après une réunion organisée en Pologne réunissant neuf PC européens, le Kominform est créé. Présenté comme une réformation du Komintern, ce bureau d’information a en réalité des objectifs bien différents d’une Internationale communiste. De fait, il réduit son champ d’action à l’Europe et c’est à cette occasion que le rapport Jdanov est rendu. Son rédacteur critique d’ailleurs les PC français et italiens pour leur participation dans des gouvernements socialistes qui sont invités à rejoindre l’opposition contre les "socialistes de droite". Opérant jusqu’à la mort de Staline, le Komintern aura avant tout pour fonction de vérifier que les communistes européens s’alignent bien sur la politique de Moscou. Ainsi, les Yougoslaves seront bientôt exclus et tous les PC devront chasser les titistes, accusés de déviance idéologique.
Naissance du GATT
Vingt trois pays signent à Genève le General Agreement on Tariffs and Trade (l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Cet accord vise à relancer le commerce international en abaissant les barrières douanières et à éviter ainsi de retomber dans le protectionnisme en vigueur avant la guerre. Reposant sur le principe du libre-échange, le GATT assure l’harmonisation tarifaire et quantitative douanière entre ses membres, bannissant toute discrimination commerciale et favorisant la transparence. Provisoire dans un premier temps, le GATT n’a pas le statut d’organisation internationale. Il sera remplacé, en 1995, par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Voir aussi : Dossier histoire de la Guerre froide : de l'Alliance aux deux blocs - Histoire de l'OMC - Histoire du Gatt - Uruguay Round - Histoire du Commerce - Histoire de la Suisse - Le 30 Octobre - Année 1947
L'ONU scinde la Palestine
L'Assemblée générale de l'ONU réunie à New-York, prend la décision de partager la Palestine en deux Etats: un Etat arabe et un Etat juif. L'administration de Jérusalem relèvera de l'organisation internationale. Le Conseil de la ligue arabe s'oppose à cette décision et très vite les affrontements commencent entre Juifs et Arabes. Le nouvel état d'Israël naîtra le 14 mai 1948. Dès ses premiers jours, il sera envahi par l'Egypte, le Jordanie, l'Irak, la Syrie et le Liban.
Création de FO
Les syndicalistes fondateurs de la tendance Force ouvrière au sein de la CGT décident de quitter la confédération au nom de l'indépendance syndicale. Léon Jouhaux, Robert Bothereau, Albert Bouzanquet, Georges Delamarre et Pierre Neumeyer remettent leur démission en dénonçant la trop étroite dépendance de la CGT avec le parti communiste. La nouvelle confédération prend le nom de l'hebdomadaire crée pour la CGT en 1945, Force Ouvrière. Les dirigeants de F.O désirent préserver leur neutralité vis à vis du gouvernement, du patronat et surtout du parti communiste.
L’année 1956
L’année 1956 ne sonne pas la fin du monde bipolaire né à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Ce n’est pas non plus la fin de la guerre froide. Cette année est une période intermédiaire qui fait passer le monde de la confrontation de deux blocs à la détente. Cette période est placée sous le signe de la coexistence pacifique. Raymond Aron caractérise cette période comme un moment où « la Paix est impossible, la guerre improbable ».
La mort de Staline, la décolonisation de l’Asie provoquent une modification du climat international. Les nouvelles lignes de force qui apparaissent sont liées à l’évolution de la conjoncture politique mondiale.
Ainsi, le relatif réaménagement de la guerre froide entre 1953-1956 va faire de 1956 une année qui prolonge les évolutions antérieures mais qui annonce également l’arrivée d’un nouveau partenaire dans les relations internationales : le Tiers-Monde.
Ainsi, on peut se demander si l’année 1956 est une année charnière ou une année de transition ?
Pour répondre à cette question, nous montrerons d’abord en quoi cette année amorce un nouveau comportement. Dans un second temps, nous mettrons en évidence les divers événements qui ont jalonné cette année puis nous analyserons enfin leurs conséquences.
- L'amorce d'un nouveau comportement
- L'équilibre de la terreur
- De nouvelles équipes dirigeantes
- Les événements majeurs
- En Europe
- Dans le monde
- Qui ont des conséquences
- Sur un plan géopolitique
- Sur un plan politique
Chronologie indicative :
- 31 janvier : Investiture du gouvernement Guy Mollet
- février : XXe congrès du PCUS et rapport Khrouchtchev
- mars : La France reconnaît les indépendances du Maroc et de la Tunisie
- 17/21 juillet : Tito, Nasser, Nehru se rencontrent en Yougoslavie et définissent le "neutralisme positif"
- 26 juillet : Nasser nationalise le canal de Suez
- 22 octobre : L'avion des chefs du FLN est arraisonné par l'armée française
- 23 oct/8 nov : Insurrection hongroise et intervention soviétique
- 29 octobre : Israël attaque l'Egypte
- 31 oct/7nov : Expédition de Suez
- novembre : L'ONU envoie des casques bleus sur la ligne et cessez-le feu entre Israël et l'Egypte.
L'année 1968 dans le monde
Mais entre ces trois images il semble difficile, a priori, de trouver des points communs, tant les problèmes, les conflits qu'elles évoquent paraissent éloignés les uns des autres.
Pourtant on peut tenter de chercher, non pas une explication unique, mais des points de convergence, et surtout essayer de replacer ces événements dans un contexte qui permette de leur donner une logique. Nous sommes alors amenés à replacer toute cette année dans le cadre des rapports Est-Ouest, ceux-ci ont alors tendance à s'apaiser, ce qui permet aux forces de contestation présentes dans chaque bloc de s'exprimer mais qui n'a pourtant pas pour effet d'éviter les conflits périphériques comme la guerre du Viêt-nam, s'ils restent strictement localisés.
Dans chaque bloc aussi, la jeunesse, nombreuse, exprime ses aspirations à de profonds changements, ce faisant elle révèle parfaitement les défauts de chacune des sociétés qu'elle conteste : capitalisme sans âme à l'Ouest, manque de liberté et dictature sur l'esprit à l'Est...
L'année 1968 dans le monde
1. Maintien des conflits périphériques dans un contexte de détente
1. La marche vers la détente
2. Des dissensions à l'intérieur des blocs
3. La persistance des conflits périphériques
2. L'apogée des mouvements contestataires
1. Un mouvement né aux Etats-Unis
2. Mouvement qui s'étend au monde entier, mais surtout à la France
3. La jeunesse écrasée et utilisée à l'Est
3. 1968 : la chronologie :
22 mars
4. Effervescence dans les universités françaises
Un groupe à tendance anarchiste se crée à l’université de Nanterre autour de Daniel Cohn-Bendit. Il s’agit du « Mouvement du 22 mars ». Les étudiants qui le composent réagissent à l’arrestation de camarades lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam. Ils occupent la salle du conseil de la faculté de Lettres. L’occupation dure et les incidents se multiplient si bien que le recteur décidera de fermer la faculté le 2 mai.
5.
10 mai
7.
La révolte des étudiants atteint son point culminant dans la nuit du 10 au 11 mai au cours de laquelle étudiants et CRS s'affrontent dans de véritables combats de rues : voitures incendiées, rues dépavées, vitrines brisées, centaines de blessés. Le pays est stupéfait et l'agitation étudiante, jusque-là isolée, rencontre alors la sympathie d'une grande partie de l'opinion publique. Le 13 mai, les syndicats manifesteront avec les étudiants pour protester contre les brutalités policières et, le 14
8.
27 mai
9. Signature des accords de Grenelle
10.
Les négociations entamées le 25 mai entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, aboutissent aux accords signés au ministère des Affaires sociales, rue de grenelle. Ils prévoient l'augmentation du SMIG (salaire minimum) de 25%, des salaires de 10% et la réduction du temps de travail. Mais ces concessions ne satisfont pas la base ouvrière et la grève continue. C'est l'impasse, la crise sociale de mai 68 débouche alors sur une crise politique. Le 30 mai, De Gaulle annoncera la dissolution de l'Assemblée et reprendra le pays en main.
11.
30 juin
12. Large victoire de l’UDR aux législatives
13.
Suite à la dissolution de l’Assemblée le 30 mai, De Gaulle a formé un nouveau parti : l’Union pour la Défense de la République. Bénéficiant de la lassitude des Français et de l’angoisse du désordre politique, l’UDR obtient une victoire sans appel avec 293 sièges sur 487. Les événements de Mai 68 sont terminés : De Gaulle semble être le grand vainqueur, pourtant il quittera le pouvoir un an plus tard. Quant aux ouvriers, ils ont obtenu des résultats probants lors des accords de Grenelle. Les étudiants, à l’origine du mouvement, peuvent apparaître comme les grands perdants. En réalité, leur action a fait sauter de nombreux verrous et entrer la France dans la voie de la modernisation.
14.
24 août
15. La France devient la 5ème puissance nucléaire
16.
La première bombe H (bombe thermonucléaire ou à hydrogène) française explose à 600 mètres au-dessus de l'atoll de Fangataufa, dans le Pacifique. Sa puissance équivaut à 170 fois celle d'Hiroshima. Les Etats-Unis avaient fait explosé la première bombe H, issue des recherches effectuées à partir de la bombe A, en 1952, suivis de l'URSS en 1953, de la Grande-Bretagne en 1957 et de la Chine en 1967. En 1998, l'Inde et le Pakistan deviendront les sixième et septième puissances nucléaires.
17.
4 avril
18. Assassinat de Martin Luther King
19.
Le pasteur noir de l'église baptiste de Montgomery (Alabama) est assassiné à 38 ans par James Earl Ray à Memphis dans le Tennessee. Engagé dans la lutte contre la ségrégation, il est resté célèbre pour son discours "I Have a Dream" dans lequel il décrit une Amérique où Blancs et Noirs sont unis. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1964.
20.
17 juillet
21. Nouveau coup d’Etat en Irak
22.
Le général Hassan al-Bakr, à la tête des militants baasistes, organise un coup d’État avec la participation de Saddam Hussein. Ce dernier aurait d’ailleurs assiégé le palais présidentiel en char d’assaut. Al-Bakr prend la tête du Conseil du commandement de la révolution (CCR) et Saddam Hussein occupe, avec lui, le sommet de l’État. Dès l’année suivante, il sera d’ailleurs nommé vice-président du CCR, ce qui lui permettra d’asseoir sa domination sur les services de sécurité et sur l’armée.
23.
20 août
24. Les chars soviétiques entrent à Prague
25.
200 000 soldats et 5 000 chars soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie pour écraser le "Printemps de Prague", mouvement en faveur d'une démocratisation de la vie politique. Cette invasion met un terme à la tentative du gouvernement tchécoslovaque de mettre en place un "socialisme à visage humain". Les combats feront 30 morts et plus de 300 blessés. Les réformes libérale du Premier secrétaire Alexander Dubcek seront abrogées et son successeur Gustav Husak assurera la "normalisation" du pays.
26.
17 octobre
27. Le poing des "Black-panters" est levé aux JO de Mexico
28.
Les athlètes américains, Tommie Smith et John Carlos arrivés premier et troisième au 200 mètres, protestent contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis en levant leur poing ganté de noir lors de la remise des médailles. Ce signe est aussi la marque de leur soutien au mouvement politique noir-américain, les Black Panthers. Les champions devront lourdement payer ce geste. Ils seront suspendus et expulsés des Jeux par le Comité Olympique.
Sujet : L’année 1973 dans le monde.
I 1973 : face au condominium américano-soviétique, s’affirment parfois brutalement, les pays du tiers-monde.
Le contexte est celui de la détente entre les deux grands et de l’établissement d’un condominium.
Les Etats-Unis sortent affaiblis du conflit du Vietnam.
Le bloc communiste est divisé entre deux pôles : la Chine et l’URSS. Les E-U exploitent cette faille.
Les pays non-alignés réclament un nouvel ordre économique mondial.
L’émergence de l’OPEP qui utilise l’arme du Pétrole.
La Guerre du Kippour.
II Dans le même temps, les pays industrialisés sont affaiblis par une crise qui est désormais manifeste.
Une crise aux causes multiples.
Le choc pétrolier qui en découle : un élément d’explication de la crise.
La fin de Bretton Woods et les désordres monétaires qui s’en suivent.
La baisse des investissements.
Les manifestations de la crise.
Inflation et ralentissement de la production : la stagflation.
L’augmentation du chômage.






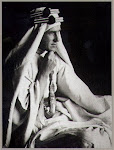
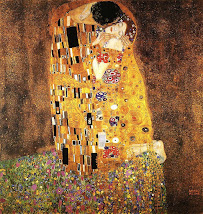


1 commentaire:
Je suis actuellement en hypokhagne, et j'ai une khôlle d'histoire dont le sujet et "L'année 1947". Il faut bien évidemment que je parle de la séparation des deux blocs, provoquant le début de la Guerre froide. Mais je ne sais pas si je dois parler en parallèle de l'affaiblissement de l'Europe dû au bilan de la guerre et au début de la décolonisation. Pourriez-vous m'aider ?
Enregistrer un commentaire