
GEORGES GROSZ, "Metropolis" (1916).
Né en 2009, le ciné-club de l'ISTH entend proposer aux étudiants, outre un aperçu des cinémas du monde, une lecture critique des films dans la perspective de leur utilisation en citations dans les dissertation d'Histoire et de Culture Générale. La section IMAGES DE L'HISTOIRE,HISTOIRE DES IMAGES approfondit cet objectif en couplant Histoire du cinéma et représentation du XX° siècle au cinéma. En effet,comme le rappelle ANTOINE DE BAECQUE dans son livre, "L'Histoire-caméra" (Gallimard, 2008 : "La forme cinématographique est de part en part historique, et le cinéaste, doté de son outil, l'histoire-caméra, un historien privilégié". Cette définition, qui n'est pas sans faire référence à la fameuse "caméra-stylo" du cinéaste soviétique DZIGA VERTOV, pose la question des rapports entre l'Histoire et sa représentation cinématographique, tant au sein des longs-métrages de fiction que dans l'espace des films-documentaires, toujours plus ou moins surdéterminée par une propagande politique.
Notre objectif est triple:
-aider à la compréhension des situations historiques contemporaines par l'analyse de leurs représentations iconiques.
-apprendre à décrypter ces représentations.
-savoir citer à bon escient des films en appui d'un argumentaire académique.
Nous publierons donc ici les notes de synthèse des films projetés dans le cadre de la section "Images de l'Histoire, Histoire des images" au fur et à mesure de leur projection. La programmation suit mon plan de travail en Histoire du XX° siècle et en Culture Générale pour les étudiants de classes préparatoires aux IEP.
OLIVIER MILZA DE CADENET
HISTOIRE DU XX° SIECLE (IEP).
IMAGES DE L’HISTOIRE, HISTOIRE DES IMAGES.
Le cinéma et la I° Guerre mondiale.
AUTOUR DE « LA GRANDE ILLUSION » DE JEAN RENOIR (1937).
Outre ses qualités filmiques (usage de grands panoramiques « à l’américaine » mais aussi de plans rapprochés issus d’une inspiration soviétique- Eisenstein, Medvedkine, Poudovkine, etc., et n’oublions pas l’influence d’origine paternelle de la peinture sur le cinéma du fils), le film de JEAN RENOIR enferme un regard lui aussi panoramique sur les conséquences de la « Grande guerre » , le brassage social qu’elle semblait avoir réalisée et plus largement l’état de la société française de l’entre-deux-guerres (le film est de 1937) une fois révolue la « Belle Epoque !
Quatre hommes, quatre destins sociaux très marqués :
-Rosenthal, le banquier juif, fataliste et cultivé (il parle allemand).
-Maréchal : un « français moyen » pris dans la tourmente d’une guerre qu’il fait mais ne supporte plus. Son antisémitisme est plus réactif qu’idéologique ; il représente en cela parfaitement l’état de l’opinion de l’époque, travaillée depuis 1880 par des discours xénophobes et antijuifs. (Voir HANNAH ARENDT ; « De l’antisémitisme », mais aussi « La France de Vichy » de PAXTON).
-Boïeldieu : l’officier aristocrate, attaché à ses origines, au sens de l’honneur, à un nationalisme presque « naturel ». Il sort tout droit de la « Ligue des patriotes » de Paul Déroulède et s’est sans doute nourri de BARRES et de MAURRAS.
Les deux premiers représentent, sinon l’avenir, du moins le présent. Conscient que son monde est en train de disparaître, Boïeldieu choisit de mourir, non seulement pour permettre l’évasion des deux autres, mais par conviction qu’il représente un passé révolu et eux l’avenir. Notez qu’il aime ses deux camarades, défend même leur honneur d’officier auprès du major-commandant allemand qui en doute. Reste qu’il ne peut vraiment dialoguer qu’avec son homologue, et qui plus est, en anglais.
-L’officier allemand : sanglé dans une culture prussienne, « homme du monde », très aristocrate et très lettré, il représente cet ordre allemand que les prisonniers français envient : « Ca a quand même de l’allure » dit l’un deux, symbolisant cette relation complexe à l’Allemagne, faite de jalousie et de ressentiment, voire d’attraction, et qui explique les postures de nombre d’hommes de l’ultra-droite à partir de 1934.
Un film complexe au regard polysémique :
RENOIR est un réalisateur dont le cœur bat à gauche. Avec JULIEN DUVIVIER et JEAN GREMILLON, il est un des cinéastes attitrés de la « Belle illusion » du Front Populaire de 1936. Je rappelle que cette belle formule de « Belle illusion » a été forgée par l’historien PASCAL ORY comme titre de sa thèse sur la « Politique culturelle du Front populaire ». Il s’agit d’une contraction verbale à partir des titres de deux grands films dits de « Front populaire » : « La Grande illusion » donc et « La belle équipe » de DUVIVIER. Renoir rêve de fraternité sociale, de disparition des classes, de pacifisme, ce pacifisme qui va devenir la posture d’une grande partie de la gauche et d’une fraction de la droite française à partir des années 1930. Elle aboutit à plusieurs aspects du « munichisme » de 1938. Toutefois, le film révèle peu à peu « l’illusion » de cette fusion et le poids des héritages sociologiques sur les hommes. Deux ans après « La grande illusion », Renoir penche définitivement pour une vision pessimiste et cynique dans « La règle du jeu ». Retenez que la vision de la I° Guerre mondiale (1916 ici) va se trouver dans le film et par le film « déplacée » sémantiquement dans l’espace des conflits de l’entre-deux-guerres. Reste que cette « Grande Guerre » se révèle bien la matrice consciente et inconsciente du mal-être « fin de siècle » des contemporains des années 1930. Après 1914, tout change : les femmes se coupent les cheveux et s’habillent comme des hommes. On craint de perdre le « french cancan » avec ses jupons et ses froufrous, ce « french cancan » que les soldats interprètent lors de la scène célèbre de la fête, bientôt interrompue par la reprise du fort de Douaumont par les allemands durant la bataille de Verdun, cadre historique de l’action du film.
On retrouve ici, cinématographiquement, une thématique littéraire où PIERRE DRIEU LA ROCHELLE (« La Comédie de Charleroi ») côtoie ERNST JUNGER (« Orages d’acier ») et STEFAN ZWEIG (« Le monde d’hier, souvenir d’un européen »), sans oublier le CELINE du « Voyage au bout de la nuit » et de « Mort à crédit ». Quant aux thèmes de la « fin d’un monde », voire d’une « décadence », ils sont communs à différentes cultures et, partant, à différentes littératures.
Vous pourrez lire avec profit :
-G.DE LAMPEDUSA ; « Le Guépard » (Italie).
-JOSEPH ROTH ; « La marche de RADETZKI ».
Vous pouvez voir individuellement :
-STANLEY KUBRICK ; « Les sentiers de la gloire », 1957 : bon exemple de « témoignage » mais aussi de « réécriture » du passé au service d’une problématique ultérieure. En pleine Guerre froide, l’Américain S.Kubrick revient sur les mutineries de 1917 dans une vision très sévère pour la France et un regard souvent manichéen sur la société française. Un film superbe au demeurant.
OLIVIER MILZA DE CADENET.
IMAGES DE L’ HISTOIRE, HISTOIRE DES IMAGES.
CINEMA ET TOTALITARISMES : IMAGES DE LA REVOLUTION, REVOLUTION DES IMAGES.
ART ET PROPAGANDE : LE CAS SOVIETIQUE.
« LE CUIRASSE POTEMKINE » (URSS 1925).
( S.M. EISENSTEIN).
« Triomphe de la volonté » de Leni Riefenstahl nous projetait dans l’univers du film de propagande pure, présentant lourdement le discours politique hitlérien, son programme et sa vision globale, comme une sorte de mise en images de « Mein Kampf ». Les emprunts à l’expressionnisme allemand et au cinéma soviétique venaient ici en appui de la mise en image d’une posture idéologique.
« Potemkine » opère un retournement génial des perspectives en partant d’une posture esthétisante pour présenter, presque subliminalement, une interprétation de la révolution. Ce retournement épistémologique que suivront tous les réalisateurs soviétiques « organiques » -DOVJENKO, POUDOVKINE, MEDVEDKINE…- participe à mon sens de deux objectifs :
-Masquer le discours idéologique sous l’apparence d’une universalité artistique : en clair : la beauté tragique des images et le choc esthétique qu’elles provoquent sont censées faire « oublier » le projet politique inhérent au film d’EISENSTEIN : une lecture bolchevique de la Révolution de 1905 à partir d’une commande de l’Etat soviétique en 1925 à l’occasion de l’anniversaire de cette révolution manquée.
-Manipuler le temps historique en imposant précisément une vision léniniste rétroactive des événements de Pétrograd en 1905, lesquels d’ailleurs relèvent déjà à l’époque d’une « lecture » bolchevique à partir du Congrès social-démocrate de 1903 au cours duquel la fraction léniniste du Parti Ouvrier Social-Démocrate russe imposa sa conception de la révolution. A la manipulation du temps s’ajoute ici une « décentration » spatiale par le choix d’un épisode de la révolution de 1905 situé à Odessa en Crimée. La ville des bords de la mer Noire renvoie pourtant davantage à des connotations « bourgeoises » (l’Opéra, les escaliers monumentaux) ou potentiellement contre-révolutionnaires : l’opposition nationale ukrainienne de la « Garde Blanche » immortalisée par NICOLAS BOULGAKOV, ou la communauté juive odessite, décimée par la Révolution de 1917, en particulier le poète ISAAC BABEL (auteur de « Cavalerie Rouge » et des « Contes d’Odessa »), fusillé par le pouvoir stalinien en 1940.
Esthétiser la « geste » révolutionnaire pour la hausser au rang d’une épopée et y glisser à partir de cette prémisse une vision idéologique atténuée par la puissance de scènes « universelles », tel fut le génie d’EISENSTEIN et l’astuce géniale du cinéma de propagande soviétique jusqu’à la fin de l’URSS.
De fait, les meilleurs critiques occidentaux des années 1920-1930, de SIEGFRIED KRACAUER (auteur de l’important « De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand ») en Allemagne à GEORGES CHARENSOL, LEON MOUSSINAC ou GEORGES ALTMANN en France ont décelé très vite dans « Potemkine » un coup de génie…artistique. Selon ALTMANN, le cinéma soviétique était gratifié là de « sa vraie figure, c’est-à-dire « l’expression puissante du groupe, de la collectivité, du mouvement de foule ». A partir de ce succès essentiellement culturel, Potemkine entre au panthéon des chefs-d’œuvre du cinéma mondial. En 1958, lors de l’Exposition universelle de Bruxelles, une centaine d’historiens du cinéma vont jusqu’à le consacrer « meilleur film de tous les temps ». Bien sur, cette consécration ne cautionne pas automatiquement la vision eisensteinienne des événements d’Odessa en 1905. Mais tel n’est pas l’objectif du pouvoir politico-culturel soviétique qui cherche, plus globalement, à imposer une culture communiste dont on sait qu’elle joua un rôle de premier plan dans l’exportation du communisme dans le monde, tout particulièrement en Europe et singulièrement en France au temps de la Guerre Froide. (Voir ici MARC LAZAR, « Le communisme, une passion française » et en particulier les chapitres I, IV et V. Voir la fiche de lecture de cette ouvrage sur mon blog, ainsi que le « Passé d’une illusion » de FRANCOIS FURET.
EISENSTEIN n’a pas caché avoir adopté la « ligne directrice » de la victoire d’octobre 1917 en « matérialisant affectivement toute l’épopée de 1905 » (souligné par nous ). Le télescopage « dialectique » des époques constitue une tendance récurrente de la culture communiste. Les historiens communistes de la Révolution française ( ALBERT SOBOUL en particulier) ou la vision jaurèssienne du même événement ( voir son « Histoire socialiste de la révolution Française » au titre révélateur) auront ainsi tendance à se servir de 1917, ou d’épisodes du combat socialiste pour « lire » 1789 et à considérer inversement 1917 comme l’aboutissement du mouvement ouvrier et des luttes socialistes. Le réalisateur de « Potemkine » n’ignore pas que l’année 1905 avait débouché sur la défaite des mouvements de grève, que ces mouvements eux-mêmes participaient d’une « émotion populaire » globale encadrée davantage par le clergé orthodoxe que les sociaux-démocrates, et que les marins du vrai « Potemkine » avaient achevé leur odyssée dans une débandade funèbre jusqu’au port roumain de Constantza. Mais ce qui comptait pour lui, c’était la valeur générique de l’événement, sa charge esthétique et émotionnelle et que l’espoir révolutionnaire n’avait pas été écrasé.
Plus largement, il s’agit pour EISENSTEIN :
-de se réapproprier –au nom de l’état soviétique commanditaire du film- un mouvement populaire spontané (celui de 1905) alors que le parti bolchevique, Lénine en tête, méprise toute « spontanéité révolutionnaire » censée procéder d’une immaturité originelle du peuple encore privé de « conscience de classe » et de faire de l’échec de 1905 et des échecs pathétiques de soulèvement une épopée toute entière « rachetée » par le triomphe de 1917.
-de montrer, en évacuant la stratégie totalitaire des soviets et le coup d’Etat révolutionnaire d’octobre 1917 (rappelons qu’il est déclenché à la veille du Congrès des Soviets où les amis de Lénine risquent d’être mis en minorité) comment la masse des anonymes peuvent être le « moteur de l’Histoire ».
Esthétisation, désidéologisation, torsions chronologiques, manipulation des faits et manipulation des images : « Potemkine » participe inauguralement de cette utilisation du cinéma aux fins d’une propagande qui, à la différence de celle du cinéma hitlérien, vise à un universel eschatologique et messianique. Le cinéma politique soviétique s’apparente ici davantage à celui des USA (GRIFFITH). La « culture de Guerre Froide » illustrera, dans les années 1950/1960, cette utilisation des media, mais aussi de l’art et du sport au service des « empires ».
OLIVIER MILZA DE CADENET.
IMAGES DE L’HISTOIRE, HISTOIRE DES IMAGES.
CINEMA ET TOTALITARISMES.
Autour de « Privilège » de PETER WATKINS (1967) et de
« Triomphe de la volonté », documentaire de LENI RIEFENSTHAL (1935).
« Privilège » de PETER WATKINS interrogeait en 1967 les ressorts tout à la fois politiques et « intimes » des dérives totalitaires. Il n’est pas indifférent que l’action se déroule dans cette Angleterre des années 1960, soudain happée par la vague contestataire européenne et que le « Big Brother » orwellien prenne l’apparence d’un Etat tenté de manipuler à des fins autoritaires des formes esthétiques nouvelles (ici le rock et le blues) qui ne tarderont pas à uniformiser le goût musical. Rien de plus réversible qu’un style quand il est au service d’un pouvoir, rien de plus ambigu qu’une star et en même temps de plus prévisible. Les « Beatles » comme les « Rolling stones » - contemporains de l’action du « docu-fiction » de Watkins- ont ouvert un espace de transgression, dans le même temps qu’ils ont canalisé vers le festif une contestation du modèle économique libéral mis à mal dans les banlieues désenchantées de Liverpool. Au reste, les Beatles seront décorés de l’Ordre de la Jarretière par la Reine et…rentreront gentiment dans les rangs d’un show-biz normalisé.
Le mérite de « Privilège » réside encore dans l’analyse minutieuse des ressorts intimes de l’adhésion à tout pouvoir charismatique. Jeune fille en larmes tendant les mains vers le sauveur ( la scène de la « flagellation » publique en concert est proprement christique), aspiration de la foule horizontalement atomisée vers un espace soudain vertical, oubli se soi, dépersonnalisation au bénéfice du groupe,etc. Plus largement, WATKINS met en valeur la « starisation » inhérente à tout totalitarisme : Mussolini, Hitler, Staline…apparaissent dans un univers de démultiplication et d’amplification des images ; ils travaillent leurs images à partir d’une étude très fine des motivations conscientes et inconscientes de la « foule » et jouent sur les ressorts de l’inconscient, tant individuel que collectif (K.G.JUNG). Dans la scène du meeting nocturne de « Privilège », on retrouve les retraites aux flambeaux et les clairs-obscurs des défilés nazis, le soin apporté aux drapeaux et emblèmes aisément reconnaissables (symbolique et géométrisation), le réactivation d’une esthétique catholique amplifiée par l’utilisation de la Croix enflammée du Ku-Klux-Klan, l’ordonnancement militaire,etc. Toute entreprise totalitaire fonctionne à partir d’une continuité et d’une rupture : elle apparaît comme un syncrétisme.
C’est pourquoi il est intéressant de regarder ensuite « Triomphe de la Volonté » de LENI RIEFENSTAHL, documentaire de propagande nazie de 1935 commandé à la réalisatrice des « Dieux du stade » (1936) pour « couvrir » le congrès du parti nazi à Nuremberg en 1934. L.R. fait apparaître Hitler depuis le ciel, son avion (image de la modernité industrielle chère aux nazis comme aux communistes staliniens) descendant lentement vers la ville de Nuremberg dont l’historicité médiévale est au passage célébrée par des plans larges et des panoramiques puissants. Hitler et les SA et SS semblent pénétrer cette spatialité ancienne, y succéder avec humilité tout en la dépassant avec audace. A l’espace historique de la ville succède l’espace moderne du stade et l’espace géométrique de la salle du Congrès, trois espaces liés par une même forme militarisée de la foule. Continuité et simultanéité encore dans les références appuyées aux aspects de révolution sociale de nazisme : 20 000 SA présentent les armes au Führer, mais les fusils sont remplacés par des pelles et Hitler s’adresse aux « travailleurs allemands ». On est à 1 an seulement de l’accession au pouvoir et Hitler « surfe » encore sur les aspects économiques et sociaux du « Mouvement » lancé en 1923 et qui se veut encore plus révolutionnaire que conservateur. Enfin on est frappé de l’emprunt à des cinématographies passées ou parallèles : gros-plans, alternance ombre-lumière, plongées et contre-plongées suggèrent des emprunts, tant au cinéma expressionniste allemand qu’à celui du EISENSTEIN de « Cuirassé Potemkine ». dans l’Europe de l’entre-deux-guerres, on constate l’émergence de techniques de propagande par l’image communes à des espaces politiques différents. A cet égard, « Métropolis » de FRITZ LANG, que nous passerons prochainement, offre à travers le thème de la ville « futuriste » une vision ambivalente de la modernité qui amena Hitler à tenter de débaucher pour sa propagande le représentant le plus prestigieux de la …contestation expressionniste !!
PROLONGEMENTS…
Je conseille le film « La Vague » (Allemagne) sur la reproduction d’une expérience totalitaire aujourd’hui, mais aussi « Good-Bye Lénine » qui montre la force des images et de l’esthétique communiste dans l’imprégnation collective.
On peut lire avec profit le livre de FRANCIS COURTADE, « Histoire du cinéma nazi ».
-« Naissance d’une nation » et « Intolérance » de D.W.GRIFFITH ( 1915 et 1917) illustrent un usage parallèle et aux ressorts techniques identiques du cinéma par les USA.
OLIVIER MILZA DE CADENET.
IMAGES DE L’ HISTOIRE, HISTOIRE DES IMAGES.
EXPRESSIONNISME ET TOTALITARISME.
Retour sur « METROPOLIS » de FRITZ LANG (1927).
Pour une utilisation en dissertation, contentons-nous d’un éclairage plus « historien » que cinéphile, tout en rappelant que LANG fut un des « papes » de l’expressionnisme cinématographique, cette école qui tenta de transcrire à l’image le mal-être des années 1920 allemandes : personnages monstrueux, éclairages dramatiques, usage du clair-obscur...
Un des thèmes majeurs ici semble celui de l’ambivalence face à la modernité que traduit une vision contradictoire de la grande ville « technicienne ». Tiraillée entre culture nationaliste traditionnelle et croissance économique, entre romantisme et « Bauhaus », l’Allemagne trouve dans Berlin son unité mais aussi ses démons et ses ambigüités. L’écrivain ALFRED DOBLIN nous offre la version littéraire de cette « schizophrénie » allemande dans son « Berlin Alexanderplatz » publié en 1929. La partition de Metropolis entre « ville haute » et « ville basse » nous ramène en effet aux divisions sociales urbaines du Moyen-âge tout en posant la question de la « lutte des classes », omniprésente en Allemagne depuis les Spartakistes jusqu’au KPD. Lang fut baigné dans cette partition à la fois politique, sociale et spatiale de l’Allemagne des années 1920. Sur ce sujet, voir le recueil de nouvelles de CHRISTOPHER ISHERWOOD, « Berlin stories », 1935).
Les deux autres thèmes abordés par LANG sont les dangers de l’intelligence artificielle et de la robotisation et la perte du contrôle des hommes sur la technologie. C’est un thème récurrent de la SF qui prend une résonnance particulière dans l’Europe des années 1920 où HEIDEGGER s’interroge, dans « Etre et Temps » sur l’avenir de l’homme en tant que « personne » à l’âge technique, ce temps du « Travailleur » que ERNST JUNGER annonce de son côté. Fordisme, taylorisme, consommation et travail de masse (voir « Les Temps Modernes » de CHAPLIN en 1936) peuvent mener à un contrôle des masses que Lang décrit minutieusement dans son film, introduisant, au sommet de la hiérarchie, le Maître de l’Empire, Johann Fredersen, dont l’ubris et la froideur ne sont pas sans annoncer de futurs dictateurs...On aura compris qu’à travers ce personnage et ses « opposants » - la jeune Maria, transformée en icône de la Révolution mais « retournée » par Fredersen en iconisation robotisée de la normalisation, mais aussi Freder, le fils rebelle- LANG aborde la question des relations complexes entre pulsion révolutionnaire, modernité et totalitarisme dont HANNAH ARENDT interroge les modalités dans ses « Origines du totalitarisme ». Le destin de Lang épouse étroitement les deux attitudes possibles face au totalitarisme technicien : approché par les nazis pour prendre en charge le cinéma du III° Reich, LANG choisit l’exil aux USA, un pays qui le fascine –la vision de New-York en 1924 l’a fortement impressionné et lui a inspiré la structure formelle de sa « Metropolis »- tandis que sa compagne, THEA VON HARBOU, scénariste du film, bientôt attirée par l’idéologie hitlérienne, reste en Allemagne où elle occupera des fonctions importantes.
En bref :
-ne pas oublier que la peinture expressionniste allemande aborde dès avant la guerre de 1914 ce thème de la ville à la fois décadente (bas-fonds, prostitution, perdition, décomposation) et fascinante : voir en particulier MAX BECKMANN, OTTO DIX, et GEORGES GROSZ qui peint en 1916 sa « Metropolis », véritable « dévorante », zone urbaine agressive qui absorbe et détruit tout le monde et sur laquelle flotte la bannière étoilée en face de l’hôtel... « atlantique » !!!
-Elargissement : le thème des relations entre ville, modernité, technologie et totalitarisme sera abordé plus tard par STANLEY KUBRICK dans « 2001 l’Odyssée de l’espace » en 1967 et plus encore par RIDLEY SCOTT dans son ‘Blade Runner » en 1982 (sa ville rappelle beaucoup la Metropolis de Lang) et LUC BESSON sans « Le cinquième élément » en 1997. De son côté, dès la première moitié des années 1960, le sociologue et philosophe HERBERT MARCUSE (issu de l’Ecole de Francfort et professeur à Berkeley) décrit l’émergence de « L’Homme unidimensionnel ».
IMAGES DE L’HISTOIRE, HISTOIRE DES IMAGES.
Cinéma et totalitarisme.
Autour de « KATYN » d’ANDRZEJ WAJDA, (2009).
-Les faits : en septembre 1939, les Allemands et les Soviétiques, liés par le Pacte germano-soviétique d’août, se partagent la Pologne, ce « bâtard né du traité de Versailles » selon les termes de Molotov, ministre des Affaires étrangères de Staline. Sous couvert de défendre les Ukrainiens et les Biélorusses de la la partie orientale de la Pologne en tendant une « main fraternelle au peuple polonais », Staline entend en fait détruire l’Etat polonais, considéré comme « fasciste » en éradiquant son élite dirigeante « bourgeoise » et qui plus est catholique. Après juin 1941 et la rupture de l’alliance germano-soviétique, les Allemands pénètrent en Pologne et découvrent dans la forêt de KATYN, en territoire russe, non loin de Smolensk, des charniers contenant plus de vingt mille cadavres d’officiers de l’armée nationale polonaise tués d’une balle dans la nuque. Le modus operandi astucieux de ces exécutions – la balle dans la nuque est largement utilisée par les SS à l’encontre des Juifs en particulier avant la Solution finale (1942) – permet aux Soviétiques d’attribuer ces massacres aux troupes hitlériennes. Ce mensonge d’ état perdurera d’autant plus facilement qu’il s’inscrit dans la stratégie idéologique de l’antifascisme « ontologique » dont FRANCOIS FURET démontrera, dans son « Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XX° siècle » (Robert Laffont 1995), qu’il a permis de passer sous silence les crimes du communisme jusqu’à la fin des années 1970. ( Sur ce sujet, voir aussi « Le livre noir du communisme » sous la direction de STEPHANE COURTOIS, coll. Bouquins, 1998). La vérité éclate en 1990 quand GORBATCHEV avoue que ces soldats polonais ont été exécutés par les services spéciaux du NKVD en avril 1940. En 1992, BORIS ELTSINE en livrera la preuve au gouvernement polonais : l’ordre signé par Staline.
-La portée du film : WAJDA est déjà entrer en guerre contre le communisme polonais dans deux films importants traitant de la période de la « démocratie populaire » (régime de GOMULKA) : « L’homme de marbre » en 1977 et « L’homme de fer » en 1981. Il s’agit dans « Katyn », au-delà de l’hommage à son père –officier exécuté à Katyn- et à l’attente de sa mère, symbole de l’attente des femmes d’officiers privées de toute information pendant des décennies, de dénoncer la destruction préméditée et méthodique de l’élite intellectuelle et de l’élite militaire de la Pologne par les Soviétiques. Il s’agit plus encore, dans une optique messianique, de défendre l’unité et l’identité d’une nation qui fut, dès les partages de la Pologne du XVIII° siècle, morcelée, déchiquetée et en proie à des voisins hostiles. Les références à l’histoire identitaire de la Pologne sont nombreuses, en particulier les scènes se déroulant à Cracovie, coeur universitaire –l’université Jagellon est une des plus anciennes d’Europe- et catholique du pays où le pape Jean-Paul II fera ses études. Au second degré, Wajda effectue la radioscopie de l’organisation d’un mensonge historique à partir d’un « montage » de propagande très habile, comme il avait minutieusement décortiqué la « fabrication » du « héros socialiste » dans la Pologne de l’après seconde guerre mondiale.
-Débat : on a fait deux reproches à WAJDA :
1. D’avoir renvoyer dos à dos nazis et Soviétiques, non seulement comme prédateurs du territoire national, mais comme totalitarismes criminels. Vaste débat ! Rappelons toutefois que le massacre de Katyn fut programmé et froidement réalisé et que les officiers polonais furent les premiers à « expérimenter » la « Shoah par balles » dont les Juifs seront victimes avant la « solution finale ». Rappelons encore qu’en 1944, l’Armée rouge stationnera sur les bords de la Vistule en attendant que Varsovie soit totalement détruite par les nazis et, avec elle, des résistants nationalistes pas forcément attirés par une « libération » soviétique. (L’URSS ne reconnaît d’ailleurs, comme gouvernement en exil, que le « Comité de Lublin », d’obédience communiste et installé à Moscou et nullement son homologue londonien !). On sait aujourd’hui que les peuples qui gênent Staline sont systématiquement déportés et les classes sociales non conformes au système exterminés (dékoulakisation et famines artificielles en Ukraine en URSS au début des années 1930).
2. D’avoir marginalisé la question de l’extermination des Juifs : ce n’est pas le sujet du film et ce procès d’intention est malhonnête. Le propos de WAJDA demeure Katyn et le martyr d’une partie de la nation polonaise, passé sous silence. « Katyn » n’est pas la « Liste de Schindler » de SPIELBERG ( 1993).
-Elargissement :
. La Pologne au XX° siècle : le rôle de l’Eglise en tant que force d’opposition, aux Russes dès le XVIII° siècle, aux nazis et au régime communiste (Syndicat « Solidarité », Lech Walesa, le pape Jean-Paul II dont le rôle fut déterminant dans l’effondrement du bloc communiste).
-La lente maturation de la conquête de l’Europe orientale par les bolcheviks depuis 1920.
- La propagande par l’image (cinématographique ou d’archives) dans les totalitarismes.
OLIVIER MILZA DE CADENET.






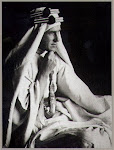
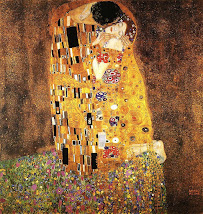


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire