FORCES ET FAIBLESSES DU MONDE COMMUNISTE
( 1945-2005)
Une grande puissance née de la Seconde Guerre mondiale qui mène de front une politique de grande puissance et la permanence plus ou moins affichée de son « magister » révolutionnaire.
Ouverture et repli intérieur alternent jusqu’à l’effondrement de l’URSS en 1991.
I. Le « grand frère » et son camp : URSS et Europe de l’Est (1945-1964).
A/ L’URSS et son « empire » jusqu’en 1953.
Si des éléments du stalinisme perdurent jusqu’aux années 1970, l’ère stalinienne proprement dite prend fin avec la mort de Staline en mars 1953.
1.La Russie soviétique au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
25 millions de morts dont 50% de civils. Un pays de 172 millions d’hab. qui souffre d’une féminisation excessive de l’emploi, de l’exode rural et de la formation d’un prolétariat pauvre. Les pertes économiques représentent 5 fois le revenu national de 1941.Mais grands progrès techniques grâce à la guerre, aux échanges technologiques avec l’étranger et déplacement des industries vers l’Oural qui produit plus de 50% de l’acier.Le IV° plan quinquénnal (1946-1950) connaît un taux de croissance de la production industrielle de plus de 20% par an. Le V° plan(1951-1955) est marqué par la surconcentration des kolkhozes et les dépenses urbaines de prestige sous l’impulsion de Staline.Naissance des « agrovilles » dans l’optique d’une « ouvriérisation » des paysans. Réorientation du commerce extérieur vers les démocraties populaires dans le cadre du CAEM ou « Comecon » en janvier 1949.
2.l’exercice de la dictature et l’évolution du stalinisme.
Persécution des oppositions, des minorités nationales et déportations systématiques de populations « suspectes », soit environ 1 million de personnes :Tchétchènes, Allemands de la Volga, Tatars de Crimée, Kalmouks,Ingouches, peuples de la Baltique. Répression très dure en Géorgie en 1952 (Béria). Le « Goulag »-administration des camps-regroupe entre 5 et 12 millions de détenus en 1953 (cf article « camp de concentration »).
A partir de 1946, mise au pas des esprits avec le « réalisme socialiste » de Jdavov, Secrétaire du Comité central. Soutenue par Staline, la jdanovtchina entend créer un homme nouveau ; elle puise dans les thèses de Lyssenko qui entend prouver l’hérédité des caractères acquis. Utilisation de la psychiatrie lourde et hostilité à la psychanalyse, bourgeoise et « juive ». D’où le « complot des blouses blanches » contre les médecins juifs de Staline en janvier 1953. De 1948 à 1953, de vastes purges qui touchent les milieux intellectuels et artistiques : Akhmatova, Prokofiev, Chostakovitch. Parallèlement, véritable idolâtrie de Staline, notamment en 1949, à l’occasion de son 70° anniversaire. Fonction nouvelle de l’Etat où le parti-qui perd son nom de bolchevik-n’a plus qu’une fonction formelle : le politburo est remplacé par le Présidium (25 titulaires) peuplé de fidèles (Brejnev) tandis-que de le Secrétariat du Comité central passe de 5 à 10 membres. Staline prend en fait ses décisions au sein d’un bureau secret de 9 membres ou lors de conseils restreints (Malenkov, Khrouchtchev). C’est à l’Etat, et non plus aux masses, de transformer le pays dans le sens d’un nationalisme panrusse et d’une vocation révolutionnaire tempérée d’un répis international nécessaire au renforcement de la puissance.
3. l’extension de l « empire » : les Démocraties populaires.
Il s’incarne à partir d’octobre 1947 dans la fondation du Kominform et s ‘appuie sur la « doctrine Jdanov » qui peut se résumer en trois points :1/ le monde est désormais divisé en deux camps irréconciliables ;2/ l’URSS est le chef de file du camp de la démocratie et de la paix ; 3/ partout où ils le peuvent, les partis communistes doivent prendre le pouvoir. Contexte de guerre froide en escalade : le plan Marshall de 1947 ; le blocus de Berlin-Ouest et le pont aérien américain qui lui fait suite entre juin 1948 et juin 1949 ; entre-temps, la réforme monétaire dans la « bizone » anglo-américaine en Allemagne. Surtout, le « coup de Prague » de février 1948 en Tchécoslovaquie qui assure la victoire des communistes de Klement Gottwald.
Partout en Europe de l’Est, la tactique du « salami », appuyée par la présence de l’Armée Rouge, permet aux ministres communistes des gouvernements de coalition installés au lendemain de la guerre, de prendre peu à peu le contrôle des postes-clef entre 1958 et 1952. Partout, les nouvelles constitutions sont une réplique de la matrice soviétique et dans tous les cas des leader cumulent les fonctions de secrétaire général du parti et de chef du Gouvernement : Bierut en Pologne, Gottwald en Tchécoslovaquie, Rakosi en Hongrie, Dej en Roumanie, Tchervenkov en Bulgarie, Ulbricht à partir de 1950 en RDA après la partition de l’Allemagne de 1949.
Un peu partout, répression contre les oppositions-en particulier religieuses (les primats de Hongrie et de Pologne, Mgrs Mindtszenty et Wyszynski sont emprisonnés) et purges qui, de 1948 à 1952, touchent en moyenne 25% des effectifs communistes. Des procès et des exécutions retentissants comme ceux de Slansky en Tchécoslovaquie et Rajk en Hongrie.
Des sociétés mixtes permettent le pillage par l’URSS des économies de ces pays qui sont par ailleurs soumis à de lourdes réparations (Roumanie, Hongrie, Bulgarie). Alignement sur les structures politico-économiques de l’URSS, bien qu’un secteur privé soit maintenu, limité et contrôlé par l’Etat, en particulier en Tchécoslovaquie et en Hongrie qui connaissent dès les années 1960 des réformes libérales (sociétés mixtes avec pays d’Europe de l’Ouest), d’où leur position plus favorable après 1991.
La Yougoslavie de Tito échappe en partie à ce modèle. Tito a libéré le pays et n’entend pas passer sous le contrôle des sociétés mixtes et de l’Armée Rouge.. Au printemps 1948, il exclut du PC les partisans de l’alignement sur Moscou qui rappelle tous ses conseillers. La rupture est consommée le 28 juin 1948. Malgré le « blocus » de l’URSS et des démocraties populaires il parvient, après une phase classique d’étatisation, à metre en place à partir de 1950 une expérience d’autogestion économique dans l’entreprise et d’autogestion sociale dans le cadre de la commune à partir de la Constitution de 1953. Toutefois, à partir de 1954-1956, retour à l’orthodoxie planificatrice et alignement sur l’URSS khrouchtchévienne. Par ailleurs, un culte de la personnalité de Tito (parallèle avec Enver Hodja en Albanie) et prépondérance de l’élément serbe dans la confédération yougoslave, germe de conflits futurs.
B/ Une « perestroïka » manquée : l’ère Khrouchtchev (1953-1962).
1.Genèse d’une ouverture : l’ascension de K.et le XX°Congrès du PCUS.
Mort de Staline le 5 mars 1953. Direction collégiale Malenkov-Beria, mais le second doit céder son poste de Premier secrétaire du PC à K(septembre) qui va s’appuyer sur le parti et sur l’armée(Joukov)afin d’échapper à l’emprise du pouvoir policier de Beria. Des hommes de Staline sont écartés, comme Brejnev.K.entend promouvoir une détente intérieure et revenir à la légalité socialiste.
Amnistie partielle pour les prisonniers politiques-peines de moins de 5 ans, enfants, femmes…-et administration du Goulag confiée au ministère de la Justice. Il n’y aurait plus que 2% de politiques parmi les 900 000 détenus en 1957.
Elimination physique de Béria en juin 1953, puis éviction de Malenkov en février 1955, accusé de s’opposer à la nouvelle orientation économique de K.qui a lancé en 1954 le projet de mise en valeur des « terres vierges » de Sibérie et d’Asie centrale. K.s’impose définitivement à partir de son ouverture vers les pays de l’Est, en particulier le voyage à Belgrade.
Mais c’est le XX° Congrès du PCUS qui assoit définitivement le pouvoir de K. Tenu en février 1956, son rapport officiel prône l’accroissement de la « richesse sociale » comme objectif du 6° Plan et une détente internationale. Son rapport secret dénonce les crimes et les erreurs commises par Staline depuis 1934, date choisie
comme début de la « dégradation du caractère de Staline ». Mais c’est résumer le problème à Staline seul et ne pas remettre en cause le système, les purges contre les vieux bolcheviks et certaines déportations de populations. Pas question non plus d’autoriser la contestation des intellectuels comme le réalise Boris Pasternak qui ne pourra aller chercher le prix Nobel que lui a valu son « Docteur Jivago » en 1958.
2 Les réformes de K : volontarisme et ambigüités.
Ces réformes ne remettent pas en cause le cadre plannificateur. Dans le cadre du 7° plan(1959-1965), elles prévoient surtout le développement des régions orientales mais l’opérations « terres vierges » aboutit en particulier à un désastre écologique au Kazakhstan où …le blé ne prend pas !. Les « sovnarkhozes », substututs aux ministères censés introduire une meilleure gestion dans les entreprises, débouchent sur un alourdissement de la bureaucratie (1957). Toutefois la durée du travail ouvrier diminue et les travailleurs sont libres de changer d’employeur. Mais « Monsieur Maïs » cherche surtout à rivaliser avec les Etats-Unis. Les kolkhozes manquent d’équipement et les technocrates du nouveau système, mécontents de leur exil, sabordent les réformes par leur inertie. Le cheptel bovin chute de 50% en 5 ans et en 1963, l’URSS doit importer 18 millions de tonnes de blé.
Au plan politique, même déconfiture : la réforme de 1961 sur la rotation des cadres dans le parti se heurte à l’hostilité de la « nomenklarura », tandis-que celle de 1962, visant à créer une branche agricole et une branche industrielle dans le parti entraîne pour K. l’accusation de rupture de « l’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie. Autant d’éléments qui, avec l’échec soviétique dans la crise des fusées ( 1962, cf infra), aboutissent à la démission de K. en octobre 1964, puis à sa destitution.
Seuls succès de la période : la satellisation en 1957 du premier « Spoutnik » et le premier vol orbital effectué par Y.Gagarine en 1961.
3.A l’extérieur : politique étrangère et conséquences du khrouchtchevisme dans les Démocraties populaires.
a.La politique étrangère : détente(53-58) puis retour à la tension(58-62).
C’est la coexistence pacifique prônée par K. qui reprend à son compte la théorie léniniste du « répit » (1918) et le « socialisme dans un seul pays » de Staline. Surtout, l’URSS, qui possède la bombe A depuis 1949 et la bombe H depuis 1953 prend conscience de sa puissance, mais aussi de l’apocalypse nucléaire potentiel. Enfin elle a besoin d’une longue période de paix pour réaliser ses grands projets économiques et rattraper, puis dépasser les Etats-Unis.En juillet 1955, les quatre grandes puissances se rencontrent à Genève et en janvier 1956, Boulganine et K.déploient, lors de leur visite en G.B., l « offensive du sourire ».
Toutefois, constitution parallèle du Pacte de Varsovie (mai 1955) en réponse à l’admission de l’Allemagne dans l’Alliance atlantique. Mais les crises de Suez et de Budapest, à l’automne 1956 ne débouchent sur aucun affrontement direct entre les deux Grands. D’une manière identique, la décision de K. de rouvrir la question de Berlin en novembre 1958 en exigeant la transformation du secteur occidental en ville libre neutralisée, ne l’empêche pas de rencontrer Eisenhower à Camp David en septembre 1959. Mais la question berlinoise est relancée en 1960 avec l’affaire de l’avion US U2 abattu par les soviétiques au-dessus de leur territoire. En juin 1961, K. rencontre Kennedy à Vienne et fait part de son intention de signer un traité de paix avec la RDA si les occidentaux ne cèdent pas sur Berlin. Les effectifs US augmentant en Allemagne, le gouvernement est allemand édifie, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, un mur le long de la ligne de démarcation qui coupe Berlin en deux, stoppant l’exode vers l’Ouest des Allemands de l’Est hostiles au régime.
Ce retour à la tension culmine avec la crise des fusées (octobre 1962). L’île de Cuba est passée aux mains des guerilleros menés par Fidel Castro qui a mis fin à la dictature de Batista. Nullement communiste au départ, il est jeté dans les bras des Russes par l’hostilité des Américains. De fait, l’accord soviéto-cubain de février 1960 sur l’achat par l’URSS de 5 millions de tonnes de sucre en 5 ans, puis la nationalisation des entreprises américaines par Castro en août de la même année, aboutissent à l’embargo total sur le commerce américain à destination de Cuba en octobre, après que le numéro 2 cubain, Ernesto « che » Guevara, ait annoncé solennellement que l’île faisait partie du camp socialiste. Quoique au départ assez bienveillant à l’égard de l’expérience cubaine, Kennedy, poussé par son opinion, donne le feu vert au débarquement dans la Baie des Cochons le 14 avril 1961, qui sera un fiasco complet. Le 11 septembre 1962, Moscou déclare que toute attaque contre l’île provoquerait un conflit mondial. Le 14 octobre 1962, les Américains repèrent sur le territoire de l’île des rampes de lancement pour des missiles à moyenne portée pouvant porter des charges nucléaires et atteindre le territoire américain, tandis-que des cargos soviétiques font route vers Cuba, porteurs de fusées et de bombardiers Ilyouchine. Le 22 octobre 1962, dans un discours important, Kennedy interdit aux soviétiques de forcer le blocus de Cuba, enjoint K.de mettre fin à sa provocation, annonce le renforcement de la base US de Guantanamo et demande la réunion du Conseil de Sécurité. K. finit par reculer et obtient la levée du blocus et la promesse des Américains de ne pas envahir l’île. Ses motivations restent obscures : tester Kennedy, obtenir par la pression une négociation globale incluant Berlin ou échanger le retrait de ses fusées contre le retrait des fusées américaines en Iran et en Turquie ? La crise conduit en tout cas à la « détente ».
b.Evolution des D.P.
-En 1953, troubles graves en RDA et en Tchécoslovaquie où la population refuse l’alignement sur le modèle soviétique. A Berlin, les soviétiques répriment militairement le soulèvement ouvrier tandis-qu’en Tchécoslovaquie, ce sont les forces gouvernementales qui mettent fin à la contestation.
-l’année 1956 connaît des mouvements plus radicaux : en Pologne, la révolte des ouvriers de Poznan se solde par une cinquantaine de morts mais Gomulka doit s’entourer d’éléments plus modérés au sein du parti. En Hongrie, le communiste libéral Imre Nagy laisse se reconstituer des partis hostiles à l’URSS et accorde la liberté de la presse dans une ambiance de soulèvement populaire. Aussi le Premier Secrétaire du parti, Janos Kadar, fait-il appel aux soviétiques qui interviennent le 1° novembre 1956. Le soulèvement de Budapest, du 4 au 13 novembre 1956, se solde par un échec, faisant environ 10 000 morts et aboutissant à 20 000 arrestations. Nagy sera emprisonné puis exécuté en juin 1958.
Enfin, l’Albanie et la Yougoslavie parviennent, à partir de 1961, à se démarquer du modèle soviétique, la première dans un alignement sur Pékin, la seconde à travers une expérience nationale et autoritaire (Ceaucescu).
Surtout, ouverture progressive de pays comme la Tchécoslovaquie et la Hongrie à l’Occident dès la fin des années 1960. Le Comecon reste le cadre institutionnel des échanges mais la part des pays à économie de marché dans le commerce des DP augmente de 9%/an au cours de la décennie 1960-1970.
II. L’ERE BREJNEV (1964-1982).
A/ La pratique politique.
1.L’ascension de B.
K. mis à l’écart au profit d’une troïka Kossyguine-Podgorny-Brejnev. Ce dernier est Premier Secrétaire mais il est passé par la présidence du Soviet Suprême de 1960 à 1964.Né en 1906, cet ingénieur métallurgiste a fait toute sa carrière à l’ombre de K. A partir des années 1970, il prend le contrôle de la P.E, aidé de Podgorny (relations avec le 1/3 monde).En 1976 il est nommé Maréchal de l’URSS et en 1977 il cumule les fonctions de chef de l’Etat et de Premier Secrétaire, tout en réaffirmant le principe de la collégialité. Le Parti est renforcé et le S.S réduit à un rôle consultatif.
Le XXIII) Congrès du Parti (mars-avril 1966) réaffirme la primauté du dogme et réprime les « déviationnismes », manière d’imposer une clientèle brejnévienne docile (ANDROPOV devient chef du KGB en 1967). La propagande réactive les grandes dates de la mythologie révolutionnaire (Octobre, Grande Guerre Patriotique, centenaire de Lénine…)tout en laissant se développer un patriotisme virant au néoslavophilisme avec la nécessité d’assujettir les peuples allogènes à l’entité russe. D’où le « réhabilitation » partielle de Staline : exclusion du partir de l’historien NEKRITCH qui avait critiqué l’incurie de S.en 1941 ; applaudissements saluant en 1970 l’acteur incarnant Staline dans le film « Libération ».
2 La constitution de 1977.
Elle insiste sur les aspects unitaires liant l’Etat et les peuples de l’Union et entérine le transfert progressif des responsabilités aux « organisations sociales » (K.) dans le cadre de la transition vers le communisme. Certes, le peuple est mis en avant puisqu’élisant les députés du S.S. à deux chambres-Soviet de l’Union (767 députés) et Soviet des Nationalités (750 dep.)-mais c’est l’Etat qui est « l’expression de la volonté sociale ». En fait, c’est le Parti qui demeure la force qui « dirige et oriente la société soviétique » (art.6).
De fait, retour à la rigidité doctrinale comme ressourcement léniniste : le Présidium du CC est rebaptisé POLITBURO et le Premier Secrétaire redevient SECRETAIRE GENERAL. Un parti de masse de 16,5 millions de membres, soit 10% de la pop.act (pop.tot. de 262,4 millions/ha en 1980), où femmes, ouvriers et paysans et non-slaves sont sous-représentés (61,2% de slaves ne représentant que 52% de la population). Ajouter 23 millions de membres du KOMSOMOL.
Les organismes directeurs du parti :
-C.C : c’est l’élite dirigeante (516 membres en 1976)et le reflet des grands appareils d’Etat( armée, diplomatie, police…).
-POLITBURO : véritable gouvernement.23 membres d’une moyenne d’âge de 70 ans.
-Secrétariat du C.C : 10 membres en 1980 dont 6 sièges au Politiburo. Totalement renouvelé sous B.,son SECRETAIRE GENERAL dirige l’appareil et nomme les cadres sup. qui forment une partie de la NOMENKLATURA.
3 Répression et dissidences
Résistance culturelle sous forme de « samizdat » ou de revues marginales comme « La cloche » (« kolokol » d’avant la révolution)ou « Novy mir » poursuivies pour « déviationnisme ». Rôle de SOLJENITSYNE , interdit de publication depuis 1963 et qui ne peut aller recevoir son Nobel en 1970. Procès et emprisonnement des écrivains SINIAVSKI et DANIEL, A.GUINZBURG ou A.AMALRIC, auteur de « L’Union soviétique survivra-t-elle en 1984 ». La répression touche également les Juifs, souvent établis dans les républiques baltes et en Ukraine : en 1972, 30 000 d’entre eux demandent à rejoindre Israël. En 1974, le physicien SAKHAROV, un des pères de la bombe soviétique et fondateur d’un Comité des droits de l’homme est relégué à Gorki avec sa femme Helena Bonner. Enfin, opposition des nationalités hostiles à la russification en Ukraine,Arménie, Géorgie et Lithuanie(plus catholicisme dans ce cas).Culturellement, permanence des canons jdanoviens (architecture et rats plastiques) mais émergence d’un cinéma plus alternatif, en particulier avec A.TARKOVSKI (« Andreï Roublev » 1969).
B/ Economie et société jusqu’au début des années 1980.
1.L’inévitable réformisme de façade
Réformes dites Liebermann à partir de 1965 : plus d’autonomie pour les entreprises et création d’un Institut de recherche de la demande. Surtout, soupapes de la corruption et du marché noir.Un échec qui contraint à importer du blé des USA (jusqu’à 25 millions de tonnes en 1979-80).Baisse constante de la croissance industrielle (7,4% en 1971 ;3,4% en 1979)et du revenu national. La dessus, la crise mondiale renchérit le prix des importations et provoque une stagnation des exportations.
2.Les transformations sociales.
Les femmes représentent 53,5% de la population en 1980 mais sont sous-représentées au plan décisionnel et la natalité diminue (37,8% en 1937 et 17,6 en 1973). Toutefois, fécondité élevée en Asie centrale et dans le Caucase, d’où, à terme, problème d’équilibre ethnique !
Urbanisation avec une hausse de 20% des urbains entre 1970 et 1979, à mettre sur le compte de la déprise rurale et des « agrogorod », d’où problème grave de logement dans des villes à banlieues immenses et mal équipées où chaque soviétique dispose de 9 m2 autorisés en 1980. Cohabitation des générations qui brise les couples. Une société « idéologique » où classe ouvrière et paysannerie subissent l’ascendant de la Nomenklatura. Peu de mobilité sociale et une désespérance engendrant absentéisme et alcoolisme, phénomènes « anti-sociaux » dénoncés par B.en 1978. Retour du cynisme et de la marginalité que traduiront, à la fin des années 1980, des cinéaxtes comme Vitaly Kanevski ou Pavel Lounguine.
Les contradictions du modèle apparaissent surtout dans les démocraties populaires où l « empire » commence à se lézarder.
C/ Démocraties populaires : le temps des fractures.
Les perturbations récurrentes de l’empire font naître dans certaines D.P.un système hybride où coexistent totalitarisme et plus grande autonomie de la société civile.
1Tchécoslovaquie et Pologne (1967-1971).
a-Tchécoslovaquie :le « printemps de Prague »(1967-1968).
Recherche d’un nouveau modèle face à la récession ; autonomisme slovaque d’Alexandre Dubcek (1912-1992), Premier secrétaire du P.C.slovaque depuis 1963 et fronde des intellectuels au sein de l’Union des écrivains. Montée générale dans les DP d’une culture alternative qui rencontre un individualisme de résistance(Kundera et Havel en Tchéco ;Adam Michnik et Jacek Kuron en Pologne ; Janos Kis et Gyorgy Bence en Hongrie).
En janvier 1968, Dubcek prend la direction du parti tchécoslovaque et entend promouvoir un « socialisme à visage humain » fondé sur l’introduction des libertés fondamentales et la fédéralisation du pays. A partir d’avril, il place ses hommes aux commandes (direction du gouvernement et de l’Assemblée nationale) et écarte les partisans de Novotny, ancien Secrétaire général du parti et chef de l’Etat, plus ou moins soutenu par les Russes. Le 27 juin, la censure est abolie. Cette dernière mesure provoque l’intervention des troupes du Pacte de Varsovie dans la nuit du 20 au 21 août 1968.Le parti passe sous la houlette de GUSTAV HUSAK et 500 000 personnes en sont exclues. Triomphe de la « doctrine Brejnev » de souveraineté limitée des DP. Le pays choisit un conservatisme d’austérité tempéré de fédéralisme pro-slovaque et de légère amélioration du niveau de vie (« communisme du goulash »). Mais l’illusion d’un miracle industriel autorisé, comme en RDA, par des spécialisations industrielles, s’effondre. Tout au plus ces spécialisations permettent-elles au pays de livrer à l’URSS la moitié de ses exportations de biens d’équipement.
b-La Pologne.
Mutation sociale des années 1946-1965 : afflux de paysans dans les villes ( plus 43,5%) et émergence d’un prolétariat sous-qualifié aux références culturelles différentes du reste de la classe ouvrière. Syndicalisation de type social-démocrate en recul. Virage autoritaire et dogmatique de GOMULKA aboutissant à la révolte étudiante de février 1968, puis à l’insurrection ouvrière de décembre 1970 provoquée par la hausse des prix des produits alimentaires et qui, de Gdansk, gagne tous les ports de la Baltique. Une répression qui fait sans doute autour de 300 morts. Reprise en mains d’E.GIEREK . Celui-ci cherche à désamorcer la crise par des hausses de salaires, une politique d’investissements industriels destinée à mieux intégrer l’économie polonaise au marché mondial et une certaine libéralisation politique (relâchement du contrôle policier, plus grande facilité de déplacements à l’étranger). Comme Kadar en Tchéco., Ceaucescu en Roumanie et les dirigeants yougoslaves, il cherche à amadouer les Occidentaux par une façade libérale destinée à attirer des capitaux afin de relancer les exportations par une politique de modernisation industrielle. Mais la crise de 1973-79 ferme le marché occidental à des produits polonais peu concurrentiels. Le mouvement ouvrier en est d’autant plus relancé dans les secteurs traditionnels comme les chantiers navals. A partir de la seconde moitié des années 1970, il fait sa jonction avec l’opposition catholique (cardinal WYSZYNSKI) et celles des intellectuels (MICHNIK, KURON) d’où naîtra le KOR (Comité d’aide aux travailleurs victimes de la répression) à la suite des grèves de septembre 1976, puis SOLIDARNOSC à l’été 1980, sonnant le glas de l’ère Gierek.
2Les réformes et leur destin dans les autres DP .
a-En Hongrie : réformes dans l’agriculture à partir de 1968 sous l’égide de JANOS KADAR (hausse de la productivité, sélection des dirigeants en fonction des seuls critères de compétence…).Surtout,début de désétatisation de l’industrie( 1400 entreprises publiques : 2 de 1950 à 1980) et autonomisation des entreprises, tandis-que le secteur touristique est privatisé et que des « joint ventures » apparaissent . D’où naissance d’une petite bourgeoisie d’entrepreneurs dont les revenus avoisinent ceux de leurs homologues occidentaux.
b-Partout ailleurs, l’immobilisme, que ce soit dans la Bulgarie de Todor JIVKOV (en place depuis 1954) malgré les réformes de façade de son I°Ministre Filipov en 1982-1984, la RDA d’Erich Honecker (1972-1989) ou dans la Roumanie des Ceaucescu (Nicolaï, Helena et Niko), une dynastie cimentée par un national-communisme dans un pays où le service de la dette représente un tiers des recettes d’exportation à la fin des années 1970, où la mortalité infantile grimpe à 25/1000 (18/1000 en Pologne)et où la Securitate sème la terreur.
Conclusion : une forteresse lézardée par la montée d’un national-bolchevisme en Russie et par un nationalisme ethniciste en Roumanie (« roumanisation des Magyars de Transylavanie), en Bulgarie (« bulgarisation des Turcs) et en Yougoslavie où la primauté serbe cherche à se rétablir sur les régions à minorités nationales, albanaise du Kosovo et hongroise de Voïvodine, en partticulier après la mort de TITO (1892-1980).
III. LA FIN D’UN EMPIRE : L’URSS ET LES DEMOCRATIES POPULAIRES (1982-2000)
Blocage d’un système à bout de souffle, émergence d « hommes nouveaux » et radicalisation des oppositions en Europe de l’Est expliquent l’effondrement de l’empire de Staline. Mais le passage brutal au libéralisme réveille des nationalismes parfois archaïques mais aussi des sensibilités religieuses et culturelles toujours vivaces. Malgré la dilution progressive de l’Europe de l’Est dans une logique ouest-européenne, cette zone évoque parfois l’Europe de 1914. De Brejnev à Poutine, l’URSS,devenue CEI puis Fédération de Russie, passe du communisme au nationalisme autoritaire avec l’aval de l’Occident soucieux d’assurer la stabilité, en particulier dans le Caucase et l’Asie centrale.
A/ Un empire interrompu : de l’URSS à la C.E.I.(1982-1992).
1.L’ascension de GORBATCHEV .(voir fiche biogr.).
A l’ombre de YOURI ANDROPOV (novembre 1982-10 février 1984), ex-chef du KGB mais « libéral » convaincu de la nécessités de réformes structurelles à réaliser par le haut. De son côté, CONSTANTIN TCHERNENKO (février 1984-mars 1985), du clan de Brejnev, sert de fusible en attendant que les réformateurs triomphent des conservateurs. A sa mort, Gorbatchev, déjà Président de la Commission des affaires étrangères, devient Secrétaire général du PC, à l’âge de 54 ans (un jeunot).Cet ingénieur agronome à le profil type du réformateur agraire et une assise nationale et régionale grâce à son implantation à Stavropol où il dirige les JC. Juriste de formation et rompu aux questions internationales, il a le « look » de l « ouverture ». Il évince doucement son rival Romanov, remplace le dinosaure A.GROMYKO par Edouard CHEVARNADZE et procède à des remaniements dans l’armée.Il est nommé chef de l’ETAT le I° octobre 1988. Par ailleurs, LIGATCHEV, un conservateur, prend la direction du parti et G.doit compter avec l’opposition d’une « aile gauche » plus radicale, en particulier B.ELTSINE, chef de l’organisation du parti à Moscou et viré en novembre 1987.
2. Transparence et réforme : perestroïka ou « katastroïka » (A.Zinoviev) ?
De 1985 à 1988, G. lance la Perestroïka (restructuration au sens économique et social) et la Glasnost (« transparence » au sens de libéralisation politique et culturelle). Il va s’appuyer sur les techniciens, les intellectuels et les journalistes qui savent qu’ils doivent aérer le système s’ils veulent perdurer avec lui. D’où, en 1988, la révision de la Constitution de 1977 et l’élection pour 5 ans au suffrage universel direct du Soviet suprême par le biais d’un Congrès des députés du peuple. Le tout entériné par les élections de mars 1989 qui entérinent cette révision. Reste que 750 des 2250 élus par des organisations diverses (académies, parti...) et que tout part de G. lui-même. La démocratisation n’en est pas moins réelle puisqu’aux élections, Ligatchev, chef des conservateurs, est le plus mal élu, alors que B.Eltsine est élu à Moscou avec 85% des suffrages.G. est élu Président de l’Union en mars 1990. En mai-juin,parallèlement,Eltsine est élu Président du Parlement de la Russie proclamée « souveraine ».En juin 1991,il sera élu Président.Vladimir Jirinovski, ultra-nationaliste, remporte presque 8% des suffrages.
Les réformes : elles doivent aller dans le sens de la mise en place d’un système bancaire cohérent et celle de l’entreprise privée dans le cadre de la libéralisation des prix et des échanges. Or, dès 1989, elles ne sont pas entérinées par le pouvoir politique et on lance même un plan quinquennal très conservateur (1991-1995).Pour l’heure, G. est contraint en 1988 d’acheter pour 16 milliards de dollars de biens de consommation à l’étranger. Par ailleurs, sur les 1542 sociétés mixtes reliant capitaux russes et étrangers, 200 fonctionnent véritablement en 1990, les Occidentaux en particulier craignant un cadre juridique flou et une solvabilité fragile.Par ailleurs, l’aide étrangère sera freinée par l’éclatement de l’URSS en décembre 1991
Toutefois, la détente intérieure est évidente avec la libération de nombreux prisonniers politiques, le retour des SAKHAROV à Moscou en 1986, la réhabilitation des leaders disparus au cours des purges, le retour d’une activité religieuse (1500 églises réouvertes en 1988-1989).
Les limites de la perestroïka sont en revanche nettement visibles pour ce qui est des nationalités (cf infra), ce qui va provoquer une réaction anti-Gorbatchev et propulser Eltsine au pouvoir. Surtout, l’erreur de G. est d’avoir imposé aux Russes sa vision de l’Occident et d’avoir détruit la société communiste sans proposer d’alternative viable (A.Zinoviev).D’où une impopularité en Russie que va révéler le coup d’Etat d’août 1991.
3.La chute de G.et l’éclatement de l’URSS.
Le putsch manqué d’août 1991 précipite la décomposition de l’URSS et la chute de G.au profit de BORIS ELTSINE et de la FEDERATION DE RUSSIE, et accélère le processus d’indépendance/réformes dans l’ex-empire et chez les anciens satellites européens.
Début 1991 ; G. réduit les pouvoirs du PCUS transformé en formation social-démocrate. Il propose de remplacer l’URSS par une Union des Républiques soviétiques souveraines. Double opposition : les réformateurs radicaux derrière le Mouvement démocratique pour la réforme (Iakovlev, Chevardnadze,Volski-ce dernier leader du patronat d’Etat moderniste) et la Plate-forme démocratique de Eltsine, plus indépendantiste et soutenu par l’ukrainien Kravtchouk, élu Président du Soviet suprême de sa république en juillet 1990.
Le 12 juin 1991, Eltsine rompt avec G.et se fait élire Président de la Russie.Parallèlement, agitation des militaires qui se sentent abandonnés après le retrait d’Afghanistan et vivent mal leur action répressive dans les républiques baltes ou en Géorgie.Effrayés devant l’effondrement de l’empire, les conservateurs communistes (en tête desquels le Premier ministre Pavlov) tentent de renverser G., alors en vacances sur les bords de la mer Noire, les 18-21 août 1991.Rapidement maîtrisé, le putsch, où G. a joué un rôle difficile à apprécier, débouche sur l’ascension de ELTSINE et de la puissante Fédération de Russie au coeur de la CEI (Communauté des Etats indépendants) née le 8 décembre 1991. Elle regroupe 11 des 15 républiques de l’ex-URSS autour de la Russie, de la Biélorussie, de l’Ukraine, du Kazakhstan et des républiques d’Asie centrale. Les trois républiques baltes et la Géorgie n’adhèrent pas. La Russie s’approprie le siège de l’URSS au Conseil de Sécurité des nations Unies. Gorbatchev démissionne le 25 décembre au profit d’Eltsine qui s’est fait accorder par le Soviet suprême (dont il est Président depuis juin)des pouvoirs spéciaux pour réformer l’économie et les finances.E.GAÏDAR sera nommé I°Ministre en juin 1992.
B/ Réformisme et nationalisme : la CEI et l’Europe de l’Est à l’heure du post-communisme.
1.Tensions et recherche de voies nouvelles dans l’ex-Union soviétique.
Rejeu d’un nationalisme territorialiste qui se superpose à un vieux nationalisme ethnique et culturel. D’autant que dans la nouvelle Russie, (qui regroupe 148,5 des 291 millions d’hab.de l’ancienne union), les Russes passent de 50 à 80% de la pop.La fédération de Russie compte par ailleurs plus de 85% de slaves. La question nationale réémerge donc, de Vladivostok à Belgrade.Eltsine a imposé à la CEI des réformes disparates décidées par la seule Russie. La libération des prix a multiplié par 16 ceux des produits alimentaires et l’austérité budgétaire a frappé de plein fouet les dépenses sociales et l’éducation. Les privatisations ont peu touché les PME mais fait naître un puissant « parti industriel » et une société à deux vitesses s’est mise en place, opposant 90% de la population vivant à proximité ou en deçà du seuil de pauvreté et une minorité de profiteurs du nouveau système.
Sauf la Lituanie (mars 1990) ,les autres ex-républiques de l’URSS ont proclamé leur indépendance au cours de la seconde moitié de l’année 1991. Mais on a des régimes de moins en moins démocratiques et de plus en plus autoritaires d’Ouest (Etats baltes) en Est (Asie centrale), les zones les plus méridionales (Caucase) et orientales sombrant dans des rivalités inter-nationalistes et inter-ethniques (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Tchétchénie).
Limites de la Perestroïka : les pressions de Moscou pour éviter le processus d’autonomie en Lituanie et en Lettonie en 1991 (14 morts à Vilnius où le Président Lansbergis fut assiégé dans son parlement ; 4 morts à Riga). Chute des productions industrielles et ouverture vers un Occident prudent.
Du fait de la présence de communautés russes dans nombre d’ex-républiques de l’URSS, chocs interethniques en Biélorussie, Moldavie( communauté moldave roumanophone) et en Ukraine, grenier à blé et puissance militaire de culture traditionnellement anti-russe.
Plus on va vers l’Asie, plus la personnification du pouvoir et les rivalités interethniques s’intensifient : conflit entre Arménie et Azerbaïdjan à propos des enclaves respectives du haut-Karabakh (arméniens)et du Nakhitchevan (azéris) de 1988 à 1992 ; difficultés de la Géorgie (E.Chevardnadze) face à la sécession abkhaze et à la volonté de réunion de l’Ossétie du Nord et du Sud.
En Asie centrale, conflits entre les anciennes équipes dirigeantes et les islamistes, Tachkent (Ouzbékistan) cherchant à s’imposer comme chef de file de toute la région.Peuplé de 17 millions d’habitants, l’immense Kazakhstan fut la première république de l’ex-URSS a proclamer son indépendance en octobre 1990. Elle s’est ouverte sur les USA, la Corée du Sud et la France en particulier).A noter que seul l’Ouzbékistan abrite un mouvement islamiste virulent dirigé par le Parti de la renaissance islamique.En général, on est passé d’un pouvoir communiste à un pouvoir autoritaire de type califal, mais sans l’éclatement pronostiqué par H.Carrère d’Encausse dans son « Empire éclaté »
2.La fin des démocraties populaires
Contrairement à 1956 et 1968, Moscou laisse se dérouler le scénario de démantèlement des D.P entre mai 1988 (lâchage de Janos Kadar en Hongrie) et octobre 1989 (ouverture du mur de Berlin par une RDA dépassée par la pression populaire. Sans doute cherche t-il à courtiser l’Occident en réactivant la vieille théorie du répit, chère à Lénine ; peut-être a-t-il été dépassé par les événements, ou bien a-t-il pensé canaliser les revendications pour préserver l’essentiel de l’héritage socialiste, à moins qu’il ait sacrifié l’Ouest européen pour obtenir les mains libres dans le Caucase et en Asie centrale ?
En tout cas, deux scénarios de rupture :
-un scénario « soft » impulsé par des équipes plus ou moins dotés d’un programme (Pologne, Hongrie, RDA, Tchécoslovaquie).
-Dans les quatre Etats balkaniques (Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie et Albanie) au contraire, l’intrication entre communisme, anticommunisme et nationalismes s’est soldée par des situations de chaos et de guerre civile.
a-Transition « soft ».
-Pologne: après les grands grèves de l’été 1980, le PC polonais limoge le successeur de Gierek, Kania, et le remplace par le général JARUZELSKI qui proclame l’état de guerre le 18 octobre 1980. Walesa est placé en résidence surveillée. L’état de guerre sera levé en 1983, année où Walesa reçoit le prix Nobel de la paix. Enferrée en Afghanistan, l’URSS n’intervient pas. Opposition polonaise soutenue par l’Eglise et des intellectuels prestigieux (B.Geremek, A.Michnik,J.Kuron). Le 5 avril 1989, légalisation de « Solidarité » et mise en place d’un régime parlementaire. Walesa sera élu Président de la république, mais dans un contexte de transition vers l’économie de marché difficile.
-Hongrie : départ de Kadar en mai 1989 et soutient de la BIRD et du FMI. Budapest ouvre ses frontières aux réfugiés d’Allemagne de l’Est, contribuant à l’éclatement de la RDA. Montée d’un populisme nationaliste dans un pays définitivement tourné vers l’Ouest (la moitié des investissements occidentaux effectués à l’Est). L’Allemagne a remplacé l’URSS comme premier partenaire commercial. Mais déception progressive avec 10% de la population active au chômage.
-Tchécoslovaquie : au terme de la « révolution de velours », VACLAV HAVEL devient Chef de l’Etat en décembre 1989. Toutefois, la Slovaquie, qui a subi plus que la Tchéquie les conséquences de l’ouverture à l’économie de marché et entend protéger sa spécificité culturelle qu’elle estime avoir été longtemps bafouée, fait sécession en 1992. Il est vrai que le chômage a touché presque 13% de la population active slovaque contre 4,4% seulement côté tchèque et que 80% des investissements étrangers vont vers la république tchèque.
-La RDA : organisation de l’opposition autour du Nouveau Forum appuyé par l’Eglise, tandis-que l’ouverture de la frontière hongroise à l’été 1989 déclenche un exode massif de la population. Lâché par Moscou, Honecker passe la main au libéral E.KRENZ. Les manifestations massives qui suivent déclenchent la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. D’abord bien accueillis à l’Ouest avec un pécule de 100 DM, les « Westies » seront ensuite touchés de plein fouet par le chômage consécutif à une réunification coûteuse et une réaction xénophobe à l’égard des « assistés » de l’Est en 1990. Par ricochet, réaction xénophobe à l’égard de la communauté turque (agressions et attentats de 1991-1993) et montée de l’extrême-droite (DVU-Deutsche Volksunion) aux élections régionales de 1992.
b-Transition difficile.
-Bulgarie : JIVKOV de 1955 à 1990. Ouverture à partir de 1989 avec l’accord de coopération franco-bulgare et la contestation du syndicat Podkrepa, mais aussi l’intervention de Gorbatchev. E.JELEV est élu Président de la république en août 1990.. En mai 1992, la Bulgarie entre au Conseil de l’Europe.
-L’éclatement de la Yougoslavie.
La mort de Tito en 1980 et l’échec des réformes économiques des années 1970 ont fait rejouer les divisions entre Croates de culture latine et Serbes d’obédience slave-orthodoxe, tandis-que se renforçait le clivage entre un Nord riche et un Sud pauvre et isolé. A partir de 1989, la nouvelle constitution serbe marque le retour du projet de Grande Serbie, face à la politique de préférence croate engagée par Tito au profit de sa région d’origine dès 1948.
Entre 1990et 1991, la Croatie, la Slovénie et la Bosnie proclament leur indépendance et quittent la fédération, réduite à la Serbie et au Monténégro. Servie par l’armée de l’ex-Yougoslavie, la Serbie tente de réduire par les armes l’autonomisme croate entre juillet 1991 et janvier 1992 (épisodes sanglants comme le siège de Vukovar). Reconnue par la CEE en janvier 1992 et protégée par l’intervention des forces de l’ONU, la Croatie peut imposer son autonomie.
S’appuyant sur la communauté serbe de Bosnie, la Serbie de SLOBODAN MILOSEVIC décide quelques mois plus tard d’entamer une politique de purification ethnique dans cette région. S’appuyant sur le plan de paix établi sous l’égide de l’ONU, Américains et Occidentaux n’interviennent pas.
-La « révolution roumaine » : mise en scène et chaos.
Des grèves de Brasov de novembre 1987 à la « manifestation » du 21 décembre 1989 en passant par la manifestation de Timisoara (16-17 décembre 1989) et son pseudo-massacre mis en scène de façon macabre, l’effondrement du pouvoir de Ceaucescu apparaît surtout comme un réglement de comptes entre factions rivales à la tête de l’Etat dont ION ILLESCU (ancien collaborateur du « conducator ») tire avantage pour propulser au pouvoir un « front de salut national » qui fait peu d’efforts pour sortir le pays d’un chaos économique et social total
-Un chaos où plonge aussi l’Albanie après la mort d’Enver Hodja en 1985. Ni R.Alia qui lui succède, ni son successeur S.Berisha depuis avril 1992, n’ont pu pérenniser le national-communisme(synthèse de traditions musulmanes et bysantines) dans un micro-état isolé du monde où un chômage touchant 50% de la population active jette à la mer des milliers de jeunes albanais à l’hiver 1991-1992.
A moins de 1000 km de Maastricht, des Balkans livrés aux rivalités inter-nationalistes gelées par un demi-siècle de glaciation communiste.
ACTUALISATION : La Russie depuis 1991 (source Wikipedia et Milza).
Les grandes phases [modifier]
Optimisme (1991-1996) [modifier]
Bill Clinton et Boris Eltsine, le 13 janvier 1994
Suite au démembrement de l'URSS, la volonté de rattacher la Russie au système économique mondial fut l'un des objectifs les plus flagrants du gouvernement de Boris Eltsine. Pour y parvenir, une stratégie de complaisance et de rapprochement avec l'Europe occidentale, et, surtout, les États-Unis est déployée : demande d'adhésion au Fonds monétaire international (FMI), à la Banque mondiale ou encore la coopération rapprochée avec l'OTAN, participation à la FORPRONU (Force de Protection des Nations unies) en ex-Yougoslavie, signature d'accords visant la réduction des armements et l'interdiction des armes chimiques.
Certains experts conjuguent cette période d'ouverture et d'optimisme avec la personnalité du ministre russe des Affaires étrangères de l'époque Andreï Kozyrev dont les objectifs sont le développement et la revitalisation d'une économie au bord de la faillite.
Incertitudes (1996-2001) [modifier]
Carte du Caucase du Nord.
Commencé en 1996, le second mandat de Boris Eltsine est marqué, sur le plan géostratégique, par une réduction de l'optimisme russe dans ses relations avec l'Occident. Evgueni Primakov, le successeur de Kozyrev, considère que les efforts d'apaisement et de rapprochement avec l'ancien adversaire n'ont pas permis de récolter les fruits escomptés. De manière générale, une ligne plus distante s'établit entre Moscou et Washington. Dans ce cadre, l'avancée de l'OTAN dans l'espace d'influence autrefois inféodé à Moscou est perçue comme une sorte de fer de lance antirusse. Avec la décision de l'OTAN d'intervenir militairement au Kosovo, les relations russo-américaines connaissent encore une période de froideur: annulation d'un voyage de Primakov (alors que celui-ci était déjà en route), fermeture du bureau de la représentation militaire russe auprès de l'OTAN à Bruxelles.
Dans un contexte de privatisations hâtives et d'inflation persistante sous l'ère Eltsine, la transition économique s'est finalement traduite par une quasi-division par deux du produit intérieur brut, entrainant une décrépitude militaire et politique de l'ancienne superpuissance majeure, avec le gel des grands investissements et des achats militaires. La campagne dévastatrice et épuisante économiquement de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996) a précipité le débâcle économique et a suscité de vives critiques en Occident ce qui a fragilisé encore plus la position géostratégique de la Russie. La dépression économique qui s'en suivit en 1998 a culminé avec une crise financière majeure, marquée par une dévaluation brutale du rouble et un endettement record.
L'arrivée de Vladimir Poutine, d'abord en tant que Premier Ministre, sur la scène politique russe s'insère dans la continuité d'une diplomatie crédible qui tente d'équilibrer un partenariat renforcé avec une fermeté retrouvée avec l'Occident. L'accession de Poutine à la présidence en 2000, renforcée par une spectaculaire reprise économique et le succès dans la seconde guerre de Tchétchénie, rendit possible l'élaboration d'une nouvelle doctrine militaire (avril 2000) dans laquelle le renforcement de l'appareil militaire russe doit servir les intérêts géostratégiques de l'État sans se préoccuper des considérations occidentales ("si les faits ne leur plaisent pas, tant pis pour eux"). Ce durcissement russe présageait, alors, qu'une entente entre les États-Unis et la Russie ne serait pas parfaite.
Retour en force (depuis 2001) [modifier]
L'attaque terroriste du 11 septembre 2001 a transformé la donne géostratégique pour la Russie et a donné une impulsion à l'établissement de relations plus rapprochées entre la Russie et les États-Unis. Le soutien de la Russie dans la lutte contre le terrorisme établit un climat d'authentique cordialité et de coopération ainsi qu'une véritable nouvelle alliance entre les deux puissances. Une perception pragmatique et réaliste des enjeux internationaux, tant du côté russe que du côté américain permet à la Russie de revenir en force sur la scène internationale en jouant un rôle prédominant dans la lutte contre le terrorisme ou dans les tentatives de médiation dans les conflits complexes comme les dossiers palestinien ou iranien.
Dans un autre ordre d'idées, la crise financière de 1998 en Russie lui a été salutaire, en ce sens qu'elle a permis à l'appareil de production de redevenir compétitif et de se remettre en marche. La hausse des prix du pétrole et les réformes économiques engagées par Vladimir Poutine à partir de 1999 ont favorisé également ce rebond. Entre 1999 et 2005, la Russie a connu une croissance économique moyenne supérieure à 6%. Depuis quelques années, le complexe militaire se redresse, grâce aux entrées des nouvelles générations des armements et des achats massifs et structurés. L'opinion publique russe est fortement favorable aux réformes économiques et politiques de Poutine ce qui lui procure une vaste marge de manœuvre à l'intérieur du pays, y compris en ce qui concerne la possibilité d'exercer une ingérence directe dans le fonctionnement des géants économiques russes.
Aujourd'hui, la géostratégie russe ne peut s'appréhender sans concevoir l'importance grandissante du secteur énergétique (gaz et pétrole) en termes économiques depuis 2001, période où débute la hausse fulgurante des prix des hydrocarbures dans le monde. En effet, la Russie est le premier producteur mondial (environ 600 milliards de mètres cube) et le premier exportateur mondial (environ 200 milliards de mètres cube) de gaz et le 2e producteur mondial et exportateur majeur du pétrole. Ses réserves gazières s'élèvent à plus de 23% de réserves mondiales. Compte tenu de sa situation géographique, la Russie est le premier fournisseur de l'Union européenne (30% du gaz consommé) dont la demande est en constante progression. Avec son contrôle des hydrocarbures, la Russie détient actuellement une position géopolitique inégalée par laquelle elle tente de renforcer sa place d'acteur majeur dans le « Grand Jeu » des superpuissances (Voir : Gazprom et Géopolitique du pétrole).
Mais les secteurs énergétique et militaire ne sont plus les seuls fers de lance des stratèges russes pour regagner du terrain dans le monde, d'autres secteurs économiques qui ont le vent en poupe (acier, aérospatiale, agro-alimentaire, etc.) prennent graduellement la relève. Les banques russes se montrent également de plus en plus friandes d'achats d'actifs en Occident (l'acquisition de 5 % des actions du groupe aéronautique européen EADS par la Vneshtorgbank russe en est un exemple).
Le monde selon la doctrine diplomatique russe [modifier]
La doctrine militaire et géostratégique russe divise le monde en deux catégories distinctes : l'étranger rapproché (les anciennes républiques soviétiques) et l'étranger éloigné (le reste du monde).
Les anciennes républiques de la défunte URSS, surtout celles membres de la Communauté des États Indépendants, occupent une place centrale dans la reconstruction de la politique internationale russe. Le but primordial de la nouvelle doctrine géostratégique russe relève d'une tentative de reconquête de l'influence prédominante dans cet espace géopolitique, depuis toujours considéré comme une zone d' « intérêt vital », ainsi qu'une limitation de l'influence de l'OTAN, par laquelle d'autres puissances ont pu créer des liens plus ou moins forts avec d'anciens alliés russes: les États-Unis et l'Union européenne d'une part, concurrents dans une défense de leurs intérêts politico-économiques, et l'Islam, d'autre part, force d'influence politico-religieuse essayant à opérer un retour au sein des sociétés de l'Asie Centrale et de l'Azerbaïdjan.
Ce tableau présente la liste des Présidents de la Russie depuis la création de la Fédération de Russie en 1991.
Nom | Début de mandat | Fin de mandat | Note |
déstitué le 22 septembre 1993 | |||
illégitime[1] | |||
remis dans ses fonctions le 4/10/93 | |||
Pour la stratégie globale de la Russie, voir ma conclusion dans mon travail sur « Une bipolarisation du monde depuis 1917 ». La Russie cherche à préserver son empire méridional (Caucase) et oriental (Asie centrale) en usant de l’arme gazière et du chantage politique (Ukraine, Georgie) ou de la guerre pure et simple (Tchétchénie). Elle doit prendre vitesse les USA qui « sponsorisent » tous les mouvements nationaux-libéraux de la région (cf « Bipolarisation… »). Comme en Chine, usage d’une rhétorique national-bolchevique et d’une rhétorique « libérale » au gré des intérêts des groupes politico-financiers au pouvoir. Khordokovsky, ancien Président du groupe privé IOUKOS, aujourd’hui au Goulag, en a fait les frais. Selon les sensibilités et les interprétations, on peut considérer POUTINE comme un autocrate national-communiste ordinaire ou comme l’homme de la transition musclée vers une démocratie à venir (thèse de l’ancien chancelier allemand SCHRÖDER, mais il est…Président de GAZPROM pour l’Allemagne !.









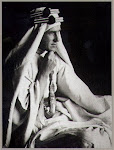
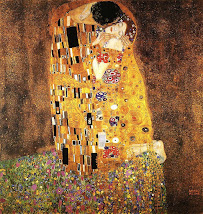


1 commentaire:
Bonjour M. Milza
Je me permets de vous contacter, en espérant obtenir une réponse le plus rapidement possible. J'ai été élève à la prépa ISTH durant les 3 semaines de juin 2008. Ayant présenté la plupart des concours sciences politiques de l'année (première et seconde années), j'ai été reçue en seconde année à Sciences Po grenoble. Lors de la consultation des résultats de sciences po bordeaux, je n'étais pas sur la liste. Cependant, en regardant mes notes, j'en avais qu'une sur trois. Depuis deux jours, nous essayons de contacter la plupart des services administratifs que nous pouvons trouver. Seulement, nous obtenons aucune indication : mes copies semblent égarées et on ne pourra essayer de les retrouver que fin août. Je me tourne vers vous, si jamais vous pourriez m'expliquer ce que je dois faire, et si vous connaissiez quelqu'un qui pourrait m'aider...
je vous en remercie chaleureusement par avance.
Cordialement,
Je joins mon mail pour que vous puissiez me répondre :
alexandramanches@hotmail.fr
Alexandra Manchés
Enregistrer un commentaire