
THOMAS-EDWARD LAWRENCE


TOME II/ L’IMPERIALISME.
L’impérialisme est né du colonialisme et a pour cause l’inadéquation du système de l’Etat-nation aux évolutions économiques de la fin du XIX° siècle. Le combat entre fascisme et communisme, puis l’abandon des colonies par les empires eux-mêmes débouchent sur la guerre froide dont la détente n’est due qu’à la montée en puissance d’un troisième larron, la Chine. Les USA reprennent le flambeau de l’expansion outre-mer et l’URSS celui de l’expansion continentale. Mais aujourd’hui, l’impérialisme procède à partir de « l’aide » à des Etats-clients faisant parti de « l’Empire », d’où l’importance des services secrets, en particulier depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En 1957, ALLAN DULLES déclarait que la CIA devait imiter les services de sécurité de l’Etat soviétique qui étaient un instrument de « subversion, de manipulation et de violence, qui permet d’intervenir secrètement dans les affaires des autres pays ». Les politiques d’aide au développement placent les pays récepteurs dans une situation de dépendance à l’égard des pays riches.
Le livre traite de l’impérialisme colonial européen, né de la décomposition de l’Etat-nation, débouchant sur le totalitarisme : « Avant l’ère impérialiste, ce qu’on appelle une politique mondiale n’existait pas ; sans elle, la prétention totalitaire à la domination de la terre n’aurait eu aucun sens ». (H.A.). L’Auteur veut mettre en parallèle l’impérialisme des années 1960, contemporain de la rédaction de l’ouvrage et celui de la fin du XIX° siècle, sans pour autant affirmer qu’il débouchera automatiquement sur de nouveaux totalitarismes.
I.L’EMANCIPATION POLITIQUE DE LA BOURGEOISIE.
1.L’expansion et l’Etat-nation.
En pleine expansion coloniale, des hommes comme Gladstone en Angleterre ou Clémenceau en France critiquent l’impérialisme considéré comme un dissolvant du lien national. Cette réaction « provincialiste » part de la conception que RENAN se fait de la nation, née d’un « consentement véritable, (d’un) désir de vivre ensemble, la volonté de préserver dignement l’héritage intact qui a été transmis » (« Qu’est-ce qu’une nation », 1882). Mais l’expansion, loin de découler de considérations politiques, procède de la croissance de l’économie marchande et de l’élargissement constant des marchés. L’impérialisme apparaît quand la classe dirigeante s’insurge contre les limitations nationales de l’expansion et cherche à imposer aux gouvernements l’idée de l’expansion comme but final de la politique étrangère.
Le problème essentiel des empires du type anglais ou français est que, précisément, ils n’installent pas un « empire » au sens romain du terme (alignement des peuples conquis sur le droit romain) mais assimilent les indigènes en les minorisant, provoquant une réaction indépendantiste plus ou moins violente : « A la différence des authentiques structures d’empire où les institutions de la métropole sont diversement intégrées dans l’empire, l’impérialisme présente cette caractéristique que les institutions nationales y demeurent distinctes de l’administration coloniale, tout en ayant le pouvoir d’exercer un contrôle sur celle-ci ».
2. Le pouvoir et la bourgeoisie.
D’abord les financiers juifs ouvrent la voie en plaçant les capitaux en surplus sur des marchés internationaux. Leur rôle est ensuite relayé par celui de la bourgeoisie gouvernementale : cas de CECIL RHODES en Afrique du Sud et des dirigeants de SIEMENS et de la DEUTSCHE BANK au moment du financement du Bagdadbahn en Allemagne. On exporte l’argent, puis le pouvoir, et « c’est seulement quand l’argent exporté eut réussi à provoquer l’exportation du pouvoir qu’il put accomplir les desseins de ceux qui le détenaient » et « le concept impérialiste d’expansion, selon lequel l’expansion est une fin en soi et non un moyen temporaire, fit son apparition dans la pensée politique lorsqu’il fut devenu manifeste que l’une des fonctions permanentes les plus importantes de l’Etat-nation allait être l’expansion du pouvoir ».(H.A.). L’impérialisme est le premier stade de la prise de pouvoir bourgeoise et non le stade suprême du capitalisme. Violence et pouvoir sont revendiqués comme l’essence même du politique et l’homme n’est rien (liberté, Raison…) en dehors de « sa valeur ou…son prix ; c’est-à-dire la somme correspondant à l’usage de son pouvoir » (HOBBES ; « Léviathan », 1651) La seule raison d’être de l’Etat est de contrôler et de canaliser les intérêts individuels, seules motivations desdits individus. Accumulation de richesses et accumulation de pouvoir sont donc indissociables dans la « République » moderne ; chez HOBBES, République et tyrannie signifient la même chose et au fonds, selon Arendt, Les révolutions du XVIII° siècle n’ont fait qu’affubler d’un costume idéologique (Raison, représentation,liberté…) une volonté de puissance inextinguible débouchant, vu l’aspect fini de la planète, sur une volonté de destruction.
3.L’alliance de la populace et du capital.
A partir des années 1880, la surchauffe capitalistique aboutit à une surépargne et une accumulation de capital en recherche de nouveaux débouchés afin de sortir des dépressions des années 1860 et 1870. On peut alors expliquer l’impérialisme comme le résultat de cette surépargne et de la distribution inégalitaire (JOHN ATKINSON HOBSON, « Imperialism »), comme le résultat de la surproduction et du besoin de nouveaux marchés qui en découle(LENINE, « Impérialisme stade suprême du capitalisme » de 1917), comme le résultat de la pénurie de matières premières (CARLTON J.H.HAYES, « A Generation of Materialism , 1871-1900 »), comme une exportation du capital destinée à égaliser le taux de profit national (RUDOLF HILFERDING, « Das Finanzkapital …) ou comme « l’expression politique de l’accumulation du capital dans sa course pour s’emparer des restes du monde non capitaliste » (ROSA LUXEMBURG ; « Die Akkumulation des Kapitals…).
D’abord hostiles à l’Etat et à son absolutisme mercantile (XVIII°) les bourgeois impérialistes demandent plus d’Etat afin de protéger leurs investissements. Ils déploient leurs activités dans des terres lointaines qui accueillent la lie des pays développés venue travailler pour le compte des premiers. Cas de l’Afrique du Sud à la fin du XIX° siècle où « les détenteurs de la richesse superflue étaient les seuls hommes susceptibles de se servir des hommes superflus accourant des quatre coins de la planète » (H.A.).A noter que le libre-échangisme est colonisateur et qu’en Angleterre comme en Allemagne, ce sont les libéraux et non les conservateurs qui prônent l’impérialisme. Obnublilés par la vulgate marxiste refoulant toute idée d’alliance entre le capital et le travail, les socialistes passèrent devant l’alliance objective entre le « lumpen-proletariat » et les impérialistes. La contradiction entre nationalisme et impérialisme fut transcendée quand l’idée (vécue comme une « aventure ») d’assujettissement de « races » inférieures offrit une amplification du concept d’unité nationale, provoquant par la même l’opposition des nationalistes traditionnels. L’administration découvrit que « le génie particulier d’une nation ne se dévoile jamais plus clairement que dans sa manière de traiter les races assujetties » (Sir HESKETH BELL).
A cet égard, la pensée de HOBBES, en détachant la politique étrangère de toute humanité en en faisant la lutte de tous contre tous annonce la conception « racialiste » d’une Histoire considérée comme la guerre perpétuelle entre « tribus » dominantes et dominées. Contrairement à ce que pensent les théoriciens de cette conception aryenne de l’Histoire, « la race est, politiquement parlant, non pas le début de l’humanité mais sa fin, non pas l’origine des peuples mais leur déchéance, non pas la naissance naturelle de l’homme mais sa mort contre nature » (H.A.).
II. LA PENSEE RACIALE AVANT LE RACISME.
L’hitlérisme a d’autant plus séduit dans les années 1930 que le racisme, devenu doctrine d’Etat en Allemagne, était déjà fortement ancré en Europe.
La pensée raciale prend son essor dès le XVIII° siècle mais s’impose à la fin du siècle suivant avec l’émergence de la pensée impérialiste qui cherche une « vision du monde » raciale pour justifier ses idées. La science vient à son secours, proposant une multitude de « théories » racialistes, comme celle de BROCA déduisant le contenu du cerveau de la taille du crâne ! Au fonds deux conceptions vont s’affronter : celle pour qui l’Histoire est l’histoire de la lutte des classes et celle pour qui elle résulte de la lutte des races.
1. Une « race » d’aristocrates contre une « nation » de citoyens.
Au XVIII°, la France découvre les peuples lointains dont elle loue la simplicité face à la sophistication des sociétés occidentales. La Révolution française libère avec enthousiasme les « nouveaux spécimens de l’humanité » (HERDER) afin de prouver que la « raison est de tous les climats » (LA BRUYERE).
Pourtant, dès cette époque, les thèses raciales fleurissent, telles celles du comte de BOULAINVILLIERS, qui, cherchant à discréditer le tiers-Etat, cherche des origines germaniques supérieures à l’aristocratie. Si les Francs sont supérieurs aux gaulois, malgré leur infériorité numérique, c’est que la force (de la conquête) fait droit à ses yeux à partir de sa lecture de SPINOZA. Il y a donc une solidarité des classes supérieures au-dessus des solidarités « nationales », idée antinationale qui animera les émigrés de la Révolution cherchant à créer une « internationale » des aristocraties européennes. Parmi ces émigrés, MONTLOSIER exprimait son pour les Français, ce « nouveau peuple né d’esclaves…mélange de toutes les races et de tous les temps ». A cette revendication tribale de la noblesse, les hommes du Tiers-Etat opposaient leur revendication historique d’être les héritiers de la République romaine. De ce fait, le germanisme nobiliaire ne déclencha pas en retour un « latinisme » racial. Reste que c’est en France que l’idée de supériorité germanique va perdurer, chez AUGUSTIN THIERRY en 1840 puis chez GOBINEAU qui va en faire une doctrine historique à part entière.
2. L’unité de race comme substitut à l’émancipation nationale.
En Allemagne, la pensée raciale se développe à partir de la défaite française face à Napoléon en 1806. Animée par une vision romantique, elle cherche, à la différence du cas français, à unifier le peuple contre une domination étrangère et non à faire éclater la nation. Or cette pensée ne pouvait pas s’appuyer sur une noblesse fermée et cosmopolite qui, par ailleurs, respectait la monarchie de Frédéric II et ne craignait pas l’ascension bourgeoise. La pensée raciale allemande est en plus liée à la fondation de l’unité allemande donc au nationalisme ; elle se développe « à l’extérieur de la noblesse et comme l’arme de certains nationalistes qui, désireux de faire l’union de tous les peuples de langue allemande, insistaient sur l’idée d’une origine commune ». (H.A.). Faute de pouvoir toutefois réaliser cette unité nationale, des libéraux nationalistes comme ERNST MORITZ ARNDT font alors appel à l’instinct tribal pour affirmer la pureté de la race allemande dans une doctrine historique organique.
De son côté, le romantisme allemand ajoute le culte de l’individu, de sa subjectivité et de sa liberté absolue à bâtir sa propre idéologie, attitude qu’un MUSSOLINI poussera au maximum, se décrivant à la fois comme « aristocrate et démocrate, révolutionnaire et réactionnaire, prolétaire et antiprolétaire, pacifiste et antipacifiste ».
« Cette insistance sur une origine tribale commune comme condition essentielle de l’identité nationale, formulée par les nationalistes allemands pendant et après la guerre de 1814, et l’accent mis par les romantiques sur la personnalité innée et la noblesse naturelle, ont intellectuellement préparé le terrain à la pensée raciale en Allemagne . L’une a donné naissance à la doctrine organique de l’histoire et de ses lois naturelles ; de l’autre naquit à la fin du siècle ce pantin grotesque, le surhomme, dont la destinée naturelle est de gouverner le monde »(H.A.). Pourtant, c’est d’abord en France que le racisme va ainsi se constituer en idéologie.
3. La nouvelle clef de l’histoire.
En 1853, le comte de GOBINEAU publie son « Essai sur l’inégalité des races humaines » qui mettra 50 ans à devenir le modèle des théories raciales de l’histoire.
L’auteur cherche à trouver une loi unique de déclin des civilisations. Allant plus loin que SPENGLER qui prévoit le déclin du seul Occident, Gobineau entrevoit la fin de la race humaine à partir de la décadence des noblesses. Son succès à la fin du XIX° siècle s’explique par cette explication raciale de la chute des civilisations détruites à ses yeux par le sang mêlé. Il refuse donc après 1871 de faire allégeance au peuple français, ni au peuple anglais mais au peuple allemand, issu d’une race supérieure. Il est vrai que TAINE lui-même croyait fermement au génie supérieur de la « nation germanique » et RENAN semble avoir été le premier, dans son « Histoire générale et système comparé des langues sémitiques », publié en 1863, à opposer les « Sémites » aux « Aryens », en une « division du genre humain » décisive
4. Les « droits des Anglais » contre les droits des hommes.
La pensée raciale anglaise, assez proche de son homologue allemande puisqu’autant les deux pays ont eu à en découdre avec les adeptes de l’Egalité, part de BURKE (« Réflexions sur la Révolution de France, 1790), chantre de la contre-révolution et reste en conformité avec les conceptions nationales britanniques, en particulier l’idée que la Constitution anglaise relève d’un héritage inaliénable et non d’un quelconque concept de « droits de l’homme ». Le nationalisme anglais enveloppe les vieilles classes féodales et la bourgeoisie en un même ensemble depuis le XVII° siècle ; un homme du commun peut atteindre à la position de lord. Les concepts féodaux continueront donc à influencer les classes inférieures, composant cet « héritage » qui, selon Arendt, trouve son équivalent moderne dans celui d « eugénisme ». En France et en Allemagne, on est émerveillé depuis le XVIII° siècle par la diversité des hommes, mais on croyait « à la diversité des races, mais à l’unité de l’espèce humaine » (TOCQUEVILLE) et HERDER avait refusé d’appliquer « l’ignoble mot » de race aux hommes. En Angleterre, on se réfugie au contraire dans le polygénisme, affirmation de la différence absolue des hommes et de leur impossibilité à se comprendre. Plus tard, le DARWINISME postule l’existence de races inférieures mais qu’au fond, seules des différences de degré séparent l’homme de la bête. On peut donc se servir de cette théorie aussi bien pour justifier la discrimination que pour la critiquer. Dans les années 1870-1880, le darwinisme est aux mains des utilitaristes anticolonialistes, tel HERBERT SPENCER qui pense que la sélection naturelle profitera à l’évolution de l’humanité. Mais par la suite, le concept d’adaptation des « meilleurs » va nourrir un eugénisme à partir de l’idée d’une sélection « naturelle » que l’on peut utiliser artificiellement. « Cette conséquence virtuelle d’un eugénisme appliqué triompha dans l’Allemagne des années 20 comme réaction au Déclin de l’Occident de Spengler » (H.A.). On cherche à créer une élite aristocratique par sélection eugénique et le discours politique prend des aspects « biologiques » comme en témoignent par exemple « A Biological view of Our Foreign Policy » de CHARLES MICHEL en 1896 ou « The Biology of British Politics » de CHARLES H. HARVEY en 1904. DISRAELI pourra alors écrire : « L’Anglais est le Surhomme de l’histoire et l’Angleterre est l’histoire de son évolution ». En Angleterre, ces conceptions, au cœur du nationalisme, sont véhiculées par les classes moyennes qui entendaient se démarquer de la noblesse par une pensée raciale. Elles sont au cœur de l’impérialisme, soudé selon DILKE (« Greater Britain, 1869) par une « saxonité » qui relie l’Angleterre à ses colonies, anciennes (USA) et nouvelles. Dans « Expansion of England » (1883), J.R.SEELEY écrit : « Quand nous aurons pris l’habitude de contempler dans son ensemble l’Empire et que nous l’appellerons tout entier l’Angleterre, nous verrons que là aussi il s’agit d’Etats-Unis ». Mais ce qui distingue ces conceptions des théories raciales ultérieures, c’est qu’elles ne prônent pas pour autant la discrimination entre les peuples. Elles auraient sans doute reflué si la « mêlée pour l’Afrique » et l’ère nouvelle de l’impérialisme ne les avaient pas ravivées.
III. RACE ET BUREAUCRATIE.
Le concept de race est forgé pour l’Afrique et ses populations « étranges » et bientôt « monstrueuses » qu’il s’agit d’exterminer, à l’image de ce Sud-Est africain allemand dont la population passe de 20 à 40 millions d’individus à 8 millions ou du Congo de Léopold II de Belgique qui passe de 20 à 40 millions d’habitants en 1890 à 8,5 millions en 1911. Parallèlement, la bureaucratie organise une expansion où chaque région devient le tremplin pour de nouveaux engagements, chaque peuple un instrument pour de nouvelles conquêtes. Les « massacres administratifs » en Egypte ou en Afrique du Sud cherchent à instaurer une communauté politique restreinte et rationnelle qui préfigure les camps d’extermination nazis.
1. Le monde fantôme du continent noir.
Un monde où, dans un premier temps, gentlemen perdus et âmes errantes, vagabonds et désespérés se côtoient au « cœur des ténèbres » (JOSEPH CONRAD) et d’une aventure extraordinaire et dérisoire. On songe au « Lord Jim » du même Conrad, en quête de rédemption, ou à une autre héros conradien, Almayer qui, privé de tout repère, et pour avoir cherché cette perte de repères, sombre dans la folie (« La folie Almayer »).(nota : les livres de CONRAD sont republiés dans la collection « Autrement » et ont surtout pour cadre les mondes malais et indonésiens. « Au cœur des ténèbres » a pour toile de fond l’Afrique et a été adapté au cinéma par F.F.COPPOLA sous le titre « Apocalypse now ». Sur l « aventure » humaine que fut – aussi – la colonisation, voir également RUDYARD KIPLING et en particulier « L’homme qui voulut être roi », adapté à l’écran par JOHN HUSTON sous le même titre. DE CADENET.). Privés de repères, les aventuriers coloniaux se retrouvent face à des hommes dont ils ne comprennent pas les repères mais dont ils devinent et refusent la parenté avec eux-mêmes : « Ils hurlaient et bondissaient, et tournoyaient et faisaient d’horribles grimaces ; mais ce qui vous faisait frémir, c’était précisément l’idée de leur humanité- semblable à la vôtre- la pensée de votre lointaine parenté avec ce tumulte effréné et passionné » (CONRAD, « Au cœur des ténèbres »).
Avec la ruée en Afrique, on passe de l’aventure individuelle à la conquête collective, inaugurée par les BOERS d’Afrique du Sud, Hollandais venus au XVII° siècle pour créer des comptoirs de ravitaillement pour les bateaux faisant route vers les Indes et qui, à partir du XVIII°, se lancent dans l’agriculture extensive au milieu de pasteurs nomades noirs qu’ils réduisent bientôt en esclavage, des hommes totalement immergés dans le monde naturel au point qu’en les massacrant on ne semble pas commettre un pêché ! D’autant que les indigènes eux-mêmes se massacraient entre eux, même quand le roi CHAKA rassembla au début du XIX° siècle les tribus zouloues dans une organisation militaire mais ne put instaurer ni un peuple ni une nation zoulou et ne réussit qu’à exterminer plus d’un million de membres issus de tribus plus faibles. Les BOERS, ne pouvant éviter l’évidence de l’humanité des Noirs se constituent en race « élue de Dieu », refusant par là l’idée d’égalité des hommes transmise par les missionnaires catholiques. « Ils n’avaient que leurs fermes, leurs bibles et leur sang pour marquer leur profonde différence face à l’indigène et à l’uitlander » (W.DE KIEWIET, « A History of South Africa, Social and Economic »). Mais en fuyant par la suite l’administration britannique qui souhaitait sédentariser la colonisation, ils se lancent dans le grand TREK ( remontée vers le nord étape (trek) par étape), errance nomade hostile à toute implantation agricole intensive, à l’image de ces Noirs qu’ils méprisaient tant !! Pour H.A., « le racisme…est toujours étroitement lié au mépris du labeur, à la haine des limitations territoriales, à un déracinement général et à une croyance indéfectible en sa propre élection divine » (Nota de Cadenet : à rapprocher des relations conflictuelles entre Indiens et pionniers de l’Ouest dans l’Amérique de la Conquête).
2. L’or et la race.
Des financiers juifs arrivent comme intermédiaires en Afrique du Sud pour permettre au capital européen d’investir dans les mines d’or ou de diamant, exploitées par une main d’œuvre noire. Les Boers fuirent une nouvelle fois pour éviter le processus d’industrialisation qui pointait à l’horizon, sans comprendre que l’or et le diamant demeuraient indépendants des méthodes rationnelles de production. Plus que le commerce extérieur, l’investissement est au cœur de l’impérialisme et la croissance du second est supérieur à celle du premier. En 1889, l’ensemble du commerce extérieur et commercial de la Grande-Bretagne lui a rapporté 18 millions de livres contre 90 à 100 millions pour les profits tirés de l’investissement à l’étranger.Cet investissement est le fait de financiers juifs venus d’Europe centrale et ayant rejoint vers 1870-1880 les capitales européennes où les familles juives plus anciennes sont trop heureuses de les voir partir outremer. Ils nourrissent chez les Boers une haine suscitée par leurs ramifications internationales, leur « statut » de race différente introduisant un principe « diabolique » dans le monde des « Noirs » et des « Blancs ». Entre eux et les Boers, il y eut un conflit pour le statut de « peuple élu ». Dès que l’or et le diamant eut atteint un stade impérialiste de développement, les Juifs devinrent superflus et recherchèrent un nouveau statut en se faisant admettre dans les clubs britanniques très fermés. C’est ainsi que l’homme d’affaires juif BARNATO céda ses parts de la Barnato Diamond Trust à CECIL RHODES, préseident de la DE BEERS, afin de gagner la respectabilité ! Pour H.A., La ruée vers l’or ne devint une véritable entreprise impérialiste qu’après que Cecil Rhodes eut dépossédé les Juifs, pris en main la politique d’investissement de l’Angleterre et qu’il fut devenu le personnage central du Cap. ». Avec lui, l’Angleterre développa essentiellement l’exploitation des mines d’or, au détriment des industries dites « secondaires » (exploitations d’autres ressources minières, industries de consommation,etc.) que les Juifs prirent en charge, provoquant leur rejet d’une société boer hostile à l’industrialisme progressivement égalitaire. Rhodes introduisit le facteur qui pouvait le mieux apaiser les Boers : « décourager toute entreprise industrielle représentait la garantie la plus solide contre le risque d’assister à une développement capitaliste normal, donc contre la fin logique d’une société raciale » (H.A.). En effet les Boers sacrifièrent le profit pour privilégier le racial, en particulier en remplaçant, dans les chemins de fer où les administrations municipales, les Noirs par des Blancs touchant des salaires jusqu’à 200 fois supérieurs !!
Le cas sud-africain appris aux futurs gouvernements totalitaires que le profit n’est pas un principe sacré, qu’une société peut fonctionner avec un autre moteur, que la violence peut faire l’économie d’une révolution quand il s’agit, pour la populace, de créer une classe encore plus basse en s’associant avec certains groupes des classes dominantes et que les peuples étrangers ou sous-développés offrent un terrain idéal pour une telle stratégie.
Les nazis y puisèrent l’idée qu’on pouvait s’élever au rand de race maîtresse en se « rabaissant » au plan tribal afin de demeurer son propre maître. Comme les Boers, les nazis « étaient tout à fait prêts à payer le prix, à régresser au niveau d’une organisation de race, pourvu que cela leur permît d’acheter leur suzeraineté sur d’autres « races ».
3. L’impérialiste.
Pour Arendt, la domination impérialiste repose sur la race et l’administration. La colonisation s’étant faite selon elle par inadvertance, il faut bâtir a posteriori une « légende » de l’impérialisme pour en justifier l’action. Côté anglais, la légende est façonnée par KIPLING, pour qui l’Anglais, dépositaire des « Quatre Dons – un pour la Mer, un pour le Vent, un pour le Soleil et un pour le Navire qui nous porte » (« Le Premier Navigateur » in Humorous Tales, 1891) est le peuple qui porte sur ses épaules le salut du monde. Certains anglais cherchèrent sincèrement à apporter les lumières de la civilisation aux « indigènes », avec la complicité de l’Etat britannique lui-même trop content d’empêcher cette jeunesse des « public schools » de transposer en Angleterre leur idéal d’adolescence en idées d’homme mûrs.
Reste que, une fois en poste, les administrateurs coloniaux, fonctionnalistes comme Lord CROMER, consul général britannique en Egypte de 1883 à 1907 –l’Egypte protège l’Inde- ou réalistes comme CECIL RHODES – « l’expansion, tout est là- renoncent à « l’intérêt personnel des races assujetties » au profit des seuls intérêts de la couronne britannique. Ils administrèrent avec détachement et intégrité, ce qui, paradoxalement, en se démarquant de la corruption et de l’oppression où oppresseur et opprimé, corrupteur et corrompu appartiennent encore à une univers commun, déshumanise le lien entre colonisateur et colonisé, le premier dominant à partir de sa seule conviction de supériorité raciale et civilisationnelle.
Le bon administrateur fonctionne à partir d’une « influence personnelle » (Lord CROMER) plus que d’une politique clairement définie ; il doit rester dans l’ombre et se sentir à l’abri de tout contrôle, donc au-delà de la louange ou du blâme, dans la mesure où la bureaucratie est toujours un gouvernement d’experts, une « minorité avertie » qui doit résister tant qu’elle peut à la pression constante de la « majorité non avertie ». De plus, les bureaucrates doivent se garder de toute idée générale en matière de politique ; leur patriotisme ne doit en aucun cas les égarer au point de leur faire croire à quelque bien-fondé intrinsèque des principes politiques de leur propre pays ; cela n’aboutirait qu’à une mauvaise application « imitative » de leur part « au gouvernement des populations arriérées », ce qui, selon CROMER, constituait le défaut majeur du système français. En 1899, si CROMER veut tenir loin des oreilles françaises la mise au point du modèle administratif prévu pour l’annexion du Soudan, c’est moins pour assurer à son pays le monopole de l’Afrique que parce qu’il avait « la plus profonde défiance à l’égard de la valeur de leur système administratif appliqué aux races assujetties ». L’objectif majeur de CECIL RHODES sera d’ailleurs moins la conquête d’un empire que l’expansion de la « race nordique » qui, organisée en société secrète, établirait un gouvernement bureaucratique régissant tous les peuples de la terre.
Il s’agit, pour le bureaucrate comme pour l’agent secret, les deux « héros » de l’impérialisme, de se confondre avec leur mission, de n’en être qu’un rouage. En jouant le Grand Jeu ( celui des services secrets), l’homme a le sentiment d’être dégagé de l’accessoire, des contingences sociales de la vie, pour accéder à un stade de pureté totale où l’absence de but fait le charme de l’existence. Si le « KIM » de Kipling s’engage dans le grand jeu, ce n’est pas pour soutenir l’Angleterre ou l’Inde, mais pour le jeu lui-même et le secret qui y est lié. Ces passionnés du Grand jeu poursuivent une soif de pureté que leurs patrons utilisent à des fins pragmatiques. Le modèle reste ici THOMAS EDWARD LAWRENCE (« Lawrence d’Arabie »), désireux de devenir agent secret pour échapper au triste monde de la respectabilité et au dégoût de lui-même et qu’attirait, dans la civilisation arabe, son « évangile du dénuement…qui semble aussi impliquer une sorte de dénuement moral » (dans « Letters » de T.E.LAWRENCE, 1939). Aussi accepta-t-il de devenir un fonctionnaire véritable entraîné dans le courant de la nécessité historique : « J’avais poussé mon chariot dans le sens du courant éternel, aussi allait-il plus vite que ceux que l’on pousse en travers ou à contre-courant. En fin de compte, je ne croyais pas au mouvement arabe : mais je le croyais nécessaire en son temps et lieu » ( « Letters »).
IV. L’IMPERIALISME CONTINENTAL : LES MOUVEMENTS ANNEXIONNISTES.
Nazisme et communisme ont une dette considérable à l’égard du pangermanisme et du panslavisme qui se développent à partir de 1870-1880 comme substituts à l’expansion outremer. Ernst HASSE, membre de la Ligue pangermaniste, proposait de traiter certaines nationalités (Polonais, Tchèques, Juifs,Italiens…) de la manière dont l’impérialisme colonial traitait les indigènes sur les continents non européens. Mais à la différence de l’impérialisme colonial, l’impérialisme continental postule l’existence éternelle d’un « Centre » racial qui agglomère des périphéries ; il procède d’une « conscience tribale élargie » aboutissant au fait qu’il n’y a aucune distance géographique entre les méthodes et les institutions de la colonie et de la nation. Les mouvements annexionnistes partagent une même passion pour les questions de politique étrangère, restent la plupart du temps en marge de la réflexion économique, d’où un recrutement chez les intellectuels et les professions libérales. En Autriche, le pangermanisme a commencé comme un mouvement étudiant et l’intelligentsia russe est majoritairement panslaviste. L’impérialisme colonial reste au dessus ou au-delà de l’Etat-nation (que son homologue colonial finit par revitaliser) et n’offre qu’une idéologie et un mouvement : « C’était pourtant assez pour une époque qui préférait une clef de l’Histoire à l’action politique – une époque où les hommes, pris dans la désintégration de la communauté et l’atomisation de la société, voulaient à tout prix faire partie de quelque chose » (H.A.). On peut par ailleurs remplacer la distinction peau noire/peau blanche par la distinction entre âme orientale et âme occidentale ou entre âme aryenne et non aryenne ! A la différence du nationalisme « intégral » d’un MAURRAS qui refuse qu’un individu d’origine française vivant à l’étranger soit « né français » par une sorte d’alchimie mystérieuse, le « nationalisme tribal » de l’impérialisme continental considère que l’âme particulière de chaque individu est l’incarnation de qualités nationales générales. Le « nationalisme tribal » se considère comme unique et environné d’ennemis incompatibles avec son « génie ».
1.Le nationalisme tribal.
C’est le nationalisme des peuples qui n’ont pas participé à l’émancipation nationale et n’ont pas réussi à atteindre la souveraineté de l’Etat-nation. Il est d’autant plus virulent dans les pays comme la Russie et l’Autriche-Hongrie qui développent aussi une politique annexionniste et où les Juifs vont apparaître comme les agents d’un appareil d’Etat oppressif et d’un oppresseur étranger. S’appuyant sur Marx, Hanna Arendt estime que dans les pays d’Europe centrale et orientale, l’instauration de l’Etat-nation avait échoué faute de classes paysannes fortement enracinées( NOTA DE CADENET : elle n’aborde pas l’intégration des Juifs dans l’Etat multiethnique et multinational austro-hongrois et oublie qu’en Europe orientale et centrale perdurait une conception « seigneuriale » des rapports paysans-aristocratie en deçà de la soumission à l’Etat considéré comme lointain. Voir ici le témoignage littéraire incontournable de l’écrivain hongrois transylvain M.BANFFY dont la grande trilogie a été publiée chez Phoebus)
Le problème de l’Etat-nation post-révolutionnaire ( en Europe occidentale et singulièrement en France) réside dans la disparition du roi comme ciment communautaire et remplacé par un intérêt national prétendument garanti par une origine commune et qui va trouver son expression sentimentale dans le nationalisme. A partir de la Révolution française, les droits de l’Homme se confondent avec ceux de la nation laquelle s’incarne dans l’Etat comme « représentation nébuleuse » d’une âme nationale. La souveraineté nationale perd sa connotation de liberté des peuples pour aboutir, via la notion de souveraineté, à un pouvoir arbitraire. « Le nationalisme traduit essentiellement cette perversion de l’Etat en instrument de la nation, et l’identification du citoyen au membre de cette nation …(Il) devient le précieux ciment capable de lier un Etat centralisé à une société atomisée, et il se révéla de fait le seul lien efficace, vivant, entre les individus de l’Etat-nation ». (H.A.).
Dans les pays d’Europe centrale et orientale, il n’y a ni pays ni Etat englobant, tout au plus une langue commune et un sentiment d’appartenance « tribale », une communauté de tradition sans ancrage historique fixe bref, une « âme commune ». C’est ainsi que les panslavistes considèrent le peuple russe comme « le vrai peuple divin des temps modernes » (selon TCHAADAÏEV dont les Philosophical Letters, 1829-1831,ont constitué la première tentative visant à concevoir l’histoire mondiale comme centrée autour de peuple russe). Les pangermanistes autrichiens se réclamaient eux aussi de l’élection divine même si, avec un même passé libéral que les panslavistes russes, ils demeuraient anticléricaux, voire antichrétiens. De fait quand Hitler, disciple de Schönerer (chef de file des pangermanistes à Vienne), déclare le 30 janvier 1945 : « Dieu Tout-Puissant a créé notre nation. Nous défendons Son œuvre en défendant son existence même », il fait écho à l’archevêque de Tambov pour qui « Les monstres allemands ne sont pas seulement nos ennemis, mais les ennemis de Dieu. ».
Tribalisme et racisme se démarquent de l’individualisme libéral tout autant que de la croyance en un « genre humain » solidaire et de la reconnaissance de « racines » communes à des peuples. D’où leur adoption par les totalitarismes, tant fasciste que bolchevik, ce dernier ayant lui-même adopté la plus grande des doctrines antinationales, le marxisme. Plus tard, les théories de Lyssenko sur l’hérédité des caractères acquis impliquent clairement que les populations vivant dans des conditions défavorables transmettent le patrimoine héréditaire le plus pauvre et vice versa, ce qui permet de justifier l’ascendant d’un maître inné sur des races assujetties.
Si le panslavisme russe et les pangermanismes allemand (STÖCKER) et autrichien (SCHÖNERER) virent vers l’antisémitisme dans le dernier quart du XIX° siècle, c’est qu’ils reconnaissent chez les Juifs une communauté tribale cimentée par le concept quasi racial (au sens de fondement par naissance) de peuple élu. La populace fut d’autant plus facilement instrumentalisée contre les Juifs qu’ils incarnaient une société capable, sans représentation visible ni issue politique normale, de devenir un substitut à la nation. De fait, « ce qui, plus que tout le reste plaçait les Juifs au centre de ces idéologies raciales, était dû au fait encore plus marquant que la prétention des mouvements annexionnistes à l’élection divine n’avait comme seule rivale sérieuse que celle des Juifs » (H.A.).A partir du « Protocole des sages de Sion » élaborés à Paris vers 1900 par des agents de la police secrète russe et sur la suggestion de POBIEDONOSTSEV, Hitler forgera saura exploiter le postulat antisémite affirmant l’existence d’un peuple qui serait « le pire » afin d’organiser « le meilleur », même si Staline fut le premier à découvrir toutes les potentialités de domination de la police. (Nota de Cadenet : très influencée par le marxisme à l’époque de rédaction et de parution des « Origines… », Arendt cherche ici à épargner Lénine. On sait aujourd’hui que l’essentiel de l’appareil répressif soviétique (Police politique, déportations, goulag…) a été élaboré entre 1917 et 1921, durant l’époque dite du « communisme de guerre ». Voir Le « Livre noir du communisme » de COURTOIS et Coll. Chez Bouquins, « Goulag » d’Anne Applebaum dont j’ai rendu compte dans GRANDES LECTURES et « Le passé d’une illusion » de FRANCOIS FURET.).
A partir du « Protocole… », la pensée annexionniste tribale convertit l’élection juive comme mythe d’une suprême réalisation de l’idéal d’humanité commune en volonté des destruction finale. Il faut donc détruire les Juifs avant qu’ils ne détruisent le monde !
(Nota de Cadenet : la création de l’Etat d’Israël, en aboutissant à l’utilisation de l’élection (concept religieux) à des fins nationalistes (le sionisme) pose évidemment un problème, en particulier pour les voisins arabes de l’Etat hébreu lesquels, de surcroît, n’ont rien à voir ou peu avec l’extermination des Juifs d’Europe, mais ceci est un autre débat !).
2. L’héritage au mépris de la loi.
H.A dénonce l’arbitraire des Etats d’Europe centrale dont l’autorité s’affirme par la bureaucratie au détriment des partis et des parlements. A ses yeux, l’aspect multinational est secondaire. Peu ou pas d’opposition, tant en Russie qu’en Autriche-Hongrie. On ne s’appuie pas sur la loi mais on agit par décrets. Reste que la différence entre ce vieux régime démocratique et le courant totalitaire moderne « réside dans le fait que les maîtres de la Russie et de l’Autriche d’avant-guerre se contentaient de l’éclat stérile de leur pouvoir et que, satisfaits de contrôler son destin extérieur, ils laissaient intacte toute la vie intérieure de l’âme. La bureaucratie totalitaire, forte de sa meilleure compréhension de la portée du pouvoir absolu, a fait intrusion chez l’individu privé et dans sa vie intérieure… » (H.A.). Reste que, paradoxalement, ces Etats autoritaires engendrent une culture profonde, nourrie du chaos intime des êtres et d’un sentiment de hasard et de providence. Côté austro-hongrois, KAFKA comprend la séduction qu’exercent l’irrationnel et les significations supra-humaines. De con côté, le chaos russe forge une atmosphère d’anarchie et de hasard inspirant une philosophie qui voit dans l’Accident le véritable Maître de la Vie. Littérairement, les panslavistes opposent la profondeur et la violence de la Russie à la banalité toute superficielle de l’Occident, futile et trivial. Le panslavisme « engendre une haine implacable de l’Occident, un culte morbide de tout ce qui est russe…La rédemption de l’univers est encore possible, mais elle ne peut se produire que par l’intermédiaire de la Russie… » (VICTOR BERARD, L’Empire russe et le tsarisme, 1905). Cet esprit anti-occidental a marqué l’Europe des années 1920 et préparé le terrain au totalitarisme.
(NOTA DE CADENET : ces développements donnent un relief tout particulier à l’attitude du nationalisme russe depuis Eltsine jusqu’à Poutine, mélange de pragmatisme à l’égard de l’Occident et de célébration de la puissance impériale retrouvée grâce…au gaz naturel et gazprom qui remplace le kominform comme métaphorisation de la puissance impériale. L’assassinat politique est redevenu une pratique courante dans une société privée de toute culture démocratique mais débordante de désespoir « constructif » et d’orgueil de « race »).
Dans le panslavisme en particulier, le Pouvoir est total parce-que sacré et le gouvernement est le « Pouvoir Suprême en action » (MIKHAÏL N. KATKOV). Le Peuple, convaincu de sa propre sainteté, se soumet à l’arbitraire d’un seul homme. Au contraire, le pangermanisme soumet l’individu au mouvement, préfigurant le mépris du nazisme à l’égard de ceux qui n’adhéraient pas au parti. Au yeux du panslavisme, chaque individu participe de l’âme slave et il faudra la cruauté de Staline pour introduire dans le bolchevisme un mépris du peuple russe analogue à celui que les nazis exprimèrent envers le peuple allemand.
3.Parti et mouvement.
Dans un contexte de discrédit de la vie politique,les mouvements annexionnistes se placent « au dessus des partis », prétendant n’être que des « mouvements ». Dans le système bipartisan anglais, l’alternance au pouvoir assure chaque parti de représenter le peuple et l’Etat et il n’y a d’ailleurs pas de différence entre ce dernier et le gouvernement. Sur le continent au contraire, le multipartisme exige que chaque parti respecte les autres dans la mesure où aucun d’eux ne peut prétendre représenter le tout. Dans un tel système, les membres du Cabinet sont choisis en fonction des alliances entre partis, non du fait de leurs compétences. Si un parti décide d’exercer le pouvoir à partir d’une majorité absolue, il peut choisir, comme les SD allemands ou autrichiens d’y renoncer pour ne pas encourir le reproche d’exercer une dictature. ( Nota de Cadenet : le livre est publié avant la Constitution française de 1958 qui a introduit une structure présidentialiste et le système majoritaire. Les critiques d’Arendt sont celles que l’on adresse traditionnellement aux institutions de la IV° République). Dans le système anglais, chacun de deux partis représente à tour de rôle l’intérêt général, ce qui les « vaccine » contre le risque de ne représenter, comme sur le continent que des intérêts catégoriels ou nettement idéologiques. Sur le continent, la fonction du nationalisme repose justement sur la transcendance des intérêts privés. Mais si, en Allemagne, l’Etat demeure au dessus des partis, la III° République française a liquidé l’Etat qui était au dessus des partis et du Parlement, sans réorganiser son système de partis en un corps capable de gouverner. « En France, les partis ont étouffé le gouvernement ; en Allemagne, l’Etat a émasculé les partis » (H.A.). Il arrive fatalement, dans un contexte d’affaiblissement des partis et d’antiparlementarisme que des mouvements se lèvent et prétendent se placer « au-dessus des partis » jusqu’à absorber l’Etat ; tel est le cas de l’Italie mussolinienne avant 1938 où le fascisme « n’était pas un gouvernement totalitaire, mais simplement une dictature nationaliste ordinaire développée logiquement à partir d’une démocratie multipartite. » (H.A.). L’Etat devait rester l’Etat et la Nation n’en était qu’une partie à l’instar des régimes autoritaires ibériques. L’exemple de l’armée est éclairant : en Italie, elle est fasciste mais demeure l’Armée ; dans l’Allemagne nazie ou dans la Russie soviétique, l’armée et l’Etat ne sont plus que des fonctions subalternes du mouvement.
En Autriche-Hongrie, la « haine de l’Etat » est alimentée par les nationalités ; facteur de cohésion en France, le nationalisme apparaît comme principe de démembrement interne dans la double monarchie. Comme au sein du futur nazisme, nul besoin de programme dans un tel mouvement pour rallier les masses : seul compte la permanence du mouvement lui-même. Arendt étaye son argumentation par une anecdote rapportée par NICOLAS BERDIAEV dans « Les Sources et le Sens du communisme russe » (1951) et mettant en scène un jeune soviétique critiquant le manque types de liberté qui laissent les choses inchangées ». Pour les nazis, l’époque de Weimar reste comme celle du « Systemzeit » (Le temps du système) à leurs yeux sans mouvement, sans dynamisme.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le système des partis décline au moment où le système de classes cède sous le poids de plus en plus lourd des masses déclassées par les événements. Les partis annexionnistes deviennent totalitaires, provoquant une réaction strictement négative, antifasciste ou antibolchevique. Ajouter à cela l’immigration qui remet en cause la cohésion de l’Etat-Nation, en crise, l’inflation et le chômage qui agissent de façon analogue en dissolvant le tissu social ou, après les traités de paix de 1919, le principe des nationalités en Europe centrale qui rend difficile la mise en place d’une autorité de l’Etat ! Arendt ne voit pas la différence entre la Marche sur Rome de 1922 et la prise de pouvoir légale, par la voie parlementaire, d’un « bloc des sans-partis » en Pologne, assemblage hétéroclite de nobles, de paysans et d’hommes d’affaires (1934). Munich (1938) achève de détruire la structure traditionnelle des partis politiques français sur la question allemande, comme en témoigne la division de la SFIO entre une minorité anti-munichoise derrière BLUM et une majorité pro-munichoise conduite par Marcel DEAT. Hitler n’aura plus qu’à choisir ses relais ! Le plus singulier reste le revirement de l’extrême-droite qui passe du nationalisme au pacifisme plus ou moins pro-allemand et celle des communistes qui troquent leur pacifisme contre un bellicisme anti-allemand, puis opèrent en 1941 une seconde volte-face tout aussi radicale ! Mais la destruction du système des partis prit tout son relief dans l’Allemagne des élections présidentielles de 1932 quand, face à Hitler et à Thälmann (KPD), les autres partis, désireux de maintenir le statut-quo, se regroupèrent derrière Hindenburg : « Hindenburg devint le symbole de l’Etat-nation et du système des partis, cependant que Hitler et Thälmann rivalisaient pour devenir le véritable symbole du peuple » (A.H.). Or le statut-quo, c’est le chômage, que l’on préfère voir disparaître même s’il entraîne avec lui les institutions démocratiques. D’où une « alliance » objective des nazis et des communistes dans la grève des transports de septembre 1932, au moment où les communistes votent la défiance à Von Papen, entraînant la dissolution du Reichstag et cherchent avant tout à déstabiliser les sociaux-démocrates. (Arendt fait ici référence à la tactique « classe contre classe » initiée par le Komintern et qui recommande aux communistes de réserver leurs coups les plus durs aux « partis bourgeois ». Elle ne sera abandonnée qu’après 1934 au profit de ta tactique des « fronts nationaux » (Espagne/ France 1936) – de Cadenet).
V. LE DECLIN DE L’ETAT-NATION ET LA FIN DES DROITS DE L’HOMME.
1914-1918 : une explosion qui en entraîne d’autres, inflation impossible à juguler, chômage global, guerres civiles jetant sur les routes des apatrides privés de droits ; « le moindre événement a pris l’inéluctabilité d’un jugement dernier ». Partout, derrière la fausse stabilité des années 1920, une haine qui dégrade la vie politique générale. L’effondrement de l’Empire russe et de l’Autriche-Hongrie « libère » les hostilités entre n ationalités (Slovaques contre Tchèques, Croates contre Serbes, Ukrainiens contre Polonais) qui font naître deux groupes plus désorientés que les chômeurs ou les rentiers ruinés : les apatrides et les minorités. Parmi eux les Juifs, considérés comme la lie de la terre par des régimes totalitaires qui misent sur la « lourdeur » de gestion de ces errants en Europe pour faire partager leur politique de dénationalisation, en particulier à partir de 1938.
1.La « nation des minorités » et les apatrides.
Il était utopique de penser qu’on allait créer des Etats-nations à partir de traités de paix et fonder ces entités sur le pouvoir confier à une nationalités au détriment des autres, qualifiées de « minorités », à charge pour les nouveaux Etats d’en gérer l’évolution ! Slovaques en Tchécoslovaquie ou Croates et Slovènes dans la jeune Yougoslavie ne peuvent que considérer les traités comme un jeu arbitraire qui libère les uns et asservit les autres, estimant qu’il existe des « peuples sans histoire ». On estime à 100 millions le nombre d’individus dont les aspirations nationales n’étaient pas satisfaites en 1914. En 1919, le « peuple d’Etat » tchèque ne représente que 50% de la population tchécoslovaque (7,2 millions de personnes) et les 5 millions de Serbes ne représentant que 42% de la population yougoslave ! Dès 1922, la SDN édicte d’ailleurs des textes sur les « devoirs des minorités » à l’égard des nouveaux Etats, indiquant par là même que ces derniers pratiquent une politique d’assimilation qui n’est pas sans affinités avec les méthodes de l’impérialisme colonial. Les nationalités sans états sont plus nombreuses que ces nouveaux Etats et peuvent faire prévaloir le « national » sur l’étatique, remettant en cause les traités de paix. Deux minorités sont particulièrement puissantes et transnationales : les Allemands et les Juifs ! Durant l’entre-deux-guerres, les Etats vont par ailleurs pratiquer, au hasard des révolutions et/ou des guerres civiles, à l’égard des « apatrides » une politique de dénationalisation qui annonce les pratiques totalitaires. Chronologiquement, des millions de Russes, des centaines de milliers d’Arméniens, des milliers de Hongrois,, des centaines de milliers d’Allemands et plus d’un demi-million d’Espagnols se retrouvèrent dans ce cas. A noter que l’Italie mussolinienne répugna au fond à traiter les réfugiés antifascistes de cette manière : sur le 40 000 membres de l’Unione Popolare Italiana en France, au moins 10 000 étaient d’authentiques réfugiés antifascistes, mais seuls 3000 d’entre eux se trouvaient sans passeports. De nombreux pays européens (Belgique, Portugal, Grèce, Italie…) prirent des mesures de dénaturalisation à l’égard de citoyens « suspects », avant que le camp d’internement ne devienne la norme au moment de la Seconde Guerre mondiale. En dehors des Russes et des Arméniens, on refusa de régulariser les apatrides afin de ne pas entrer dans un cycle incontrôlable. En 1938, la Roumanie annonçait la révision du statut de citoyenneté des Juifs roumains et en Pologne, le MAE, BECK, estimait qu’il y avait 1 million de Juifs en trop dans son pays !
De fait, les états « de droit », ne pouvant déporter les apatrides indésirables dans leurs pays d’origine, furent amenés à user de moyens policiers illégaux à leur encontre avant même toute dérive totalitaire. Aussi, « le seul substitut concret à une patrie inexistante était le camp d’internement ». Pour sortir de cet état de non droit, l’apatride a eux solutions : la délinquance qui le fait tomber sous le coup d’une…loi qui le reconnaît dans son délit, ou le génie qui vous place dans une sorte d’aristocratie intouchable. A noter que l « aristocratie » des camps se composera d’une majorité de criminels et de quelques « génies ». Durant l’entre-deux-guerres, la police reçut de fait le pouvoir, non plus seulement de faire respecter la loi, mais de contrôler directement les gens ; or, plus la proportion d’apatrides par rapport à la population totale augmentait, plus la police risquait de se transformer en police d’Etat. Dans l’Allemagne nazie, les lois de Nuremberg et leur distinction entre citoyens du Reich (citoyens à part entière) et nationaux (citoyens de deuxième classe privés de droits politiques) avaient ouvert la voie à un processus par lequel tous les nationaux de « sang étranger » pouvaient perdre leur nationalité par décret officiel. Les enfants trouvés sont considérés comme apatrides jusqu’à enquête sur leurs origines raciales. En fait, dans un tel système totalitaire, tout individu naît sans droits jusqu’à une conclusion différente !
Dans l’Europe des années trente, l’internement des apatrides devient une constante et un certain nombre de pays occidentaux, sous prétexte de « sécurité nationale », entretiennent des relations avec la Gestapo ou la Guépéou au point qu’Arendt parle d’une « politique étrangère de la police ». Autant d’éléments qui expliquent la collaboration harmonieuse de certaines polices occidentales avec les nazis à partir de la guerre !
La « minorité » par excellence sont les Juifs qui refusèrent d’ailleurs de se placer sous la protection du statut des minorités de leurs pays d’origine. Aux yeux de certains gouvernements d’ailleurs, apatridie et judéité se confondent, justifiant, comme en Allemagne, l’expatriation, puis la déportation. Arendt ajoute qu’après la guerre, la solution israélienne ne régla pas le problème des minorités, en faisant naître une nouvelle, celle des Arabes. Et de conclure : « Depuis les traités de paix de 1919 et 1920, réfugiés et apatrides sont, telle une malédiction, le lot de tous les nouveaux Etats qui ont été créés à l’image de l’Etat-nation ». Et dans tous les cas, la difficulté à gérer les apatrides débouche sur un renforcement des pouvoirs de la police.
2.Les embarras suscités par les droits de l’homme.
Le Déclaration des Droits, c’est aussi protéger un individu qui ne l’est plus socialement ou religieusement et qui doit se prémunir contre la nouvelle souveraineté de l’Etat et le nouvel arbitraire de la société. Ce qui garantit ces droits de l’Homme, c’est l’Homme lui-même mais intégré dans le nouveau concept de Souveraineté du Peuple, totalement abstrait, mais qui va servir à juger le degré de maturité d’un groupe humain. C’est le peuple, et non plus l’individu, qui est l’image de l’Homme. Or, on pensait que ces droits « inaliénables » étaient liés à la citoyenneté et à la nationalité. De fait, il devenait impossible de faire respecter les Droits de l’Homme à partir du moment où sont apparus des gens qui n’étaient plus citoyens d’un Etat souverain. On connaissait la perte de la patrie mais on découvrait l’impossibilité d’en trouver une autre et l’exclusion qui en découlait. Les nazis, au moment de mettre en place le système concentrationnaire et l’extermination de Juifs avaient bien saisi que personne ne réclamerait des individus privés de toute communauté de référence. Les apatrides n’ont aucun droit : aucun Etat n’est tenu de les nourrir ; ils sont privés du droit de résidence que même un détenu possède et leur liberté de pensée ne sert à rien puisqu’autant ce qu’ils pensent n’a aucune valeur ! Or ce phénomène n’est pas lié à la barbarie, mais au contraire prend son essor dans un « Monde Un », totalement organisé, hautement mécanisé et organisé, totalement déconnecté de toute transcendance religieuse et de la nature, et qui peut décider du jour au lendemain que l’humanité aurait intérêt à liquider certaines de ses parties ! PLATON avait écrit : « Ce n’est pas l’homme, mais un dieu qui doit âtre la mesure de toutes choses ». Ces éléments semblent donner raison à EDMUND BURKE, chef de file britannique de la contre-révolution, qui dénonçait l’abstraction du concept de droit de l’homme, estimant que nos droits émanaient « du cœur de la nation » et qu’il n’était nul besoin d’en chercher la source dans un commandement divin où une quelconque « race humaine » au sens robespierriste. (cf EDMUND BURKE ; « Réflexions sur la Révolution de France » de 1790). Au XX° siècle, le monde n’a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d’un être humain. Autrement dit, dans un monde déshumanisé, être un homme ne sert à rien. Dans ce monde globalisé ( !), l’étranger apparaît comme l’individu le plus dangereux pour un équilibre politique fondé sur la nationalité : il est l’absolument différent, l’Autre. « L « étranger » est le symbole effrayant du fait de la différence en tant que telle : il désigne les domaines dans lesquels l’homme ne peut ni transformer ni agir, et où par conséquent il a une tendance marquée à détruire » (A.H).
« Le paradoxe impliqué par la perte des droits de l’homme, c’est que celle-ci survient au moment où une personne devient un être humain en général – sans profession, sans citoyenneté, sans opinion, sans actes par lesquels elle s’identifie et se particularise- et apparaît comme différente en général, ne représentant rien d’autre que sa propre et absolument unique individualité qui, en l’absence d’un monde commun où elle puisse s’exprimer et sur lequel elle puisse intervenir, perd toute signification » (idem).






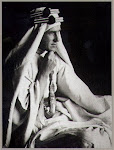
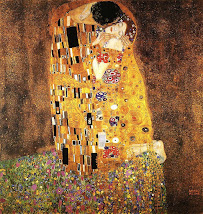


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire