dimanche 18 février 2007
PREPA SCIENCES PO: QUESTIONS FRANCAISES, ALLEMANDES ET EUROPEENNES
-Volonté de retour à « Belle Epoque » mais inadéquation des partis politiques aux nouveaux défis économiques, notamment du fait de leurs concurrences de clientèles, montée d’une droite sécuritaire et nationaliste et peur du bolchevisme qui disqualifie les unions de gauche.
Entre un P.C qui fait peur et une droite libérale qui se discrédite dans les scandales, montée d’un antiparlementarisme (ligues) que renforce encore la dérive dirigiste ou interventionniste de la gauche (Front populaire, mouvement « jeune turc » chez les radicaux.)
I/ De 1919 à 1932, l’alternance droite/gauche ne débouche que sur des expériences éphémères mises à mal par les questions économiques et sociales.
A. La politique du « Bloc national » se heurte aux difficultés financières issues de la guerre et à la contestation de forces politiques nouvelles ou rénovées (1919-1924).
1. Une coalition hétéroclite face à la reconstruction.
-Issu des élections de novembre 1919, le « Bloc national » est une coalition hétéroclite regroupant d’anciens socialistes devenus « indépendants » comme Briand et Millerand, des hommes de droite libérale comme Poincaré ou Tardieu, des représentants de la droite « nationale » comme Louis marin ou des droitistes de tradition comme Barrès. Mais on y trouve des voltairiens et des catholiques, des défenseurs de la grande industrie quand d’autres soutiennent la petite entreprise ou la paysannerie.
-On se soude à partir de la ratification du traité de Versailles pour défendre, derrière Georges Clémenceau, une « Union sacrée » soudée par l’idée de sécurité dans un nationalisme ancré sur le mouvement ancien combattant et contre l’internationalisme de la gauche. Le « Bloc national » remporte aux législatives de novembre 1919 433 sièges sur un total de 613. La peur de la contagion bolchevik a joué, relayée par un puissant mouvement de revendications ouvrières. Mais la cohésion de cette droite est faible, comme le montre l’échec de Clémenceau aux présidentielles de janvier 1920 : attaqué pour son dirigisme ou pour son anticléricalisme, le « Tigre » doit passer la main à Paul Deschanel, bientôt remplacé par Alexandre Millerand en septembre 1920.
-De 1920 à 1924, on a trois gouvernements : Millerand, Briand et Poincaré. Dominante du problème social avec la vague de grèves du printemps 1920 qui mobilise 1 300 000 ouvriers et employés derrière la CGT. Répression féroce : le syndicat est un moment dissous et 18 000 cheminots sont révoqués. Prégnance des questions financières avec la reconstruction et l’indemnisation des victimes de la guerre. En attendant que l’Allemagne paye, on finance par l’inflation et l’émission de bons du Trésor à court terme. Cela aboutit à la dépréciation du franc qui culmine en 1924-Livre à 117 francs contre 63 en décembre 1922. Le gouvernement Poincaré emprunte à la banque Morgan et augmente les impôts, ce qui précipite la chute du Bloc.
2. L’évolution des forces politiques à gauche.
-C’est d’abord celle du parti radical. Ce « parti des classes moyennes » est de tradition de gauche, se plaçant entre le « laissez-faire » sauvage et le collectivisme, pour un réformisme du juste milieu fondé sur l’attachement aux institutions républicaines et, pour l’heure, une entente internationale basée sur le mythe genevois de la SDN. Il a une base nationale mais le parti semble verouillé par la Conférence des Présidents qui donne la « ligne » derrière un leader reconnu (Herriot, Daladier,Chautemps). Le premier va s’attacher à retrouver l’âge d’or de l’avant-guerre en rompant avec le Bloc national pour rejoindre une sorte de « Bloc des gauches », ce qui explique la victoire du Cartel en 1924.
-La Révolution russe révèle les divisions du socialisme français, traditionnellement partagé en un courant anarcho-syndicaliste, un courant jaurésien plus réformiste et un courant « bolcheviste » animé par le Comité de la III° Internationale, appuyé par la délégation envoyée en Russie par la SFIO (socialistes) et dirigée par Marcel Cachin et L.O.Frossart, secrétaire général du parti. Les 21 conditions imposées par Lénine pour l’adhésion à l’Internationale, très « moscovites », aboutissent à la scission du Congrès de Tours en décembre 1920 : les majoritaires fondent la SFIC qui conserve L’Humanité et comptera bientôt 110 000 membres (1921), tandis-que les minoritaires maintiennent la « vieille maison » (Blum) derrière Blum, Marcel Sembat et Paul Faure, avec Le Populaire. Après la scission, la SFIO chute à 30 000 membres, pour remonter en 1925 à 110 000. En juin 1922, scission syndicale entre CGT et CGTU (Unitaire et communiste). Par ailleurs, la SFIO va mordre de plus en plus sur la clientèle du parti radical.
La politique conservatrice du Bloc national (retour des congrégations religieuses, statut concordataire pour le clergé et les écoles d’Alsace-Lorraine…) et la montée de la contestation à gauche expliquent, avec la volonté de rompre avec une politique étrangère agressive (occupation de la Ruhr en 1923), l’alternance de 1924.
B.Le « Cartel des gauches » (1924-1926).
Alliés, radicaux et socialistes remportent 327 sièges sur 581 aux élections de mai 1924. Divisés sur les nationalisations et l’impôt sur le capital, les deux formations s’entendent sur la laïcité et la conciliation à l’extérieur.
1.Le baroud d’honneur des nouveaux radicaux.
Action d’Edouard Herriot, Président du parti radical, contre le Président de la République, Millerand, jugé autoritaire et trop notoirement favorable au Bloc national. Renversé à la Chambre via son candidat à la Présidence du Conseil, il est remplacé par Gaston Doumergue, radical modéré. De fait, les radicaux vont prendre conscience de leurs contradictions : une tradition politique de gauche et des conceptions socio-économiques qui leur font défendre la propriété privée et la libre entreprise. Par ailleurs, le laïcisme républicain n’est peut-être plus en phase avec un pays traumatisé par la guerre et qui aspire par certains côtés à de nouvelles valeurs.
Le ministère Herriot (juin 1924-avril 1925) lance une politique anticléricale (projet d’école unique, suppression de l’ambassade auprès du Saint-Siège,etc.) qui, jointe aux difficultés financières et la peur du communisme, aboutit à la contestation des catholiques et des ligues d’extrême-droite : Action française, Faisceau de Georges Valois, Jeunesses patriotes de Pierre Taittinger. Heurts violents entre ces dernières et l’extrême-gauche en avril 1925, quelques mois après le transfert des cendres de Jaurès au panthéon et la reconnaissance de l’Union soviétique. Surtout, politique financière oscillant entre une déflation peu sociale-baisse des revenus qui mécontente les milieux populaires ou idée de l’impôt sur le capital qui rencontre l’hostilité du « mur de l’argent »-et le choix du déficit budgétaire passant par le dépassement du plafond des avances de la BdeF à l’Etat (41 milliards de francs par la loi de 1923) en truquant le bilan de cette dernière. La crise de confiance entraîne le public à demander le remboursement des bons du Trésor et à refuser de souscrire aux emprunts d’Etat. D’où la chute d’Herriot en avril 1925.
1. La détente internationale, à laquelle la gauche est associée, n’évite pas la chute du Cartel.
La gauche entend rompre avec la politique d’exécution des traités du Bloc national. De plus, Herriot soutient le projet de « Protocole de Genève » et visant à établir un système de règlement des conflits internationaux par arbitrage de la SDN. On sent déjà, dans le contexte du plan Dawes de 1924, l’amorce de la politique de Briand consistant à intégrer l’Allemagne dans un ensemble international assez vaste pour qu’elle ne puisse pu y jouer les leader.
En France, les forces nationalistes et les tendances antiparlementaires s’inscrivent en discordance avec cette évolution, signe des difficultés du pays à sortir des structures de l’avant-guerre. D’avril 1925 à juillet 1926, l’instabilité s’installe. Quand Herriot tente de former un nouveau ministère, la foule, massée devant le palais Bourbon, menace de le jeter à la Seine, préfigurant les débordements du 6 février 1934. La livre est à 243 f. contre 104 un an plus tôt. On est au bord de la faillite.
Conséquence pour les radicaux : recentrage sur l’idée d’une gestion modérée, pacifisme et tentative de rénovation derrière le mouvement « jeune-turc » qui apparaîtra en 1926 et se constituera autour de trois axes-pacifisme ; organisation de type dirigiste et corporatiste ; réforme de l’Etat dans le sens d’un renforcement de l’exécutif. Parallélisme avec les « néo-socialistes » et les tendances nouvelles de la droite qui préfigurent un « fascisme français ».
C.Le sauvetage Poincaré et ses suites (1926-1932).
1.Poincaré sauve le franc.
Avocat de formation, modéré, rigoureux et d’une totale intégrité, Raymond Poincaré (1860-1934) fut Président de la république de 1913 à 1920. favorable à une politique d’annexions pendant la guerre, il mène en tant que président du Conseil en janvier 1922, une politique de stricte application des traités (occupation de la Ruhr).Il constitue un gouvernement d « union nationale » avec des modérés (Briand,Tardieu), des représentants de la droite conservatrice (Louis Marin) et des radicaux(Herriot). Sa seule présence ramène la confiance…et la baisse de la Livre de 18% ! Il exécute une politique de resorbtion du déficit budgétaire : réduction des dépenses de l’Etat, « caisse d’amortissement » pour résorber la dette flottante, augmentation de certains impôts et droits de douane. Le budget équilibré, voire excédentaire (en 1927), la confiance des milieux d’affaires revient. Le franc est stabilisé en 1928 au niveau de son pouvoir d’achat (1/5° du franc-or). On supprime le plafond de la BdF mais elle doit conserver une encaisse-or= à 35% au moins de ses engagements à vue.
2.Virage à droite aux élections de 1928.
Retour d’un « bloc de l’ordre » cimenté par la politique de Poincaré (majorité à la Chambre de 330 sièges). Poincaré reste au pouvoir avec la seule coalition des droites à partir de novembre 1928, date du congrès radical d’Angers où le parti décide de rompre avec sa ligne droitière, inquiet de la concurrence des socialistes auprès des classes moyennes (novembre 1928). Il quittera le pouvoir en juillet 1929.
Jusqu’en 1932, date à laquelle la France ressent les effets de la crise mondiale, le pouvoir est aux mains de cabinets modérés dirigés par des héritiers du poincarisme comme Pierre Laval (ancien socialiste rallié à la droite après le congrès de Tours) ou André Tardieu. La droite investit également la présidence de la République avec Paul Doumer (élu en mai 1931 mais assassiné par un anarchiste en mai 1932) puis Albert Lebrun.
3. Une politique étrangère de détente.
Contexte humain favorable avec le Britannique Chamberlain, plus favorable à la France que Llyod George et surtout le couple Briand (ministre des Affaires étrangères français de 1925 à 1932) Stresemann (idem en Allemagne de 1923 à 1939). Briand veut éviter que la France se retrouve isolée face à une Allemagne en bons termes avec les anglo-saxons et la Russie et prenant la tête d’une « Mitteleuropa » économique, première étape d’un retour à l’hégémonie continentale. C’est pourquoi il juge préférable d’intégrer l’Allemagne dans un vaste ensemble international.
Les étapes du rapprochement franco-allemand :
-Plan Dawes de 1924 qui échelonne les versements allemands dus au titre des réparations et les limite.
-Pacte de Locarno d’octobre 1925 (Briand, Stresemann, Chamberlain, Mussolini, Vandervelde) : ces pays garantissent les frontières occidentales de l’Allemagne qui, par ailleurs, ne garantit pas les frontières orientales.
-Admission de l’Allemagne à la SDN sur proposition française en septembre 1926.
-Pacte Briand-Kellog, proposé par le chef du Département d’Etat américain sur l’initiative de Briand qui voulait en faire un outil de rapprochement avec les Etats-Unis. Soixante pays signent ce document qui proclame la guerre « hors-la-loi ».
-Plan Young de 1929 qui réduit une nouvelle fois la dette allemande.
-En 1930, la Rhénanie est évacuée avec près de 5 ans d’avance sur la date prévue.
Cette détente à toutefois des limites :
-la tactique de Stresemann qui consiste à « finasser et se dérober aux grandes discussions », retrouver une certaine force et reporter à plus tard le combat révisionniste.
-Un certain isolement de la Russie, notamment après sa rupture diplomatique avec la GB qui lui reproche d’avoir financer les ouvriers anglais dans la grève de 1926.
-En Europe centrale et orientale, la France a signé des traités d’alliance avec la Pologne (1921), la Tchécoslovaquie (1924), la Roumanie (1926) et la Yougoslavie en 1927). Par ailleurs, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie se groupent au sein de la Petite Entente, soutenue par la France et dirigée contre le révisionnisme hongrois. Aussi, Hongrie et Bulgarie se rapprochent-ils de Mussolini qui étend son influence dans les Balkans (en 1924, la Yougoslavie doit reconnaître la souveraineté italienne sur Fiume) et en Albanie (traités de Tirana de 1926 et 1927).
II/ La crise économique débouche sur une crise politique profonde en forme de crise de « civilisation ».( 1932-1939).
La crise économique et ses effets sociaux entraîne une crise du parlementarisme à laquelle, ni la droite ni la gauche ne peut offrir une réponse de fonds, tandis-que le contexte international amoncelle des nuages au-dessus d’une France fracturée.
A.De la crise économique à la crise de régime : la tentation antiparlementaire.
1.Les effets de la crise économique
Une crise de surproduction agricole chronique (blé et vin en particulier) à laquelle l’Etat répond par une politique de subventions qui pèse lourd sur le budget. Crise industrielle dès 1930 mais renforcée par une hausse des prix français accélérée par l’abandon de l’étalon-or par l’Angleterre en septembre 1931. Les exportations diminuent, passant en un an de 50 à 32 milliards de francs. Pour une base 100 en 1913, l’indice de la production industrielle passe de 140 en 1930 à 124 en 1931 et 96 en 1932.Il y a 500 000 chômeurs à cette date. La crise financière en découle, renforcée par les dépenses de leur indemnisation et aux largesses sociales de Tardieu. Le déficit budgétaire atteint 10 milliards de francs en 1933, alors-que les exportations diminuent. Une politique inflationniste aboutit à l’affaiblissement du franc.
2. L’absence de réformes de fonds et l’instabilité politique.
Paralysie de l’exécutif du fait d’une « Chambre introuvable » (non dissolution coutumière depuis 1876) et d’une cascade de ministères souvent fondés sur des coalitions improbables (socialistes étatistes et radicaux libéraux et défenseurs des « petits ». tel est le cas en 1932 malgré la victoire du « Cartel » (330 sièges) sur la Droite (260). Par ailleurs, opposition fréquente entre les gouvernements et des hauts fonctionnaires souvent compétents. Problème de l’inadaptation des réponses à la complexité des problèmes. D’où le renforcement des tendances anti-parlementaires à partir du rôle cristallisateur de plusieurs scandales politico-financiers :
-en 1928, affaire Marthe Hanau et sa « Gazette du franc » sponsorisée par des hommes politiques comme Laval et Herriot, et qui entraîne de petits épargnants vers des placements véreux.
-1933-1934 : affaire Stavisky qui éclate au moment de la faillitte du crédit municipal de Bayonne, suite à l’émission de Bons gagés sur des bijoux faux ou volés. On découvre que Stavisky est protégé par des magistrats comme le procureur de la République, beau-frère du président du Conseil Chautemps. L’escroc disparaît en janvier 1934 dans des conditions troubles qui amènent la gauche et l’extrême-droite à parler d’exécution.
3.De la crise politique à la crise de « civilisation » : le 6 février 1934.
La droite évolue vers une remise en cause du parlementarisme et plus largement vers un retour à des valeurs structurelles anciennes : les conservateurs songent à revitaliser celles du catholicisme au service d’une France d « ancien régime » basée sur l’Eglise et les notables (Xavier Vallat, futur Commissaire aux questions juives de Vichy ; Louis Marin, député de Nancy et la Fédération nationale catholique du général de Castelnau). La droite libérale remet en cause le libéralisme et songe à de nouvelles méthodes de gestion (Tardieu, Laval). Cette évolution rencontre l’idéologie des ligues au demeurant disparates. La plupart dénoncent les ratés du parlementarisme et/ou les frasques de l’élite bourgeoise, sans pour autant remettre réellement en cause le régime et sans réel programme politique. Tel est le cas d’organisations conjoncturelles comme la Fédération des contribuables (cf tradition de temps long que l’in retrouvera avec l’UDCA de Poujade dans les années 1950 et le CIDUNATI au tournant des années 1970-1980) ou les « chemises vertes d’Henri Dorgères (agitation paysanne classique avec embryon de fascisme). Dans la droite « césarienne et plébiscitaire » de tradition bonapartiste ou boulangiste, émerge les « Croix de feu » du lieutenant-colonel de La Rocque (P.S.F. après 1936, elles comptent plusieurs centaines de milliers d’adhérents issus des classes moyennes et de la bourgeoisie) qui évoquent un christianisme social patriotique et anti-communiste. Des aspects fascisants comme l’organisation para-militaire, que l’on retrouve chez les « Jeunesses patriotes » de P.Taittinger ou « Solidarité française » de F.Coty, l’encadrement social (colos) ou la mystique sportive (aéro-clubs Mermoz), mais surtout un aspect traditionnaliste. Idem pour l’Action française » de Maurras et Daudet, même si les « camelots du Roy » fournissent des cadres aux mouvements fascisants où émerge essentiellement le « Francisme » de Marcel Bucard, qui émarge auprès de l’Italie en 1934 et 1935.
*Etude de textes :
-Les deux idées modernes de la nation à partir de A.Renaut ; « Logiques de la nation » : distinction entre la « nation révolutionnaire » (RF), contractuelle, rationnelle et cosmopolite et la « nation romantique » (« Volkgeist » herdérien et « âme collective » de Joseph de Maistre), totalité englobante fondée sur des liens naturels organiques et aboutissant à l’éloge de la différence, donc au nationalisme.
-Maurrassisme : contre la nationalisme jacobin, missionnaire et humanitaire, un nationalisme antihumanitaire et narcissique que l’on retrouve dans la fascisme. Mais Maurras entend d’abord restaurer la société d’ancien régime (cf vichysme). Pour Maurras, la patrie n’est « pas née d’un contrat entre ses enfants », pas plus qu’elle n’est issue d’une « volonté »-on peut renoncer à sa nationalité-, c’est une « société naturelle » à laquelle nous appartenons par la « naissance » ; c’est « avant tout un phénomène d’hérédité ». Aux yeux de Maurras, la « nature » et l « hérédité » commandent nos affinités : « On fera plus pour l’amitié des Français en disant l’origine et les fortes raisons de leur communauté nationale qu’en leur imputant d’ores et déjà des sympathies théoriques, obligatoires ». Et « patrie » renvoie pour lui à « pater », comme nation « dit naissance ou ne dit rien ». C’est dire combien ces concepts, quoique renvoyant à la tradition, et en particulier aux sociétés d’ordres, peuvent, dans l’entre-deux-guerres, nourrir un racisme et une xénophobie, sans compter le culte du chef en tant que chef d’une famille, ou, pour reprendre l’expression de Maurras, en tant que clef de voûte de la « famille-chef ». Pour l’heure, en France, l « Action française » nourrit un anti-parlementarisme qui découle de ce nationalisme d’essence, ou de substance pour lequel l’action nationale ne peut en aucun cas provenir d’un « dénombrement de volontés » et d’un « total de pures conventions scrutinées », si elle n’est pas étayée sur un « Code inécrit des conditions du Bien…Le code des rapports innés entre la paternité et la filiation, l’âge mûr et l’enfance, la discipline des initiatives et celle des traditions ».
De 1932 à 1934, mis à part un cabinet Herriot de sept mois, forte instabilité gouvernementale. Des cabinets radicaux ou à direction « républicaine-socialiste ». Chautemps démissionne le 30 janvier 1934 à cause des retombées de l’affaire Stavisky. Daladier, qui le replace, décide de déplacer le préfet de police, Chiappe, jugé favorable aux ligues. D’où la journée du 6 février 1934 où anciens combattants et ligueurs tentent d’investir le palais Bourbon. Une quinzaine de personnes tombent sous les balles des gardes mobiles. Démission de Daladier, en but à une campagne de presse et à la contestation de nombre de hauts fonctionnaires. Remplacé par un gouvernement d « Union nationale » président par l’ancien président de la République Gaston Doumergue, avec trois hommes qui ont la confiance de la droite : Pierre Laval, André Tardieu et le maréchal Pétain. Tel était d’ailleurs le but des « émeutiers » du 6 février. Résultat à gauche : manifestations et grève général des 9 et 12 février 1934 et « front commun » contre le « fascisme ». Après l’échec du gouvernement Doumergue qui ne parvient pas à imposer une réforme constitutionnelle et se fait lâcher par les radicaux, cabinets de droite Flandin puis Laval, dont la politique de déflation brutale-baisse de 10% sur les salaires et traitements-imposée par décrets-loi (400 à 500 pris en conseil des Ministres de juillet à octobre 1935)-explique la victoire de la gauche aux élections de mai 1936.
B.L’expérience de front populaire
1.Origines et formation.
Peur des ligues et front antifasciste où se retrouvent des radicaux partisans d’un « front commun » (Daladier, Jean Zay) et abandon, par les communistes, de la tactique « classe contre classe ». En mars 1936, fondation du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes derrière Paul Rivet (prof au Museum et SFIO), Paul Langevin(prof au Collège de France et sympathisant communiste) et Alain (théoricien du radicalisme). Pacte d’unité d’action socialo-communiste de juillet 1934 et manifestation unitaire du 14 juillet 1935 après le ralliement des radicaux et la constitution d’un Rassemblement populaire ouvrant sur un programme politique commun minimum pour les élections. Réunification syndicale en mars 1936.
2.Le premier gouvernement Blum (mai 1936-juin 1937).
Aux élections de mai, le Front populaire obtient 376 élus contre 22 à ses adversaires. Baisse des radicaux et succès communiste (72 sièges). Or tout dépend des radicaux : Daladier est vice-président du Conseil et ministre de la Défense nationale, Chautemps ministre d’Etat et Y.Delbos ministre des Affaires étrangères. Les communistes soutiennent mais ne participent pas.
Mai-juin 1936, grandes grèves, certes orchestrées par le PCF voire noyautées par l’extrême-gauche trotskyste ou socialiste-révolutionnaire, mais surtout une explosion spontanée et festive au service de revendications sociales concrètes. D’ailleurs Blum y répond par les accords Matignon du 7 juin 1936 qui tiennent compte aussi, par leur réformisme modéré assez « new-dealien », des sensibilités radicales : droits syndicaux dans l’entreprise, conventions collective du travail, semaine de 40 heures, augmentation des salaires de 10 à 15% et congés payés. L’inflation érodera toutefois l’augmentation du pouvoir d’achat consécutif aux hausses de salaires. Reste que le nombre de chômeurs sera réduit de 70 000 et que pour un indice 100 en 1928, la production industrielle, tombée à 79 en 1935, remonte à l’indice 90 en 1937. La dévaluation du Franc en septembre 1936 a en effet dopé les exportations. Structurellement : nationalisations des industries d’armement et de l’aéronautique et création de la S.N.C.F.) et Statut de la Banque de France dans un sens plus étatiste et moins actionnarial.
Double opposition à Blum :
-du patronat qui joue la hausse des prix (jusqu’à 70%) contre les effets des accords de Matignon et boude l’emprunt.
-de l’extrême-droite : campagnes de presse orchestrées par « Gringoire » et l « Echo de Paris » aboutissant en particulier au suicide du ministre de l’Intérieur Roger Salengro ; agitation du Parti Social Français de de La Rocque et du Parti Populaire Français de Jacques Doriot ; action clandestine du C.S.A.R d’Eugène Deloncle (« la Cagoule »).
Mais c’est la politique de non-intervention dans la guerre d’Espagne qui révèle les divisions de la coalition (le P.C.F. voulait une intervention directe que les radicaux refusaient) et aboutit à la chute de Blum au sénat le 15 juin 1937 (refus des pleins pouvoirs financiers).
3.La fin du Front populaire.
Cabinet Chautemps que les socialistes quittent quand le gouvernement tente de limiter la portée de la loi des 40 heures. Echec d’un second cabinet Blum en avril 1938 sur la question des pleins pouvoirs financiers. Daladier devient Président du Conseil et rompt avec la majorité de Front populaire en s’appuyant sur la droite et sur les modérés. Mais les préoccupations sont désormais essentiellement extérieures.
La France de 1934 à 1939.
Je fixe par écrit des précisions qui m’ont été demandées sur cette période particulière où les contraintes de politique étrangère phagocytent une politique intérieure totalement absorbée par la « gestion » des coups de force hitlériens. Par ailleurs, les prises de position politiques de cette courte période annoncent à bien des égards celles de la période vichyssoise.
1. L’échec du retour à la politique des alliances (1934-1935).
Après le 6 février 1934, le ministre des Affaires étrangères LOUIS BARTHOU cherche à renforcer les liens de la France avec ses alliés d’Europe orientale (Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie) et à nouer des alliances avec la Russie et l’Italie (celle-ci s’inquiétant des manœuvres allemandes sur l’Autriche). Assassiné à Marseille en octobre 1934, il est remplacé par PIERRE LAVAL, artisan des accords de Stresa (avril 1935) qui condamne toute remise en cause unilatérale des traités par la signature d’un pacte franco-anglo-italien.La France signe par ailleurs un traité d’alliance défensive avec l’URSS en mai 1935. Mais Laval va plus loin et cherche à éviter à l’Italie des sanctions de la SDN après l’invasion de l’Ethiopie en octobre 1935. Le vote des sanctions éloigne Mussolini de la France et le rapproche de l’Italie, tandis-que Laval ajourne à plusieurs reprises la ratification parlementaire du traité franco-russe.
Les considérations idéologiques jouent, dans les années trente un plus grand rôle qu’auparavant. La droite condamne le traité conclu avec les « bolcheviks » et ne vote pas sa ratification. La droite maurrassienne condamne les sanctions contre l’Italie après l’affaire éthiopienne (Henri Massis, Pierre Gaxotte). Un pacifisme profond réunit l’opinion et la plupart des gouvernements. Un homme comme LAVAL, ancien socialiste minoritaire pendant la première guerre, plus proche de Briand que de Barthou, exclut la possibilité même d’une guerre et préfère, sans l’avouer ouvertement, un rapprochement avec les puissances fascistes qui conforte son pacifisme et sa crainte du bolchevisme.
2.La France devant les coups de force hitlériens.
Peu de réactions et guère de résistance des différents gouvernements. La remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936 ne provoque qu’une simple réaction verbale de Sarraut. Le Front populaire est absorbé dans la question espagnole qui divise sa majorité. L’Anschluss se déroule en mars 1938 alors que la France est privée de gouvernement. En septembre 1938, le radical DALADIER cède aux exigences d’Hitler sur les Sudètes, lors de la conférence de MUNICH, apothéose du pacifisme munichois (Blum parle de « lâche soulagement » !). Le 4 octobre 1938, 535 députés contre 75 (les 73 communistes, le député de droite Henri de Kérillis et le socialiste Jean Bouhey) ratifient les accords de Munich. Encore reste-t-il à définir chez les communistes la part du refus du démantèlement de la Tchécoslovaquie et celle du dépit de voir l’URSS écartée de la conférence.
Sur le plan idéologique, à l’ancienne opposition entre pacifistes et « bellicistes » s’ajoute la controverse liée à l’antifascisme et à l’anticommunisme.
Chez les socialistes SFIO, division entre antifascistes (Blum) et pacifistes (Paul Faure, André Delmas, secrétaire général du Syndicat des instituteurs). Idem chez les radicaux où les partisans de la fermeté (Daladier, Herriot, Delbos) s’opposent aux tenants du compromis comme Georges Bonnet et Emile Roche). Pour sa part, la droite parlementaire se divise entre les partisans du nationalisme germanophobe (Louis Marin) et les tenants de l’anticommunisme pour qui les accords de Munich permettent de laisser à Hitler les « mains libres » à l’Est.
Extrême-droite et Parti communiste adoptent des positions symétriques. La première, radicalisée depuis 1934, fait taire sa germanophobie au profit d’une vision de l’Allemagne hitlérienne comme rempart contre le communisme. THIERRY MAULNIER écrit dans « Combat » : « Une défaite de l’Allemagne signifierait l’écroulement des systèmes autoritaires qui constituent le principal rempart à la révolution communiste et peut-être à la bolchevisation immédiate de l’Europe ». Il rejoint PIERRE-ETIENNE FLANDIN, futur chef de gouvernement du maréchal Pétain et leader de d’Alliance démocratique (centre-droit) qui dénonce la pression communiste en faveur de l’intervention contre Hitler et « l’escroquerie patriotique ». A contrario, l’opposition absolue des communistes à Munich part de l’argumentation antifasciste qui coïncide avec sa défense de l’URSS.
En décembre 1938, le radical Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, relance la conciliation en signant avec Ribbentrop un pacte franco-allemand de non-agression et tout un milieu « munichois »-DEAT, PAUL FAURE,P.E.FLANDIN-approuve l’initiative. Daladier, de son côté, se convertit tardivement à la fermeté en janvier 1939 en réagissant vigoureusement aux revendications italiennes sur la Corse, la Tunisie et Djibouti.
La prise de contrôle totale de la Tchécoslovaquie par Hitler, en mars 1939, marque l’échec de cette politique munichoise. A noter que par ailleurs que jusqu’à cette date, la France est totalement à la remorque de la diplomatie britannique d « Apeasement », impulsée par Chamberlain et son Secrétaire au Foreign Office, Halifax. Comme en France, toute une coterie « pro-allemande » gravite autour de Lord et Lady Ashtor, propriétaires du « Times ». La conversion franco-anglaise à la fermeté, au printemps de 1939, ne peux plus éviter le pire.
Au total, la France des années 1930 connaît une remise en cause du parlementarisme qui, sans verser dans le fascisme du fait de la vigueur du sentiment républicain, nourrit en tout cas des tendances étatistes et autoritaires renforcées par la conduite des politiques économiques. Venu au pouvoir en 1936, le mouvement socialiste s’appuie sur une politique de défense républicaine dont les cadres idéologiques traditionnels n’ont plus la même force d’impact qu’au début du siècle (laïcité). Surtout, le « Front popu’ » engendre un climat de guerre civile et, en 1938, un reclassement définitif du radicalisme au centre-droit (concept de primauté de l’Etat).
3.Vichy comme aboutissement et « continuité ».
J’ai souvent abordé la question de Vichy comme continuité ou comme rupture. Voir ici les réactions opposées d’un François Mitterrand (rupture dans la République) ou d’un Jacques Chirac (Vichy comme dévoiement de la République). Question cruciale pour la manière de poser la responsabilité…de Vichy (Mitterrand)…de l’Etat Français (Chirac) dans la politique de collaboration, en particulier dans la question de la déportation des Juifs.
En tout cas, la « Révolution Nationale » de Pétain semble permettre une synthèse où se retrouvent des hommes issus de tout l’éventail politique : l’ultra-droite anti-libérale et attirée par les régimes fascistes, les conservateurs soucieux d’un retour à l « ancien régime » et soudés dans l’anti-communisme, les maurassiens hostiles à tous les « métèques », mais aussi des hommes de gauche et de droite partisans d’un exécutif fort, des socialistes et des communistes en rupture de ban (Déat, Doriot ou René Belin, secrétaire confédéral de la CGT), de jeunes « technocrates » épris de rationalité modernisatrice, des catholiques prenant leur revanche sur 1905…Enfin, nombreux sont ceux que fascine la jeunesse et le consensus allemands, voire l’idée d ‘Europe allemande.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)






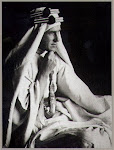
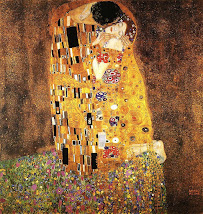


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire