Le socialisme en France au XX° siècle.
-L’héritage idéologique de la Révolution française (République, sans-culotterie, armée de l’an II,etc.).
-Double enracinement au XIX° siècle : le marxisme et le socialisme utopique.
-Mouvement ouvrier et socialisme.
I/ Héritier des valeurs de la Révolution et des mouvements utopistes du XIX° siècle, le socialisme français oscille entre réformisme et révolution (1900-1945).
A/ Les socialismes de 1900 à 1914.
1. Guesdisme et possibilisme : de la fondation de la CGT en 1895 à celle de la SFIO en 1905. L’unification mouvement ouvrier et socialisme avec la Charte d’Amiens de 1906.
2. Républicanisme et socialisme : autour du boulangisme, de l’Affaire Dreyfus et du débat colonial.
3. Hésitation entre Grève Générale et entrisme parlementaire – 51 députés en 1906 et 103 en 1914- et conversion à la guerre en août 1914.
B/ De 1914 à 1945, les socialistes de la « vieille maison » subissent la concurrence des communistes et hésitent entre rhétorique révolutionnaire et réformisme technicien.
1.Le Congrès de Tours et la « vieille maison » à la recherche d’une nouvelle identité.
2. Réformisme et gouvernements de coalition avec les radicaux (les cartels de 1924-26 et 1932.
Les socialistes perdent une partie de l’électorat ouvrier et doivent partager avec les radicaux l’électorat des classes moyennes.
3.Du Front populaire à Vichy.
-Les socialistes et le Front populaire : entre réformisme social et radicalisme révolutionnaire. L’alliance fragile avec les radicaux et la surenchère sociale des communistes révèlent au grand jour la difficile identification des socialistes.
-Du munichisme socialiste de 1938 (« lâche soulagement » avoué par Blum au vote des pleins pouvoirs à Pétain de la part d’une partie des socialistes, la confusion perdure, à peine corrigée par la conversion à la résistance. C’est le PCF qui va symboliser surtout la résistance à gauche.
II/De 1945 à la fin du XX° siècle, les socialistes hésitent entre réformisme et rupture révolutionnaire.
A/ L’exercice du pouvoir révèle les contradictions des socialistes aboutissant à l’affaiblissement de la SFIO au début des années 1960.
1.La SFIO et la IV° République (1946-1958).
-Rénovation et réformes à l’intérieur mais échecs à l’extérieur (question indochinoise et surtout algérienne à partir de 1956 avec G.Mollet.
2. de 1958 à 1960, la fonction tribunicienne passe au gaullisme tandis que des scissions affaiblissent les socialistes (PSA puis PSU de M.Rocard. En 1962, les socialistes appellent à voter « non » au referendum sur l’élection du Pt de la Rep. Au suffrage universel, d’où un affaiblissement dans l’opinion.
B/ Mitterrand et le renouveau socialiste confrontés à partir de 1981 à l’exercice du pouvoir.
1.De la FGDS au PS via les congrès d’ Epinay et de Metz (1971-1976).
2. Les septennats de Mitterrand et la coupure de 1986.
Les socialistes hésitent entre une orientation plus centriste avec Rocard en 1993 ou plus souverainiste avec Chevénement (Mouvement des citoyens.
L’affaiblissement du PC ne profite guère aux socialistes dont la sociologie électorale tourne surtout autour des professions libérales. Par ailleurs, naissance d’une nouvelle extrême-gauche, anti-libérale et alter-mondialiste qui déborde les socialistes à gauche. D’où l’échec de 1995 et l’affaiblissement jusqu’en 2002, l’extrême-droite reprenant au P.C la fonction tribunicienne et protestataire.
CONCLUSION :
-plus à gauche implique des archaïsmes.
-plus au centre implique un problème d’image et de visibilité idéologique face à la droite « orléaniste ».
-Pas de conversion social-démocrate.
La France et l’Europe : problématique.
-Fondateurs de l’idée et du projet depuis les années 1930, nous sommes aussi les freins récurrents :
-soit en ancrant l’Europe sur le binôme France-Allemagne aux fins de contenir l’Allemagne donc de dominer.
-soit en manifestant régulièrement des comportements souverainistes : dans les années 1950 derrière les communistes et les gaullistes ; avec de Gaulle qui songe surtout à une Europe des patries et entend promouvoir le leadership français ; depuis 1992 avec les différentes critiques souverainistes ou anti-libérales (Le RPR jusqu’au début des années 2000 et les gauches radicales (PCF, aile gauche du PS, extrême-gauche).
-Toutefois, nous sommes à l’origine des volontés d’approfondissement ou d’élargissement :
-dès 1957
-à partir de 1974 (Pompidou et le I° élargissement), puis dans les années 1980 avec Mitterrand et les élargissements au Sud afin d’assurer à la France une sorte de magister sur un axe Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique du Nord, d’où l’entrée de la péninsule ibérique et de la Grèce. La France est à l’origine du traité de Maastricht et du protocole constitutionnel finalement refusé en 2005.
-Le problème : manque de pédagogie et/ou d’intérêt public pour cette question, mais aussi notre volonté souvent impertinente d’imposer un modèle (en particulier social) qui ne motive pas nos voisins. Surtout, ce n’est plus la France qui fournit les valeurs « universalisantes » sans laquelle il n’y a pas de magister européen ; désormais, le modèle social-démocrate allemand et scandinave, mais aussi le social-libéralisme anglais rencontrent un succès plus large.
-Lien entre ce sujet et celui de la vie politique en France : le clivage droite-gauche, les difficultés, tant de la droite populiste-étatique que de la gauche anti-libérale à accepter une Europe transnationale, expliquent nos freinages et partant ceux du continent. Voir nos comportements xénophobes en 1981, 1986 et 1995-2007 lors de l’entrée des anciens pays du bloc de l’Est dans l’UE.
Voici un plan sur Idéée européenne et projet européen:
De l’idée européenne au projet européen (1919 à nos jours).
-Des visions anciennes et divergentes (Europe de la Révolution française, Mitteleuropa chrétienne des Habsbourg, Europe allemande…).
-1920 : cimenter une identité européenne bouleversée par la « Grande guerre ». Mais échec lié aux égoïsmes nationaux (crise économique), à la récurrence des nationalismes, aux totalitarismes.
-L’idée repart en 1945, dans un contexte de « guerre froide ». Cette réelle aspiration des peuples semble faire l’unanimité jusqu’en 1975. Mais les effets de la crise de 1973, un certain « déficit démocratique » de la CEE, puis de l’UE et les divergences entre fédéralistes et souverainistes compliquent les élargissements successifs.
I.De 1919 à 1957, on passe progressivement de l’idée européenne à un projet unitaire.
A/ Les prodromes de l’idée d’Europe (1919-1945).
- Paix, sécurité, liberté : autour de la « Pax Europa » de Coudenhove-Kalergi (1923).
- Du congrès paneuropéen de 1926 à l’échec des « Etats-Unis d’Europe » de Briand (1932).
Briand défend l’union douanière et cherche à intégrer l’Allemagne dans un système européen global qui la marginaliserait. Parallèlement, « initiative scandinave » plus fédéraliste et transnationale (Heerfordt).
- Mais pas de grand mouvement populaire et montée des nationalismes, puis des «internationales » fasciste ou communiste. Pas d’ordre financier international et des solutions nationales ou impériales de sortie de crise. Toutefois, des projets relancés pendant la guerre :
-Manifeste pour une Europe libre et unie (1941) en Italie.
-Mouvement fédéraliste européen de l’Italien A. de GASPERI (1943).
B/ De 1945 à 1957, on passe de l’idée européenne à un projet concret, dans le contexte de reconstruction et de « guerre froide ».
1. L’opposition des « blocs » relance le projet européen (1945-1947).
-Churchill relance l’idée d’Etats-Unis d’Europe en 1946.
-Mais opposition entre fédéralistes (démocrates-chrétiens et socialistes européens) qui cherchent à dépasser la notion d’Etat et confédéralistes soucieux de préserver les souverainetés nationales (GB, gaullistes et communistes français).
-Le plan Marshall de 1947 complique le débat en faisant peser sur la future organisation le risque d’un alignement sur les USA.
2. Toutefois, accélération du processus jusqu’au Traité de Rome de 1957.
-Le congrès de La Haye de mai 1948 fonde l’OECE et débouche sur le Pacte de Bruxelles, organisation commune de 5 états européens en matière de défense. Surtout, naissance du Conseil de l’Europe en mai 1949, expression de la volonté politique de 10 états (France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg auxquels s’associent le Danemark, l’Irlande, l’Italie, la Norvège et la Suède).
- Accélération derrière MONNET, SCHUMANN, PLEVEN et le Belge SPAAK et aboutissant à la CECA (1951), première institution supranationale à vocation économique mais motivée aussi par la montée des influences soviétiques et américaines.
-Idée d’un « marche commun européen » instrumentalisé par des institutions communes (congrès de Messine de 1955). L’arrivée au pouvoir en France d’un gouvernement pro-européen (Mollet) en 1956 favorise le projet.
-Toutefois, échec du projet français (PLEVEN) de CED entre 1952 et 1954.
C/ . Les Traités de Rome (25 mars 1957).
1.-CEE et EURATOM.
2. Les Institutions.
L’idée européenne n’est plus un mythe mais il reste à fonder une identité commune que l’échec de la CED en 1954 et la prise de distance de la GB (elle fonde sa propre organisation de libre-échange, l’AELE) repousse à plus tard.
II. De 1957 à la fin du XX° siècle, l’Europe se renforce et s’élargit, malgré un débat récurrent entre fédéralistes et souverainistes qui repousse toujours plus l’idée d’Europe politique.
A/ De 1958 à 1973 semble triompher une vision « gaulliste » de l’Europe.
1. Axialisation franco-allemande et refus du « cheval de Troie » britannique.
2. Extension de l’Influence de la Commission de Bruxelles mais marginalisation de la CECA et d’EURATOM.
3. Réussite globale du Marché Commun et de la PAC entre 1960 et 1968. Modernisation des structures agricoles.
B/ A partir de 1973, les élargissements successifs relancent le débat politico-identitaire mais accélèrent le processus d’intégration communautaire.
1. Les élargissements de 1973 à 2004.
-L’entrée de l’Angleterre et de l’Irlande (Pompidou) puis de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal entre 1981 et 1986 axialise l’Europe vers le Sud (Mitterrand), élargit géographiquement l’organisation mais laisse pendante la question de l’Europe politique. Par ailleurs, à partir de 1979, l’atlantisme de M.Tatcher freine l’intégration. En Scandinavie, adhésion du Danemark mais refus des Norvégiens.
-De 1995 à 2004, l’Europe intègre des pays issus de l’ancien bloc de l’Est, posant le problème de l’adaptation à l’économie de marché de ces nouveaux membres, de l’harmonisation sociale et des relations « Est-Sud » : comment harmoniser la distribution des « fonds structurels » destinés aux régions en reconversion.
2. Un renforcement de l’intégration dès la fin des années 1970.
-A partir du binôme franco-allemand (VGE/ MITTERRAND et SCHMIDT/ KOHL) : mise en place du SME, ébauche de politique étrangère commune (CSCE et siège d’observateur de la CEE à l’ONU) et enracinement démocratique avec l’élection du Parlement Européen au SU (1979).
-Sous impulsion française (MITTERRAND/ DELORS) : Acte Unique Européen de février 1986. Sous impulsion franco-allemande : les accords de MAASTRICHT de 1992 étendent le domaine commun et les Etats acceptent de renoncer à certains pans de leurs souverainetés. Lancement de l’EURO en janvier 1999 ; il rentre dans sa phase définitive au I° janvier 2002.
C/ Toutefois, le processus européen se heurte à différents obstacles.
1.Ethnocentrisme et maintient de réflexes particularistes : les chasseurs en France, le modèle social-démocrate que les Danois opposent au libéralisme européen, la question de l’héritage chrétien dans la Constitution européenne… La question de l’entrée de la Turquie et le report à 2007 de celles de la Roumanie et de la Bulgarie traduisent bien ces ambivalences.
2. La critique souverainiste contre le « bureaucratie » de Bruxelles, bien que la réalité du pouvoir appartienne en fait au Conseil des Ministres. Elle transcende les clivages politiques traditionnels, en particulier en France (C.PASQUA, J.P.CHEVENEMENT, P. DE VILLIERS, JOSE BOVE…). Certains pays gardent leur « indépendance » nationale : Danois et Britanniques restent en dehors de l’euro.
3. Hésitation et/ou indifférence des opinions : force de l’abstention lors des scrutins européens ; hésitation des opinions entre souverainisme et renforcement des liens communautaires…
De 1919 à nos jours, l’idée d’identité européenne se heurte à la permanence des environnements géopolitiques : totalitarismes, Guerre froide, atlantisme, force et effondrement du bloc communiste. La France a du mal à concevoir une Europe dont elle ne serait plus nécessairement le leader, tandis que l’Europe du Sud, encore structurellement fragile, dispute à l’Europe de l’Est l’usage des aides communautaires. Fédérée sur des objectifs économiques, la CEE, puis l’UE éprouvent des difficultés à associer les Etats à la mise en place progressive d’une Europe politique, fondée sur des valeurs communes.
Bibliographie :
-C.ZORGBIBE, « Histoire de la construction européenne », PUF, 1993.
-B.OLIVI, « L’Europe difficile », Folio, 1998.
-A. DUHAMEL, « L’Europe : une ambition française », 1999.
L’Europe en tant que fusion de civilisation : les précédents.
-L’Europe gréco-romaine autour de l’axe méditerranéen et en deçà du « limes » rhéno-danubien au-delà duquel se trouve les « barbares » germaniques (comme quoi on trouve toujours des peuples indésirés).
-L’Europe chrétienne, des Carolingiens aux Habsbourg, autour du christianisme et contre les « Maures » musulmans. Il y a un peu plus tard l’Europe catholique (Baroque) et l’Europe protestante (Les Réformes).
-L’Europe des Lumières et l’Europe des « Révolutions atlantiques » (Jacques Godechot) en Angleterre et en France ; puis l’Europe conquérante de la Révolution française de 1789 à 1815.
-L’Europe du milieu (Mitteleuropa) fondée sur la « supériorité » germanique, du XVI° au XX° siècle (ou de la Hanse à Hitler en passant par le pangermanisme) et/ ou sur une extension du germanisme vers l’Est, contre le panslavisme et l’Empire ottoman (Empire austro-hongrois jusqu’en 1914).
-L’Europe « atlantique » contre l’Europe « soviétique ».
-L’Europe en tant que grand marché économique.
-L’Europe politique à 25 ou plus : fédérée par quelles valeurs ?
Bon courage!
D'autres problématiques et mes réflexions progressives sur Gauchet à la fin de la semaine.






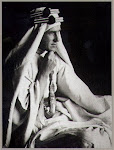
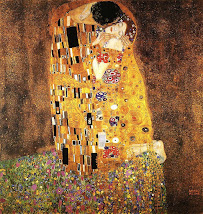


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire