A PROPOS DE LA « CONDITION POLITIQUE » DE MARCEL GAUCHET.
Je vous proposerai d’abord des réflexions « en vrac », au fil de ma lecture et de ma réflexion, en particulier au plan historique, à mon sens la faiblesse majeure du texte, l’Histoire se voyant réduite à quelques grands paradigmes classiques. Par la suite, j’essayerai de modéliser diachroniquement.
Concernant l’introduction, annonciatrice du propos global, quelques observations :
-L’Etat est-il uniquement le relais moderne du religieux comme l’affirme G. ?
Il me semble devoir faire un distinguo entre Eglise (ecclesia) en tant qu’institution et (religio)sité (populaire, sectaire, intime), sans compter une spiritualité débouchant dès le haut Moyen-âge sur le cénobitisme, le stylisme (St Siméon) et en général les monachismes qui restent en marge des états et de l’Etat, quand il ne rentre pas en conflit avec lui. Donc distinguer clergé séculier (hiérarchie religieuse) et régulier (moines/ moniales). Au XVII° siècle, les jansénistes se dressent contre l’ordre étatique monarchiste et ses accomodements avec la Grâce et le Salut provoquant la fermeture de Port-Royal. En d’autres termes, la spiritualité entre souvent en conflit avec la religion officielle et c’est toute la problématiques des « hérésies » du Moyen-Age aux temps modernes : voyez les cathares en France, les hussites de Bohême dressés contre Rome et le trafic des indulgences par les princes, voire le luthéranisme à ses débuts (Martin Luther est moine augustin) levé contre la dictature spirituelle de Rome au nom d’un libre accès aux textes bibliques,etc. En Russie au XVII° siècle, le Raskol ou mouvement des vieux croyants s’oppose à l’orthodoxie « étatique » soutenue par les tsars. Gauchet néglige la dimension spirituelle comme tous ceux qui n’approchent le religieux qu’à travers une grille politique et/ou rationnelle. Les Jésuites administrent la preuve a contrario qu’un ordre religieux mis au service de Rome pour assurer le triomphe de la reconquête catholique, peut entrer en conflit…avec Rome et …avec les Etats au sein desquels ils s’installent. Il n’y a pas un Etat qui prend en charge les fonctions originellement dévolues à « la religion » mais des états, en particulier dans le monde indo-européen, où pouvoir et société sont marqués par la fameuse « tripartition indo-européenne » chère à GEORGES DUMEZIL : « oratores, bellatores, laboratores », c’est-à-dire ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Il y a affirmation d’un Etat centralisé à partir surtout du XVIII° siècle à travers la conception hégélienne du « Staat » en tant qu’instrument de réalisation de l’Histoire. C'est le moment où, comme le rappelle MIRCEA ELIADE, "dans les sociétés occidentales modernes...l'homme areligieux s'est pleinement épanoui. L'homme moderne areligieux assume une nouvelle situation existentielle: il se reconnaît uniquement sujet et agent de l'Histoire, et il refuse tout appel à la transcendance. Autrement dit, il n'accepte aucun modèle d'humanité en dehors de la condition humaine,telle qu'elle se laisse déchiffrer dans les diverses situations historiques. L'homme se fait lui-même,et il n'arrive à se faire complètement que dans la mesure où il se désacralise et désacralise le monde. Le sacré est l'obstacle par excellence devant se liberté. Il ne deviendra lui-même qu'au moment où il sera radicalement démystifié. Il ne sera vraiment libre qu'au moment où il aura tué le dernier dieu" (MIRCEA ELIADE, "Le sacré et le profane", Gallimard 1965, p.172). Donc mort de Dieu et naissance de l'homme qui se réalise dans l'histoire à travers l'Etat dans une acception hégélienne: on est loin du glissement de la fonction religieuse à la fonction étatique s'il faut tuer Dieu pour réaliser l'Histoire!!
-Sur les origines de la prééminence de l’Etat :
En général, Gauchet zappe le despotisme éclairé, les Lumières et la Raison dominante qui sont à l’origine de l’Etat révolutionnaire, de Robespierre à Lénine via Hegel et …Marx, cette bientôt dictature de la raison aboutissant au « despotisme de la liberté » en France de 92 à 94, inaugurant pour FRANCOIS FURET l’ère des totalitarismes et contre lequel se lèveront les pensées contre-révolutionnaires (De Maistre, de Bonald, E.Burke). Par un étrange glissement, Gauchet file sur le libéralisme, à ses yeux fondateur de l’Etat moderne en tant que producteur de la « satisfaction querelleuse ». Mais c’est le marxisme, puis le communisme et à certains égards le fascisme qui opèrent cette mutation, sans oublier les déviations étatiques et précisémment anti-libérales à partir de la Première Guerre mondiale.
-Sur le phénomène totalitaire :
Il y voit – à juste titre- une foi anachronique dans le pouvoir d’englobement et de commandement du politique et poursuit en considérant que depuis 1945, nous vivons au contraire dans le mirage de l’extinction de la politique. Reste que les fascismes se caractérisent par une conception organique de la société, donc en dehors du champs idéologique démocratique des libertés ; par ailleurs, le culte du Chef « conducteur » renvoie moins au champ politique qu’au champ du sacré et du mythe( E. Cassirer). Ici, la « politique » n’a pas évacué le religieux pas plus qu’elle n’en descend : elle replace le religieux au chœur de la société (y compris dans la mobilisation des mythes païens dont CARL ORFF sera en musique, et pour le cas allemand, l’expérimentateur privilégié). On peut se demander si la crise actuelle du politique ne relève pas précisémment d’un retour non prévu du religieux, mais dans des cadres non plus ecclésiaux mais communautaires (sectes, groupes évangéliques…).Il y aurait alors une dimension liberticide du « manque » de religieux.
-Libéralisme et droits de l’homme :
La tentation de l’Europe.
G. ne croit pas à l’obsolescence de l’état-nation mais à l’usure de certaines de ses fonctions. Pour lui, pas d’Europe sans réflexion sur l « être-ensemble » dans chaque communauté. Depuis 1989, essor d’une « gouvernance mondiale » fondée sur le « jeu spontané des acteurs » et « restituant à la démocratie son sens primordial d’autorégulation des libertés ». mais remise en cause depuis le 11 septembre 2001 qui ramène les USA au « classicisme de l’affirmation nationale ». Il poursuit en voyant l’Europe comme une communauté parvenue au stade de la similitude pluraliste et excluant désormais l’usage politique de la guerre. Mais selon lui, l’Europe ne doit pas céder à la tentation de penser que le monde entier fonctionne de la même façon. Et G. de dénoncer le mirage de l’autosuffisance d’une société dégagée de tout cadre politique, à quoi s’ajoute le mirage de la sortie de l’Histoire, l « histoire comme tâche », l « histoire à faire au futur ». Dans cette Europe, il n’aperçoit plus de société mais seulement des individus jetés dans un présent post-historique. Les USA au contraire sembleraient avoir gardé le sens du futur à partir d’un passé soudé au concept de fondation lié aux pilgrims du XVII° siècle, d’où une « vitalité maintenue de la religion chrétienne et de l’identité religieuse du pays ».
Plusieurs observations :
-l’état-nation ne recouvre pas la même notion en Espagne, en Pologne ou en France par exemple, d’où la difficulté à penser de façon transnationale, en particulier dans la France jacobine. G. minimise la prétention française à continuer de vouloir exercer un magister à partir d’un modèle obsoléte. L’Allemagne très anciennement multi-régionaliste et fédéraliste, l’Espagne ou l’Angleterre régionalistes, les pays de l’Est héritant d’un lointain passé multi-ethnique, autant d’éléments qui rendent difficile la gestion de la diversité et la recherche de règles démocratiques communes : un Polonais pour qui l’Eglise a toujours symbolisé la résistance à l’oppression comprend mal qu’on inscrive pas l’héritage chrétien dans un projet constitutionnel européen ! Ne pas oublier que les pays d’Europe orientale, privés de toute culture démocratique et retardés dans leur accession à cette démocratie par les fascisme, puis un demi-siècle de communisme, souhaitent intégrer un modèle libéral que G. très subtilement dénonce sous le terme codé d « autorégulation des libertés ». C’est que ces peuples connaissent trop les désastres de la régulation étatique totalitaire !!
-Plus de guerre ? Gauchet oublie-t-il le long et terrifiant conflit balkanique de 1990-1995 ? Nettoyages ethniques, camps de concentration, exécutions massives…n’ont-ils pas fonctionné comme un terrible retour de l’Histoire ? Par ailleurs, la réunification allemande, la nouvelle axialisation de l’histoire allemande sur une capitale berlinoise de nouveau mitteleuropéenne, les débats sur l’identité polonaise, les interrogations tchèques et slovaques,etc.ne constituent-ils pas un renouveau du mouvement de l’histoire après 50 ans d’immobilisme est-ouest ?
-Les USA ramenés au « classicisme de l’affirmation nationale ». D’abord ils ne sont pas les seuls à connaître cette tendance –voir la Russie et la France dans des acceptions certes différentes-. Par ailleurs, G. a du mal à concevoir qu’un pays puissent instrumentaliser parallèlement deux outils idéologiques antinomiques. Or, l’histoire des USA depuis le début du XX° siècle montre que les Américains peuvent parfaitement faire coexister impérialisme et discours national-religieux, à partir d’un messianisme fondateur opérant justement la synthèse cohésion interne-expansion externe. Même chose curieusement côté russe ou le nationalisme relayait fréquemment l’internationalisme quand celui-ci s’avérait inefficace. Un peu plus loin de nous,les nationalismes nippon et aujourd’hui chinois renforcent et amplifient les politiques économiques de ces grandes puissances. Nous avons connu et connaissons encore le social-libéralisme, la social-démocratie, le national-bolchevisme, le socialisme de marché chinois…Mais peut-être un Français a-t-il du mal à concevoir un univers conceptuel hors des cadres droite-gauche ? Enfin il est étrange de voir Gauchet, persuadé du lien organique religion-Etat, parler pour les Etats-Unis d « identité religieuse du pays », c’est-à-dire de la nation. Tant il est vrai que le cas américain apparaît exemplaire d’une nation construite à partir d’une dissidence religieuse (le Dissent anglais opposé à la religion officielle anglicane dès le XVI° siècle) soulevée contre une église d’Etat. On en revient toujours à cette confusion chez G. entre Eglise et religion.
Nota: pour chaque chapitre, je partirai d'un résumé de la problématique de Gauchet que je discuterai ensuite à partir de "contre-lectures" et de réflexions personnelles.
I/LA DETTE DE SENS ET LES RACINES DE L’ETAT. POLITIQUE DE LA RELIGION PRIMITIVE.
Pour Gauchet :
-Les clefs du problème de l’Etat sont à chercher du côté des racines anciennes du fait religieux car
-l’instauration de l’Etat correspond, non pas à la production d’une dimension sociale inédite mais à la transformation d’une dimension déjà présente dans la société mais
-cette dimension trouve son origine à l’extérieur du champs social (le champs religieux).
Dans la section « De la nécessité prétendue de la religion », G. s’en prend aux conceptions qui font du religieux la résultante d’une contrainte extérieure :
-Contrainte liée à la structure mentale chez DURCKEIM pour qui la religion est le produit des impératifs de la conscience collective, l’effet du besoin pour une société de s’assurer de son « identité communielle ». S’il y a religion, c’est parce qu’il faut que se concrétise dans une croyance unanime et objective, indépendante des croyances individuelles, le sentiment d’existence de la collectivité à travers le culte d’une puissance supérieure à l’Homme. G. regrette que DURCKEIM ne postule pas l’idée d’institution au sens où on aurait pu …s’en passer ou la remplacer par une autre. De fait, Gauchet ne peut concevoir une nécessité du religieux, un mouvement instinctif vers une transcendance. Tout est dit dans la phrase : « L’espèce humaine n’est pas vouée à la religion ». Enfin, G. est étonné qu’une communauté ne cherche sa reconnaissance qu’en « dehors d’elle-même ».
-Contrainte liée à la faiblesse du mode de production impliquant la nécessité de se concilier les éléments extérieurs par des constructions mythologiques et le recours à la pensée analogique hommes-dieux fondatrice du religieux. C’est peu ou prou la conception marxiste. Conclusion : dans les deux cas, on revient à l’intervention de schèmes de pensée primordiaux, et Gauchet d’expédier ainsi LEVI-STRAUSS et sa « pensée sauvage », c’est-à-dire extérieure aux institutions, donc à l’Etat, une vision diamétralement opposée à la sienne qui fait découler le religieux d’une contrainte social-étatique.
Mes remarques :
-Gauchet critique le marxisme tout en reprenant- certes avec une rhétorique plus subtile- le concept d « opium du peuple » et en le transférant au structuralisme de Lévi-Strauss. Ce dernier s’est efforcé de démontrer l’autonomie de la pensée magico-religieuse et l’intervention, tant chez les individus qu’au plan collectif, d’une transcendance de surcroit reliée au quotidien et non déconnectée du social. De fait, en quoi le religieux serait-il extérieur à une société puisqu’autant il en est l’émanation ? Implicitement, G. reproche à Lévi-Strauss d’étudier les systèmes de croyances sans poser la question préalable du « pourquoi croire » ? Mais postuler cette question comme prémisse aboutit précisément à refuser d’analyser une construction religieuse sous prétexte qu’on …pourrait ne pas croire. Cela équivaut à refuser d’étudier l’Etre sous prétexte qu’on pourrait ne pas être ! Surtout, la vision structuraliste, qui précisément décide de partir de l’analyse du discours et/ou de toute production religieuse, n’a que peut à voir avec une vision marxiste d’emblée disqualifiante pour les « superstructures idéologiques », selon la terminologie consacrée. Car si « La religion, c’est l’opium du peuple » (MARX), pourquoi étudier l’opium ?
-Refusant tout recours à l’explication par la transcendance, Gauchet réduit le religieux à sa fonction ecclésiale hiérarchique (les prêtres) et à sa dimension collective (institution). Or le religieux relève d’abord ou en tout cas autant d’une dimension intime et privée, ce qui est difficilement acceptable pour un penseur qui semble prendre ses distances avec le marxisme tout en démontrant sans le vouloir la difficulté à sortir de la Vulgate : particulièrement lorsqu’il apparaît qu’à ses yeux, toute conscience ne peut être que collective.
-Dans tous les cas, il s’agit d’affirmer le principe d’extériorité du religieux par rapport au social. On peut opposer ici les propos opposés de CLAUDE LEVI-STRAUSS concernant les Bororos du Brésil, chez qui « les croyances spirituelles et les habitudes quotidiennes se mêlent étroitement et il ne semble pas que les indigènes aient le sentiment de passer d’un système à un autre ». Et Lévi-Strauss d’élargir : « J’ai retrouvé cette religiosité bon enfant dans les temples bouddhistes de la frontière birmane où les bonzes vivent et dorment dans la salle affectée au culte, rangeant au pied de l’autel leurs pots de pommade et leur pharmacie personnelle et ne dédaignant pas de caresser leurs pupilles entre deux leçons d’alphabet » ( CLAUDE LEVI-STRAUSS ; « Tristes tropiques », Plon,1955, chap.XXIII, p.266).
et donc à la demande de mes petits chéris du groupe Sc-Po Celsa, je file directement par vent de travers babord amures vers le chapitre IV qui semble requérir les lumières du "capitaine". Que la foule impatiente se rassure: je reviendrai rapidement aux chapitres II,III. Pour l'heure, allez dans la paix du Seigneur!
IV/ L’Etat au miroir de la raison d’état.
ANALYSE :
-La raison d’état relève d’abord d’un discours sur elle largement répandu dans l’opinion, au-delà des professionnels de l’Etat. Sa puissance symbolique tient à son émergence aux XVI° et XVII) siècle en lieu et place de l’universalisme religieux et à la publicité qui lui est faite.
-Cette raison d’état s’installe de fait en France en pleine guerre des religions et dans le but de les apaiser en les transcendant. S’appuyant sur le politologue italien moderne BOTERO, Gauchet montre qu’on ne peut dissocier l’Etat du Prince et du Peuple. Rappelons à cet égard que les « Temps modernes » au sens historique (XVI°-XVIII° siècles) voient l’émergence des états-nations. De fait Gauchet rappelle que le terme d’Etat fait son apparition chez JEAN BODIN, MONTAIGNE,etc.
-Il y a un enjeu religieux du concept d’Etat dans la mesure où, pour les « politiques » (opposés aux dévôts restés fidèles à Rome, à l’universalisme chrétien et à l’Espagne en tant que son incarnation géographique) l’Etat restaure l’unité retrouvée après les guerres religieuses. C’est donc l’Etat qui prend en charge l’universel en englobant le religieux : « L’Etat n’est pas dans le religion mais la religion dans l’Etat » selon un anonyme de 1588. Pour Gauchet, le règne d’Henri IV, à partir de la conversion pragmatique du roi au catholicisme dominant de ses sujets, opère le transfert de religiosité sur l’Etat.
-A partir de là, identification de deux ordres :
* l’ordre religieux intime (quête du salut) que l’on retrouve en particulier dans le « sola fide » luthérien.
*l’ordre politique doté désormais de sa propre religiosité et, partant, l’autonomisation de la communauté politique en tant que réceptacle d’un accomplissement destiné à manifester la grandeur de Dieu dans un accroissement indéfini de la plénitude terrestre et humaine. On est là aux racines religieuses du fait national : désormais, l’universalité ne réside plus dans le genre humain mais dans l’Etat : c’est la ruine de la « societas christiana »
MES COMMENTAIRES 1 :
-La démonstration est pertinente dans la mesure où l’on passe de l’Etat médiéval entièrement immergé dans une légitimation chrétienne à une monarchie de droit divin où le divin glisse de Dieu à l’Etat via le monarque. G. cite Henri IV à juste titre mais je rappelle que c’est Louis XIV (1643-1715) qui « étatise » le plus la monarchie française (colbertisme, manufactures royales, recensement de Vauban, défense, marine…) et commence de fonder une élite d’Etat formée de roturiers talentueux.
-L’Etat n’absorbe pas entièrement le religieux qui, du hussisme de Bohême au jansénisme français en passant par le luthéranisme, devient le refuge de l’opposition à l’Etat tendanciellement totalitaire.
-G. oublie la permanence de l’idéal impérial universaliste du saint-Empire romain germanique du IX° au …XIX° siècle puisqu’autant c’est la conquête napoléonienne qui y met fin en 1806. Tous les princes et rois se portent candidats au poste envié d’empereur et rêvent du couronnement impérial papal à Aix-la-Chapelle ! Les Habsbourg d’Autriche maintiendront cet idéal jusqu’en…1918 via l’expérience austro-hongroise, cet état multiethnique, presque « fédéraliste » avant l’heure que la France jacobine et centralisatrice, mais aussi laïque et révolutionnaire n’aura de cesse d’abattre (thèse de Francois FEJTÖ dans « Requiem pour un empire défunt. La chute de l’empire austro-hongrois » chez Fayard.
SUITE DE L’ANALYSE :
-Sur la Raison d’état : G. la voit naître en France en 1635 quand Richelieu s’allie avec les « hérétiques » (Anglais, Hollandais) contre l’Espagne dans la mesure où il place les intérêts de l’état avant ceux de la foi. En cherchant le salut sur terre et non dans les cieux (comme au Moyen-âge), les serviteurs de l’Etat engagent aussi la cause de Dieu mais en transfèrent la substance vers le politique.
-Dans « Raisonner l’Etat : la pensée comme défense », Gauchet insiste sur le fait que l’Etat sert Dieu autant que le paradigme religieux. Par ailleurs, cet Etat s’arroge le monopole de la cohésion sociale en symbolisant le bien commun : de ce point de vue, l’Etat n’a pas de fins (finalités) car il est une finalité en soi. D’où la nécessité de réintroduire le bien commun comme une finalité spécifique au cœur de la définition de l’Etat pour éviter une autonomisation de la puissance publique.
MES REMARQUES 2
-Le meilleur passage de Gauchet dans ce chapitre où il aborde les origines de la réflexion sur Etat, société, bien public, opinion. Bien plus, il amorce une réflexion sur les dangers de l « autonomie des superstructures », c’est-à-dire le risque d’un fonctionnement endogène incontrôlé de la machine étatique, dont KAFKA décrira le mécanisme au plan romanesque «( « Le procès », « Le Château ») au début du XX° siècle et le philosophe marxiste italien ANTONIO GRAMSCI au plan théorique.
-Toutefois, Gauchet minimise quelque peu le poids du despotisme (qui n’est pas éclairé encore) et maximise le rôle d’un bien commun qui ne peut véritablement émerger avant la constitution d’une véritable opinion publique et d’une presse politique, soit la seconde moitié du XVIII° siècle et le temps des philosophes des Lumières.
FIN DE L’ANALYSE :
-« Du secret à la publicité de la politique » : pour G. justement, l’absolutisme est moins absolu dans la mesure où ses principes sont connus et reconnus et c’est l’Etat lui-même qui rend accessible l’identification à son point de vue. Inversement, le secret d’Etat participe d’un mystère de type religieux et exige la même soumission. Mais là encore, puisqu’il est déchiffrable, il est soumis à la controverse.
-En général, la démocratie balance entre secret et publicité.
MES REMARQUES 3.
-C’est pour moi le passage le plus discutable au sens propre (à discuter) ; il me semble que G. confond la publicité des intentions politiques et celle de l’Etat qui, par définition, n’a pas d’intentions mais seulement des réactions. Confusion à mes yeux de l’étatique et du politique comme il y avait pour moi confusion entre religio, spiritus et ecclesia dans les deux premiers chapitres. L’arbitraire monarchique, incarné dans le monopole de la violence d’Etat (la Question ou torture, mais aussi l’enfermement sans préavis par simple « lettre de cachet ») nous éloignent d’une « visibilité » des intentions, à moins de considérer que l’arbitraire est moins arbitraire d’être connu comme arbitraire !! Un Voltaire devra partir à l’assaut d’une forteresse aveugle- celle de l’absolutisme royal- pour obtenir la réhabilitation de Callas.






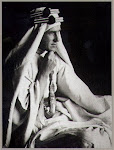
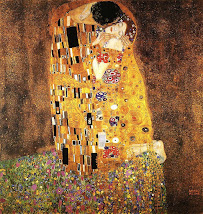


3 commentaires:
"G. reproche à Lévi-Strauss d’étudier les systèmes de croyances sans poser la question préalable du « pourquoi croire » ? Mais postuler cette question comme prémisse aboutit précisément à refuser d’analyser une construction religieuse sous prétexte qu’on …pourrait ne pas croire. Cela équivaut à refuser d’étudier l’Etre sous prétexte qu’on pourrait ne pas être !"
Autrement dit, Gauchet refuse de penser la nécéssité de la croyance en niant le lien qui existe entre l'etre et la croyance.Si j' ai bien compris, gauchet liquide l'idée d'Eliade selon laquelle c'est le sacré(qui implique une croyance)qui produit l'existance.
Dans ce cas , la religion doit elle etre pensée automatiquemet comme nécéssité, ou reprochez vous juste a gauchet d'etre trop categorique?
Une autre interrogation me vient a l'idée que le réel c'est le sacré.
En effet, dans l'acte par lequel le sacré surgit dans le prophane, ouvrant par la l'espace de sens constitutif de l'existence, est réalisé par l'homme.Autrement dit, la hierophanie suppose implicitement que c'est l'homme qui décide du monde puisqu'il a la capacité de donner du sens aux choses.C'est la le paradoxe: le sacré, ce qui est censé dépasser l'homme implique en réalité l'anthropocentrisme le plus radical.A l'inverse, considérer que le monde réel est celui qui se définit en dehors du sacré revient a poser l'homme devant un monde exterieur a lui, qui advient avant et apres lui,qui n'est pas une émanation de la pensée.
Or, lorsque gauchet parle de l' aspect totalisant du sacré, il fait réferrence a son instrumentalisation qui sert a une société primitive ou a un état pour se placer en exteriotité et régir les moindres aspects de l' existence.
Or, si on part du postulat d'Eliade, le sacré n' est plus totalitaire de facon instrumentale, il est totalitaire on pourrait presque dire par principe.En effet,si sacré = réel, alors pensée = réel.Or, ce présupposé qui consiste a dire que le toute chose n'existe que pas la pensée ouvre la voie d'une toute puissance (qui controle la pensée controle tout)qui anime l'entreprise totalitaire.L'Etat peut se permettre sous cette condition de devenir l'égal d'un Dieu et d'acquérir sa religiosité propre.
C'est un raisonnement un peu tiré par les cheveux et je m'était embrouillé dans mon explication.
Quentin, vous êtes sur tous les fronts tel Roland à Roncevaux. Non, votre raisonnement se tient et d'ailleurs Gauchet montre dans le chapitre IV cette émergence d'une religion de l'Etat proprement totalitaire ou en tout cas possiblement. Oui, le paradoxe de Dieu, c'est peut-être d'exister parce que je le fais exister à l'image du monde que je crée par ma parole et auquel je donne sens par l'intermédiaire du mythe.
Pensez à dormir!
Le "Capitaine".
Quentin, faites-vous usage de produits stupéfiants? Si oui lesquel? En tous suivez les conseils du "capitaine", ...et laissez-nous dormir, si vous ne vous reposez jamais.
Enregistrer un commentaire