AUTOUR DE VIOLENCE ET NATIONALISME DE XAVIER CRETTIEZ . (Prépa IEP de province).
Voici quelques réflexions et approfondissements sur la question des liens entre violence et nationalisme :
-1 : bien modéliser le concept de nationalisme : il y a les nationalismes « universalisants » du type nationalisme français ou pangermanisme allemand,etc. et il y a les micro-nationalismes de type nationalisme magyar (hongrois) des XVIII-XIX° siècle ou serbe du XX°. En aucun cas l’usage de la violence politique ne peut homogénéiser les différents types de nationalismes. Les exemples rwandais et irlandais ressortissent à mes yeux davantage de micro-nationalismes situés aux franges des « ethnismes » (célébration d’une micro-culture ou d’une ethnie). Dans ces deux derniers cas, la violence est inhérente au combat « national » et ne se légitime que par rapport à elle-même, quand la violence n’est pas inhérente à la culture ethnique (sociétés primitives). Dans le cas des nationalismes « macro », la violence est un recours parmi d’autres nécessitant une légitimation idéologique : nationalismes européens du XIX° et du XX° siècles, nationalisme américain, panslavisme (cf infra).
-2 : le nationalisme comme « réenchantement » ; décidemment, Gauchet est partout ! Le concept se tient : le nationalisme français fin XIX°-début XX° est censé proposer un nouvel idéal collectif ; idem pour le pangermanisme. La violence sera alors considérée comme une sorte de rite de passage collectif pour toute une génération, assoiffée d’aventure et de défi. Zeev Sternhell rappelle cet aspect des choses quand il analyse l’hyper-nationalisme français pré-fasciste des débuts de la III° République (« Ni droite ni gauche : l’idéologie fasciste en France »).
Toutefois, il existe des contre-exemples dont le plus célèbre reste la tentative austro-hongroise d’empire multi-ethnique, en particulier de 1867 (compromis austro-hongrois) et 1914. La violence nationaliste est alors du côté des Hongrois ou des Serbes qui usent-surtout les seconds-de la violence terroriste contre Vienne. Ici, le réenchantement se fait dans le cadre de la Vienne « fin de siècle », véritable creuset culturel autour de Vienne-Prague-Budapest (voir ici Karl Schorske ; « Vienne fin de siècle :politique et culture » dont je donne un résumé sur ce même blog à la rubrique « Mitteleuropa »). Contre les nationalismes allemand, magyar et balkanique, François-Joseph oppose une monarchie bi-voire tricéphale où les nationalismes se diluent dans une sorte de « métissage culturel ». Cela suppose une relation à l « autre » différente que dans l’Etat-nation traditionnel dont la réification contient, inhérente, la notion de confrontation avec d’autres états-nations, donc la violence. L’échec de la solution viennoise laissera libre-cours au pangermanisme musclé de la fin du XIX° siècle (Voir l’action de Schönerer en Autriche). C’est un peu – mais un peu seulement- dans la même acception que les ligues patriotiques et antisémites françaises se lèvent contre le « cosmopolitisme » juif et l’universalisme républicain au début de la III° République.
-3 : la violence comme signe d’un mal-être identitaire lié à la modernité : attention ! Ici la violence révèle surtout une incapacité de certaines religiosités, nationalités et groupes divers à penser la modernité hors d’un cadre religieux de type conflictuel-apocalyptique et d’assumer le nécessaire aggiornamento religieux-culturel qu’impose l’accession à cette modernité indépendamment de ses ambigüités. En gros, l’échec des sociétés musulmanes à penser la modernité en termes non-religieux les amènent à une réaction anti-moderne et à un terrorisme millénariste du type Al Qaïda. Mais les groupuscules fondamentalistes se sont très rapidement emparés des outils de la modernité pour amplifier leur rhétorique (Internet/Télévision). Sur la violence islamique de type fondamentalisme liée à la difficulté à penser la modernité, cf BERNARD LEWIS, « What went wrong ».
-4 : Religion/nation : oui, la religion peut défendre une idée nationale et un nationalisme s’apparenter à une mystique religieuse :
-LUTHER, dans les années 1520, lance une « adresse à la nation allemande » et le luthéranisme est une des bases du nationalisme moderne allemand, avec son culte simplifié, son intellectualisme, son exégèse biblique, sa volonté de faire partager les textes bibliques au plus grand nombre en les traduisant en langues nationales. Un protestantisme taillé sur mesure pour la bourgeoisie commerçante hanséatique. En 1648, après la terrible guerre de Trente ans déclenchée par la bataille de la Montagne Blanche en Bohême consécutive aux oppositions violentes (défénestration de Prague de 1620), un accord de paix a lieu sur la base « cujus regio, ejus religio », c’est-à-dire à chaque région sa religion.
-Par ailleurs, le nationalisme peut apparaître comme une forme de religion, au double sens de croyance eschatologique et d’outil pour « relier » les hommes. De fait cette « religion nationale » peut amener le groupe nationaliste vers le totalitarisme et la violence au nom de la défense d’une cause sacrée qui, par sa sacralité même, légitime l’usage de la violence. Cette mysthique nationale et révolutionnaire anime les révolutionnaires de 89-94, persuadés de détenir la Vérité et partant estimant légitime de la porter hors des frontières sous la forme de la guerre révolutionnaire ( de Valmy à Rivoli). La violence révolutionnaire revendiquée par Robespierre s’ancre dans la rationalité supérieure de l’idéologie révolutionnaire. Les Jacobins ne légitiment pas seulement la violence des groupes révolutionnaires, mais celle de l’Etat révolutionnaire : c’est le « despotisme de la liberté » de 1793-1794, c’est la « fin justifie les moyens », argument in fine des nationalistes et des révolutionnaires. Quand la France de 1991-2007 s’oppose aux guerre irakiennes des USA, elle avance l’idée qu’on n’exporte pas la démocratie dans des fourgons blindés, qu’on ne décrète pas la Liberté. Bonne évolution, au sens où il s’agit ici d’une conversion à l’éthique d’adhésion contre l’éthique de conviction chère à nos amis d’outre-Atlantique, car, de 1792 à 1815, la France robespierro-bonapartiste a bel et bien cherché à imposer les idées françaises par la force !
-5 : Rationalité de la violence nationaliste ; il s’agit d’interpeller l’Etat pour se faire reconnaître, cas de la Corse ou de l’ETA. Certes, mais le FLNC et l’ETA méprisant cet Etat « colonialiste » cherchent surtout à subvertir l’Etat, au même titre que les terrorismes intérieurs idéologiques, du type bande à Baader en Allemagne et Brigades rouges en Italie dans les années 70-80 ou Action Directe en France durant la même période. L’interpellation de l’Etat vise d’abord à légitimer le combat micro-nationaliste auprès d’une opinion. L’assassinat du préfet Erignac en Corse illustre à merveille ce double mouvement de rhétorique justifiante et de violence « rationnelle ». On touche ici à un autre thème abordé par C., à savoir le « cadre cognitif de crise » mis en œuvre par un Etat pour préparer les masses à l’usage d’une violence de type nationaliste. Les « entrepreneurs » de violence diffusent une lecture rationalisée de l’usage de cette violence : thèse de la trahison des Juifs pendant la première guerre mondiale chez les nazis pour justifier la violence à l’égard des Juifs à partir de 1933 ; légitimation de la Terreur policière dans les régimes communistes par la nécessité de traquer les contre-révolutionnaires et da sauver la « pureté » révolutionnaire. On trouve cela dans toute la période lénino-stalinienne en URSS et, plus proche chronologiquement, dans la Serbie de Milosevic entre 1989 et 1995 quand la pseudo « Académie des Sciences » de Belgrade justifie par avance la purification ethnique des Croates et Bosniaques, communautés « inférieures » par rapport à la Grande Serbie « martyrisée » depuis sa défaite lors de la bataille du Kosovo (ou du champ des merles ») au XIII° siècle. Les viols de femmes bosniaques, systématiquement organisés dans une optique de souillure et de « marquage » toucheront 88000 femmes et jeunes filles ! Je rappelle toutefois que le modèle de cette violence au nom d’une rationalité et d’une vérité supérieures reste celui de la révolution française, ce dont Crettiez convient d’ailleurs.
-6 : à propos des génocides : ne pas les mélanger en un même syndrôme génocidaire ; du côté du Rwanda, compter avec la violence tribale traditionnelle depuis les origines (rites de passage pour les jeunes adultes, violence de « dépense » au sens où l’entend G.BATAILLE) et l’opposition séculaire entre TUTSIS nomades (sorte d’aristocratie de cavaliers jalousés par les Hutus) et HUTUS paysans sédentaires. Ne pas négliger l’irrationalisme tribal-ethnique et…l’alcool !. Je rappelle que l’usage de la machette renvoie également à l’univers magique sacrificatoire. Nous sommes dans un univers sans Etat, donc, sans rationalité étatique de l’usage de la violence.
Dans les Balkans (89-95), au Cambodge à l’époque de Pol-pot et des Khmers rouges (75-79) comme dans la Chine de Mao ou l’Indonésie de Soekarno (massacre des communistes indonésiens dans les années 1960), la violence est étatisée et rationalisée. Il s’agit tout autant de défendre un nationalisme qu’un Etat totalitaire hégémonique. Là où les deux cas se rejoignent, c’est bien sûr dans la négation du terme de « génocide » et le contrôle de cette négation dans les media.
-7 ; Conditionnement à la participation.
Crettiez rappelle comment le terrorisme fonctionne par dépersonnalisation, effet de groupe et jouissance de la transgression et de la clandestinité. La mise à distance de la violence par les groupes terroristes participe là encore d’une « rationalité révolutionnaire » opposée à la rationalité étatique : quand Action Directe assassine dans les années 1980 le pdg de Renault Georges BESSE ou quand les Brigades rouges enlèvent et assassinent ALDO MORO, leader de la Démocratie italienne dans les années 1970, les terroristes estiment qu’ils combattent la violence capitaliste et administrent la « justice populaire ». Il s’agit là tout à la fois de légitimer une violence politique de groupuscule et d’évacuer la violence même de l’acte. Sans doute est-ce là, une nouvelle fois, que l’on touche à la différence radicale entre la violence d’Etat (ou violence de la raison d’Etat) rationnelle et institutionnelle et la violence privée ou « clanique » toujours aux franges de la pure « vendetta » comme le note d’ailleurs Crettiez à proposde la Corse.
La soumission à l’autorité : c’est l’obéissance aux ordres présentée comme justification de l’acquiescement à une violence institutionnalisée. Cas de BOUSQUET et de PAPON par exemple. Une chaîne de déresponsabilisation qui segmente la participation au crime et par là l’évacue : cas de la SHOAH dans la présentation qu’en fait CLAUDE LANZMANN dans le film homonyme.
-8 ; Le retour du nationalisme en Europe depuis 1989 : Crettiez parle du cas allemand ce qui est très étonnant dans la mesure où la démocratie allemande, marquée à vie par le nazisme, convertie définitivement au fédéralisme et à la démocratie économique et sociale véhicule davantage un discours national qu’un discours européen. Le souverainisme français larvé me semble plus significatif, ainsi que le nationalisme russe instrumentalisé par BORIS ELTSINE et VLADIMIR POUTINE.
Sur le plan historique, il est discutable de mettre tous les nationalismes dans le même panier : il faut distinguer en effet les nationalismes eschatologiques globalisants à prétention universaliste comme le pangermanisme ou le nationalisme français issu de la Révolution française et les micro-nationalismes a-étatiques à ressorts surtout claniques du type corse ou basque qui, toutes proportions gardées, s’apparentent plus aux ethnismes de type africain. Nationalisme renvoie à nation, c’est-à-dire à un ensemble très global ouvert sur l’extérieur, ne serait-ce que pour affirmer cette supériorité quasi-raciale que note Crettiez. Les « nationalismes » africains et les guerres nationales de ce continent me semblent davantage axées sur un repli identitaire (type Tchad ou Darfour) endogène. EUGEN WEBER (« La fin des terroirs ») montre bien comment en France au tournant des XIX° et XX° siècles, le nationalisme universaliste républicain s’impose aux particularismes régionaux (Bretagne, Occitanie, Provence…) au plan institutionnel et culturel, en particulier linguistique. Il est d’ailleurs abusif de désigner ces derniers de « nationalismes » alors qu’il s’agit de protestation identitaire régionaliste : à bien des égards, notre auteur confond nationalismes et régionalismes, tant en ce qui concerne l’Europe que l’Afrique. L’opposition régionaliste violente n’est d’ailleurs pas une fatalité comme le montre les cas écossais et gallois côté britannique. En général, les soulèvements régionalistes sont d’autant plus puissants que l’Etat s’avère autoritaire.
-9 ; Terrorisme et violence identitaire : oui, il n’y a plus de guerres au sens classique, du moins de moins en moins mais elles son remplacées par une guerilla planétaire à l’image du « village planétaire » médiatique cher à MARSHALL MCLUHAN. Dans le cas des terroristes de type kamikaze, il me semble entrevoir une violence eschatologique, apocalyptique de type millénariste dont l’eschatologie même fournit la légitimation. A la différence de la violence nationaliste, cherchant toujours une justification rationalisante, cette violence religieuse cherche et trouve sa justification dans l’au-delà : œuvrer pour Allah et rejoindre le paradis d’Allah sont les motivations des commandos du 11 septembre, identiques à celles des « haschichins » du XII° siècle.
-10 : nationalisme, ethnisme, violence : cas serbe en 91-95 et russe depuis 91. Il s’agit d’instrumentaliser une « pureté » nationale contre tout sécessionisme ethnique ou nationaliste. Dans l’ère post-communiste, le nationalisme musclé fonctionne comme substitut à l’internationalisme « prolétarien » ; cas du conflit en Tchétchénie, mais aussi dans l’opposition de la Géorgie et de l’Ukraine à l’impérialisme grand-russe. Créttiez rappelle à cet égard à juste titre que FEARON et LAÏTIN parlent de « manipulation de l’ethnicité par des acteurs politiques décisionnaires » ». Voir le cas de la petite Ossétie du Nord, manipulée par Moscou qui revendique son maintient dans l’Empire à la différence de l’Ossétie du Sud qui vise à l’émancipation. Mais on a ici tout autant qu’une « violence » nationaliste (des deux côtés d’ailleurs, du côté de l’Empire et du côté des minorités soulevées- une stratégie impériale classique de contrôle du centre sur la périphérie, permanente en Russie de l’ancien régime à l’époque actuelle via l’ère communiste. A noter toutefois que l’identification par la violence nationaliste constitue un mécanisme sans fin de « violences-gigognes » ou d’identités-gigognes ; voyez le nationalisme tchèque qui entre en conflit avec l’empire austro-hongrois avant 1914, obtient l’indépendance en 1919, puis, après l’ère communiste, en 1994, entre en conflit avec une identité slovaque obtenant la scission en 1994 (certes sans violence) mais bientôt en but à la révolte (violente elle sous formes de manifestations musclées, de pillages) des tziganes,etc, etc, etc.D’où la thèse de CONNOR, rappelée à juste titre par Créttiez et selon laquelle c’est de la confrontation avec l’altérité que le groupe acquiert la conscience de lui-même comme nation. De là, on pourrait extrapoler à partir des violences urbaines de 2005 en France, visiblement instrumentalisées par des jeunes issus de l’immigration totalement désidentifiés. Mais nous ne sommes plus dans le nationalisme mais bien dans le mal-être collectif et des pathologies individuelles que Créttiez aborde mais qui ne relèvent plus à mon sens du domaine strictement socio-politique.
Pour conclure : l’auteur aborde 4 grands thèmes :
-les relations entre fondamentalisme religieux et nationalisme : le cas iranien me semble une bonne illustration de l’utilisation d’une rhétorique religieuse au service d’un nationalisme (chiisme et bombe atomique), mais aussi le Pakistan voire l’Arabie saoudite. A noter que les USA utilisent une même thématique eschatologique pour justifier ses interventions récurrentes hors de ses frontières tout au long du XX° siècle.
-La violence comme d’obtention du pouvoir : c’est moins original et assez évident ce qui amène à une lecture instrumentale de la violence d’Etat et de la violence micro-nationale. Toutefois, il faudrait nuancer la notion de violence ; c’est une chose d’imposer par la force le français aux Bretons ou au provençaux, une autre de plastiquer des préfectures ou d’assassiner des préfets ! Le livre pêche un peu par globalisation, et du concept de violence, et du concept de nationalisme.
-La violence comme prédisposition et non comme déviance : là encore, tout dépend de l’angle de vue. On peut torturer pragmatiquement ( quête de renseignements) et par sadisme. Voir ici la notion à mes yeux fondamentale de « banalité du mal » chère à HANNA ARENDT.
-La violence nationaliste comme « réenchantement « de la modernité : on peut le voir en Europe et en particulier en France avant 1914 quand futurisme, nationalisme et antisémitisme (pris en charge par une vision « impérialiste » là encore au sens arendtien) entendent sortir du « vieux monde » et accoucher d’une modernité. De nos jours, les intégrismes et fondamentalismes cherchent à respiritualiser l’univers au risque d’une guerre des civilisations au sens huntingtonien du terme. Mais la globalisation n’est-elle une autre forme de violence à l’égard des peuples périphériques à l « imperium » libéral, un réenchantement par le marché unique et la téléexistence virtuelle où PAUL VIRILIO (« La vitesse de libération ») voit l’agonie du monde réel ?
Deux dernière remarques critiques : l’Irak n’est pas une nation et Créttiez a tort d’y voir une violence nationale ; il s’agit d’une guerre civile entre factions religieuses (chiites, sunnites et kurdes) qui, précisément, ne parviennent pas à fonder une nation du fait de leur approche strictement communautaire et religieuse de la lutte politique. En général, en terre d’Islam, seule compte l « UMMA », la communauté, cimentée par la SUNNA (tradition) instrumentalisée par la CHARIA (loi religieuse). Ces pays ont zappé la phase national-humaniste (XVI°-XVIII°) nécessaire à l’installation d’une pensée politique et sociale indépendante de la tradition religieuse (LEWIS, cf supra).
Quant à la Corse, il s’agit, comme au pays basque ou en Irlande d’un régionalisme développé en nationalisme mais qui, là encore, pêche par absence d’une « universalité » nationale. Provincialisme et régionalismes sont-ils vraiment des nationalismes ?
Bonne chance et bon courage à tous!!"Le Capitaine".






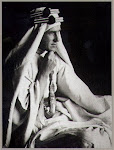
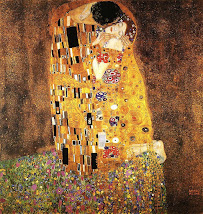


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire