LES MUTATIONS DE LA FAMILLE :
APPROCHE SOCIOLOGIQUE.
I/Une approche diachronique.
A.La part des facteurs démographiques et
économiques.
B.Les nouveaux modèles familiaux.
C.La famille entre étatisation et
privatisation.
II/Une approche synchronique.
A.Une individualisation de la vie
familiale. (Approche libérale).
B.Le droit face au « démariage » :
permanence institutionnelle.
C.La part de l’Histoire et la « trame
conjugale » : récurrence des « habitus ».
Ce n’est un mystère pour personne qu’il y
a différentes approches de la famille en France. Le récent débat sur le Pacs,
l’adoption, le « mariage pour tous », la GPA/PMA, mais aussi les différentes enquêtes et rapports sur la
famille du professeur Hauser et de Mme Théry montrent à l’envie combien la
sociologie de la famille doit se décliner au pluriel.
1. Approche diachronique
Le premier article de Kellerhals et Roussel montre non seulement la pluralité
des approches mais aussi l’extrême variété des directions dans lesquelles sont
menées les recherches en sociologie de la famille entre 1965 et 1985. Les
auteurs relèvent 12 « problèmes-clés que l’actualité, démographique surtout, a
posés à la sociologie de la famille. Ils tentent, à travers eux, de repérer les
tendances dominantes des recherches dans ce domaine :
1. Le choc de l’évolution démographique à travers ses indicateurs les plus
courants : Taux de nuptialité, taux de fécondité, taux de naissance hors
mariage, taux de divortialité. Comment rendre compte de ces mutations ? Les
points qui suivent présentent des tentatives d’explicitation.
2. La place de plus en plus importante des femmes sur le marché du travail
salarié a bouleversé le marché de l’emploi mais aussi la vie familiale dans
toutes ses dimensions.
3. Un rapport à la fécondité modifié par des causes exogènes comme la
contraception et la législation afférente ; une diminution du taux de fécondité
; un autre rapport à l’enfant (sens de l’enfant, rang de l’enfant dans la
fratrie, programmation des naissances en fonction du travail, …) ont fait
l’objet de nombreuses études.
4. L’augmentation du taux de divortialité n’est pas sans lien avec l’accès des
femmes au travail et donc à une autonomie de revenu. Cette augmentation se
traduit par une croissance corrélative des familles « recomposées ». Les
ruptures seraient entre autres causées par un certain irréalisme quant à ce que
l’on peut attendre de la vie de couple ou à une baisse de l’homogamie.
5. De nouveaux modèles familiaux. Les familles se fondent sur d’autres
principes que dans les décennies précédentes et l’on peut repérer une plus
grande diversité des styles relationnels familiaux (fusionnel, consensuel,
communicationnel, …)
6. L’homogamie qui perdure. Ce point semble en contradiction avec le point 4.
En fait si elle demeure majoritaire, les études montrent qu’elle baisse un peu.
7. Un réseau familial fort.
8. Croissance des unions libres
9. La hantise de la normalité
10. Evolution du droit de la famille.
11. Une intervention de l’état croissante dans la politique familiale.
12. Une évolution des familles qui se ferait au carrefour de trois dominantes :
privatisation, pluralisation et normalisation.
Une petite analyse de l’article et de
cette grille de lecture montre que le rapport entre vie familiale, vie
conjugale et vie économique n’est pas traité pour lui-même. Ce n’est pourtant
pas faute d’y avoir pensé. Les auteurs de l’article écrivent en effet à propos
de la chute du taux de nuptialité et des indicateurs familiaux : « La crise
économique aurait pu être avancée comme explication générale. Mais les
changements démographiques l’avaient devancée et les pays qui paraissent
aujourd’hui les mieux protégés contre la récession sont souvent ceux-là mêmes
qui accusent les plus fortes perturbations dans le domaine de la famille. »(25)
Cette remarque sur la crise économique me semble bien rapide. En 1987, date à
laquelle l’article est publié, Les chiffres disponibles étaient probablement
ceux de 1985. La crise battait déjà son plein et il me semble qu’il était déjà
possible de lui reconnaître une influence importante sur l’évolution des
indicateurs familiaux que sont les taux de nuptialité et de naissance hors
mariage. Si de 1965 à 1975 les courbes des taux de chômage et de nuptialité
semblent sans rapport l’une avec l’autre, on ne peut en dire autant entre 1975
et 1985.
Il est possible que les rédacteurs de l’article n’aient pas eu l’occasion de
construire ce graphe. Il témoigne pour eux en ce sens que les 10 premières années
de leur période d’étude apparaissent sans lien aucun avec le taux de chômage,
mais aussi parce qu’effectivement, la chute du taux de nuptialité précède de
deux ans la très forte augmentation du taux de chômage. En revanche, il me
semble que notre graphe 5 révèle une analyse de Roussel et Kellerhals par trop
approximative pour la dernière décennie de leur étude (75-85).
2. Approche synchronique
L’article de Jean-Hugues Déchaux porte essentiellement sur l’actualité de
l’édition en sociologie de la famille au cours des années 1992-1993. A partir
des ouvrages de François de Singly, Irène Théry, Jean-Claude Kaufmann et de
Martine Ségalen (26), l’auteur montre
qu’il est possible de distribuer les publications en sociologie(s) de la
famille selon quatre critères. D’une part la sociologie de la famille adopte
soit le point de vue de la conjugalité
soit le point de vue de la parentalité.
D’autre part, si chacune de ces approches atteste d’une désinstitutionnalisation du
mariage, les auteurs ne lui attribuent pas forcément la même importance.
Disons,
pour commenter la notion de version +, qu’il s’agit pour les auteurs
d’accompagner cette désinstitutionnalisation soit parce qu’ils la croient
inévitable soit parce qu’ils l’appellent de leurs vœux ; tandis que pour ceux
qui sont concernés par la version -, il s’agit plutôt de dire : « oui, il y a
une désinstitutionnalisation mais l’institution revient autrement ».
J.-H. Déchaux ne place pas les auteurs dans son tableau, mais il me semble
qu’après une analyse des commentaires qu’il fait et notre propre lecture des
ouvrages cités, on ne peut aboutir qu’à ce résultat.
Il faut aussi noter que l’auteur de l’article adresse un reproche collectif à
ceux qui concluent à la désinstitutionnalisation familiale qui interprètent le
concept d’institution surtout dans un sens plus juridique que sociologique(28) . Ce reproche
s’adresse principalement à F. de Singly et I. Théry.
Enfin, la conclusion de Jean-Hugues Déchaux montre combien il est difficile aux
sociologues de ne pas se laisser influencer par leurs valeurs personnelles : «
L’analyse du traitement de la temporalité confirme par ces différentes
sociologies de la famille la pertinence de notre grille d’analyse et met donc
en évidence les positions morales et politiques qui sont les leurs quant à la
modernité. Se trouve par-là rappelé que le débat moral n’est jamais
véritablement absent des discussions scientifiques. »(29) Toute la
question, en ce qui nous concerne, est lorsque nous ferons le choix d’une
sociologie de la famille, sera-ce pour des raisons scientifiques ou pour des
raisons morales ?
Reprenons ces auteurs de manière un peu plus précise.
a. François de Singly
François de Singly est actuellement professeur à la Sorbonne, Directeur du
centre de recherches en sociologie de la famille. C’est un des ténors de la
sociologie de la famille en France. Il publie beaucoup, des livres comme des
articles. Il est invité régulièrement dans des colloques universitaires et
autour des micros de la télévision ou de la radio. C’est dire l’importance de
son influence.
L’ouvrage qu’il a publié en 1993, Sociologie
de la famille contemporaine, Paris, Nathan université, Coll.
128, 128 pages, fait partie d’une collection destinée aux étudiants en
sociologie avec objectif pédagogique. Il s’agit, en 128 pages, de fournir une
présentation didactique des enjeux d’une question et de proposer une
bibliographie commentée (très utile et bien faite).
Une lecture attentive du plan et de l’introduction montre à l’évidence le
chemin que l’auteur nous propose de parcourir. Il y a selon l’auteur un
mouvement radical vers l’individualisation
de la réalité familiale. Et à mesure que cette individualisation s’opère,
on peut observer une intervention croissante de l’état ou encore « une
socialisation de la sphère privée ». Les trois têtes de chapitre le montrent
aisément :
1. La dépendance de la famille par
rapport à l’état.
2. L’autonomie de la famille
contemporaine par rapport à la parenté.
3. L’autonomisation de l’individu par
rapport à la famille contemporaine
Cette évolution que F. de Singly
interprète comme individualisation de la vie familiale est une constante qu’il
maintient et réaffirme régulièrement. Cette position de 1993 se retrouve encore
en 1996 lorsque François de Singly
publie Le soi, le couple et la famille, où il affirme en quatrième de
couverture : « Oui, la famille a changé.
Non seulement son cadre institutionnel a craqué, mais sa fonction centrale
s’est également modifiée. Son rôle premier a longtemps été la transmission du
patrimoine, économique et moral, d’une génération à l’autre. Aujourd’hui la
famille tend à privilégier la construction de l’identité personnelle, aussi
bien dans les relations conjugales que dans celles entre parents et enfants. »(30)
Plus récemment encore, François de Singly et Véronique Munoz-Dardé ont publié
un article dans Le Monde (31) intitulé : «
Pour le pluralisme des formes de la vie privée ». Cette chronique, par-delà
l’analyse du Pacs qu’elle propose, permet aux auteurs de dévoiler leur vision
de l’avenir sur l’intervention de l’état dans la conjugalité et la parentalité.
L’option libérale est mise en avant pour tout ce qui concerne la conjugalité :
A plus long terme, au nom de quoi
justifier que l’Etat ait pour fonction centrale de reconnaître, de valider
certaines unions plutôt que d’autres ? Pourquoi la vie à deux, toute vie à
deux, ne serait-elle pas exclusivement une vie privée sans statut public ?
Pourquoi l’Etat n’interviendrait-il pas uniquement (au niveau d’un statut)
lorsque apparaît un tiers, l’enfant, dont il se porterait garant ? En
s’engageant à élever tel enfant, les hommes et les femmes obtiendraient la
reconnaissance du statut de " parent ". La " famille avec enfant
" serait publique (avec statut), et le couple serait privé (sans statut).
Cette option plus libérale, revenant à remettre en question le mariage, a pour
intérêt de limiter l’influence de l’Etat et, par-là, sa zone de contrôle.
L’Etat n’aurait plus à codifier les bonnes formes de vie commune, il limiterait
son action à définir les bonnes conditions pour la vie des enfants.
Nous sommes ici en présence d’une option très libérale qui s’appuie sur la
neutralité de l’état. La désinstitutionnalisation du mariage est pour l’auteur
un vœu. Il a à notre sens une position militante dans sa sociologie. Cela
confirme les conclusions de Jean-Hugues Déchaux à propos de la morale qui se
révèle dans la sociologie. Peut-on en déduire que les analyses déployées par
François de Singly dans son ouvrage sur la sociologie de la famille en France
sont sous-tendues par une telle vision ? C’est plus que probable. En tout cas,
le passage de la description à l’interprétation est ici tout particulièrement
sujet à caution.
b. Irène Théry
Mme Irène Théry est aussi très connue dans le paysage français de la sociologie
de la famille. Elle a publié Le
démariage (32) qui fait l’objet
d’une analyse de Jean-Hugues Déchaux, et parmi une bibliographie abondante,
elle a aussi publié un article (33) qui est une
forme de synthèse de ses positions : « Différence des sexes et différence des
générations » en 1996. Sa notoriété lui a valu la commande d’un rapport
important sur la famille en France commandé par la Garde des Sceaux Ministre de
la Justice, Mme Elisabeth Guigou et par la Ministre de l’Emploi et de la
Solidarité, Mme Martine Aubry. Ce rapport intitulé Couple, filiation et parenté
aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée a
été publié en juin 1998.
Mme Théry est une sociologue spécialiste du droit. Son attachement à cette
discipline est sensible dans l’ensemble de ses écrits. Jean-Hugues Déchaux le
constate aussi à sa manière : « On sent chez I. Théry un authentique regret du
déclin symbolique profond que connaît le droit »(34). Et l’on sent
bien qu’elle n’est pas prête à brader aussi facilement que F. de Singly le
cadre juridique qui entoure la réalité complexe de la famille en France tant au
niveau de la conjugalité qu’au niveau de la parenté.
Irène Théry est à l’origine du concept
de « famille recomposée » pour essayer de rendre compte de la réalité
sociale en voie de modification rapide. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est
surtout le concept de démariage que l’on ne peut assimiler purement et
simplement à celui de divorce dans la pensée d’Irène Théry. Le démariage
traduit pour I. Théry la remise en cause par la société contemporaine de la
place symbolique que tenait le mariage il n’y a pas si longtemps encore. Se
fondant sur des observations semblables à celles de F. de Singly, elle réalise
dans son rapport rédigé en juin 1998 une synthèse de son concept du démariage :
Mme Théry affirme que « c’est la place
sociale de l’institution matrimoniale qui a changé avec la transformation des
représentations du couple : le choix de se marier ou non devient une question
de conscience personnelle et le mariage cesse d’être l’horizon indépassable des
relations entre les hommes et les femmes. C’est ce phénomène social que l’on a
nommé le "démariage" »(35).
Ce
concept n’est pas réductible au divorce dans la pensée de Mme Théry même s’il
l’inclut. En fait elle le définit sur trois niveaux : « au sens juridique, le
démariage n’est pas autre chose que le divorce ; au sens social et culturel,
c’est le bouleversement de l’ordre symbolique qu’entraîne la privatisation du
lien matrimonial. Mais le démariage a aussi un sens idéologique : c’est un
certain idéal de ce que doit être, hors du droit, la négociation d’une rupture
amoureuse »(36). Le concept de
démariage inclut donc non seulement les séparations mais aussi le refus du
mariage, le phénomène de cohabitation durable et sans doute aussi les
recompositions familiales.
Le démariage a pour conséquence la
désarticulation de la conjugalité et de la filiation. Il est vrai que
l’évolution récente du droit de la famille a entériné deux évolutions inverses
: d’une part il est possible de divorcer à l’amiable, c’est donc une prime à
l’individualisation de la conjugalité ; d’autre part on ne peut abandonner sa
responsabilité de parent, on ne « divorce » pas de ses enfants. Ce qu’exprime
parfaitement l’auteur dans sa conclusion : « L’idéal d’indissolubilité de la filiation doit désormais se substituer
à celui de l’indissolubilité matrimoniale, sous peine de mettre en cause les
droits et les devoirs que tout adulte doit assumer dès lors que, par cet autre
acte de volonté qu’est la reconnaissance de l’enfant, il a assumé d’en être le
parent. C’est la conséquence de la liberté des adultes de ne pas se marier, de
se marier, de se démarier, et cela implique forcément, en cas de séparation, de
respecter les liens de l’autre parent à l’enfant. »(37) En fait, il
faudrait dire plus encore, car l’état oblige non seulement au respect de l’autre
parent mais aussi le parent lui-même à ne pas abandonner toute responsabilité
quant à l’éducation de son enfant. L’état intervient alors de manière très
ferme en contraignant à la coresponsabilité en matière d’éducation, malgré le
divorce et quoiqu’il coûte de la complexité qu’apporte l’arrivée d’un ou de
deux beaux-parents. Sans doute est-ce cela qui amène I. Théry à dire, dans son
article de 1996, que « la famille n’est
plus pensée comme une institution parce qu’elle est devenue une institution
impensable »(38). Cependant, la
juste perception de la complexité de la situation conduit l’auteur à penser que
« le démariage, qu’on le perçoive ou non, a mis à l’ordre du jour la nécessité
de refonder, autrement, mais véritablement l’ordre symbolique de la famille et
de la parenté »(39). Or, suffit-il
d’un livre pour fonder ou refonder un ordre symbolique qui s’est construit au
fil des siècles ? Ou, en sens contraire, peut-on croire sérieusement qu’un
ordre symbolique qui aurait tant de racines, puisse s’effondrer en à peine
trente ans ? Quel est le sens de l’histoire longue, de la tradition longue de
notre auteur qui est pourtant si attaché au droit ?
Manifestement, ce qui emporte son jugement pour ouvrir la symbolique du droit
aux nouvelles situations est non seulement leur nombre (de fait incontestable)
mais aussi une certaine complaisance aux
discours convenus de cette fin de siècle qui font une place sans équivalent
dans l’histoire à la nature privée, individuelle, de toute personne. Le
droit doit accompagner cette volonté privée et I. Théry a beau vouloir tenir au
droit et vouloir le réintroduire pour rééquilibrer la tendance à
l’hyperindividualisation de notre fin de siècle, le choix qu’elle fait de
prendre en compte les situations de fait et de les accompagner par la
proposition d’un droit plus adapté, montre qu’en définitive c’est la volonté
individuelle du sujet qui l’emporte. « Se réapproprier cette culture (du
droit), ce n’est pas remettre en cause le privé, c’est tenter de lui redonner
la dimension qu’il a perdue, et faire qu’au sein même de sa vie privée, chacun
de nous demeure un sujet de droit, et l’autre un alter ego »(40).
I. Théry semble plus nuancée que F. de Singly dans sa proposition de mettre du
droit dans la vie privée au niveau de la conjugalité là où de Singly ne voulait
que liberté individuelle. Cependant, ses propositions sont plus fortes dans le
sens où elle est d’accord pour donner la force du droit à une multitude de
formes de vie privée au seul motif de la situation de fait. L’adoption de la
loi sur le Pacs, qui ne reprend pas toutes ses propositions, montre qu’en
définitive, c’est sa pensée qui a eu le plus de fécondité chez le législateur.
« Le débat moral n’est jamais véritablement absent des discussions
scientifiques ».
c. Martine Ségalen
Des quatre auteurs présentés par Jean-Hugues Déchaux, Martine Segalen est celle
qui intègre le plus dans sa sociologie de la famille le sens de l’histoire longue. Elle
a co-dirigé avec André Burguière, Christiane Klapish-Zuber et Françoise
Zonabend une histoire de la famille (41) en trois tomes
dont nous nous sommes inspirés pour la dimension historique de notre travail.
Elle a récemment publié dans la collection 128 chez Nathan « Rites et rituels
contemporains » qui contient un chapitre sur le mariage et à propos duquel nous
aurons l’occasion de revenir. L’ouvrage qui fait l’objet de la recension «
sociologie de la famille » (1993) a depuis été réédité en 1996 mais sans
remaniements fondamentaux. C’est de cette dernière version dont nous tirerons
les références. L’effort de M. Segalen d’inscrire la sociologie de la famille
dans le grand mouvement de l’histoire lui permet de ne pas se laisser emporter
par des événements récents. «
L’expérience historique révèle la formidable puissance de résistance et
d’adaptation d’une institution : peu d’entre elles ont ainsi su traverser les
changements économiques et sociaux fondamentaux qui ont fait passer des
sociétés fondées sur une économie paysanne à des sociétés fondées sur une
société industrielle et postindustrielle. Bref la sociologie contemporaine de
la famille ne peut se bâtir sans intégrer une perspective historique. »(42) L’ethnologie, quant à elle, permet de montrer la
multiplicité des modèles familiaux selon les sociétés. Ce qui l’amène à
regarder la famille contemporaine à l’intérieur de cette multiplicité : «
L’organisation familiale contemporaine n’est ainsi qu’un des arrangements
possibles dans l’univers des cultures »(43). Martine Segalen
fait donc l’effort d’une sociologie non cloisonnée sur sa propre méthode mais
en dialogue profond avec d’autres sciences humaines que sont l’histoire,
l’ethnologie, mais encore l’économie, le droit, … Les nombreuses études dans
les divers domaines évoqués montrent que l’on ne peut proposer des théories
monocausales pour rendre compte de l’évolution de l’institution familiale.
C’est donc un principe sociologique fort pour Martine Segalen que l’affirmation
« qu’il "n’existe de théories scientifiques du changement social que
partielles et locales". Cela ne doit cependant pas pour autant faire
renoncer à l’usage des modèles, instruments indispensables de la connaissance,
à condition d’être conscient du fait "qu’ils sont toujours débordés par la
réalité"(44) , comme l’écrit
Raymond Boudon. »(45) Bref, il n’y a
de sociologie de la famille que prudente et modeste.
Une telle approche qui se place résolument du côté de la parenté et de la
pluridisciplinarité montre en fait que l’auteur se place résolument du côté du
maintien de l’institution de la famille mais dans des formes variables. « Il y
a dix ans, on parlait encore de "crise" de la famille ; aujourd’hui
il n’est plus question que de retrouvailles avec une institution méconnaissable
et rajeunie »(46). Loin donc d’admettre une
désinstitutionnalisation, Martine Segalen préfère reconnaître qu’il existe des
formes nombreuses de la parenté et que celle qui émerge dans notre société
contemporaine existe peut-être de manière préfigurée dans des sociétés
différentes ou anciennes (47). Claude
Lévi-Strauss, dans la préface du tome 1 à l’histoire de la famille que
co-dirige M. Segalen, pose la question de savoir s’il existe « un modèle de
famille dont on puisse dire qu’il constitue la base commune de toutes les
sociétés humaines ou le terme de famille n’est-il qu’une étiquette commode pour
désigner des formations plus ou moins hétérogènes ? »(48) Forcé de reconnaître qu’il est impossible de trouver
un modèle universel de la famille, Claude Lévi-Strauss opte pour la seconde
solution : « Il se pourrait (…) que dans sa puissance inventive, l’esprit humain
eût très tôt conçu et étalé su la table presque toutes les modalités de
l’institution familiale. Ce que nous prenons pour une évolution ne serait alors
qu’une suite de choix parmi ces possibles, résultant de mouvements en sens
divers dans les limites d’un réseau déjà tracé. »(49) Dans ce
contexte, il est clair que le concept d’institution à propos de la famille est
loin d’être réductible à son seul aspect juridique mais sert à manifester qu’il
existe, de manière universelle cette fois-ci, un cadre socialement repérable
qui organise la sexualité des relations hommes - femmes.
Nous devons en tout cas à Martine Segalen cette prudence scientifique et cette
idée de regarder dans l’histoire pour voir si ce qui se vit aujourd’hui dans
l’institution familiale en France (naissances nombreuses hors mariage,
concubinage lié à la pauvreté ou à une législation contraignante) n’était pas
attesté en d’autres lieux, à d’autres époques. Et, comme nous l’avons montré,
c’est bien le cas.
d. Jean-Claude Kaufmann
Jean-Claude Kaufmann est le dernier des quatre auteurs étudiés par Jean-Hugues
Déchaux. Si Martine Segalen montre que l’institution familiale fait mieux que
de la résistance en cette fin de siècle à travers des analyses qui prennent en
compte l’ethnologie et l’histoire et en réintégrant le conjugal dans la
parenté, il semble bien que J. Cl.
Kaufmann en ne portant son intérêt que sur le couple contemporain admette aussi
que s’il existe un discours anti-institutionnel, en fait, l’institution
familiale se repère dans la pratique de la conjugalité en particulier au niveau
du propre et du rangé. Dans ce contexte aussi, il faut se garder de
comprendre le concept d’institution dans un sens juridique. Pour le dire avec
Jean-Hugues Déchaux, J.-Cl. Kaufmann « montre que des logiques sociales sont à
l’œuvre derrière la "légèreté conjugale" qui caractérise la vie des
jeunes couples et explique comment, au fil du temps, s’engendrent ou réapparaissent
des rôles sociaux et des normes relationnelles, alors qu’aucune référence ne
s’impose d’elle-même par son autorité morale, sa légitimité »(50) . C’est tout
l’objet de son ouvrage La trame conjugale.
(51)
La difficulté essentielle pour le lecteur est de garder une distance par
rapport à l’analyse de l’enquête qui s’est fait à l’aide d’entretiens.
Reproduisant nombre de dialogues, il faut savoir y repérer les concepts
utilisés par Kaufmann.
Une des thèses centrales de l’ouvrage
consiste dans le repérage d’un décalage entre le discours égalitaire des deux
membres du couple à propos de la répartition des tâches ménagères et leur
répartition effective après quelques mois ou quelques années de vie commune.
C’est dans le chapitre IV, Couple et individu, dont est extrait la citation
suivante que J.-Cl. Kaufmann rend compte le plus explicitement de ce décalage.
« Certains jeunes l’utilisent (la disponibilité) pourtant avec sincérité, comme
instrument pour atteindre l’égalité. Sans comprendre, là encore, la logique
cachée de reconstruction des rôles sexuels. "On a fonctionné à partir de
la disponibilité de chacun", déclare Michel Chouchern, (…). Carine
confirme : elle avait "plus de temps" et a donc pris en charge
davantage de travaux, malgré leur référence à une norme égalitaire. »(52) Kaufmann essaye
de rendre compte de ce décalage entre discours et pratique par le concept « d’injonction ». L’injonction est ici une force
intérieure qui pousse la personne (souvent la femme) à mettre en œuvre des
habitudes incorporées (par l’éducation, les images sociales,…) non seulement
dans la gestion du propre et du rangé mais aussi dans la répartition des
tâches. Il faut noter enfin que plus l’injonction est inconsciente et plus elle
est forte « L’injonction la plus fortement structurante des pratiques est
silencieuse et invisible »(53).
Kaufmann montre bien qu’en définitive, ce sont ces habitudes incorporées qui
reprennent le dessus la plupart du temps malgré une volonté affichée d’une
répartition égalitaire des tâches ménagères. Et si l’inégalité survient, alors
on trouvera des discours pour la justifier comme la disponibilité citée plus
haut. Il faut noter que J.-Cl. Kaufmann est très sensible au concept
d’habitude. Il n’hésite pas à le décliner sous de multiples formes tout au long
de l’ouvrage : culture sédimentée (43), habitudes constituées, héritage
sédimenté (53), héritage caché (53), sédimentations d’habitudes comme processus
d’accumulation linéaire (85)… Le concept de sédimentation, (inspiré par Schütz
?) (54), laisse entendre
qu’il y a des couches de pratiques habituelles qui sont plus anciennes que
d’autres et par conséquent plus difficilement remaniables que d’autres. Il est
bien connu que parmi les petits conflits du début d’une vie conjugale on
retrouve des questions ayant trait à la place du beurre (au réfrigérateur ou au
placard), la manière de ranger ses affaires de toilettes autour du lavabo
(dentifrice, …) et bien d’autres petits détails que l’on a incorporés depuis
toujours. La difficulté des négociations sur ces détails est proportionnée à la
profondeur et à l’ancienneté de leur incorporation. Plus ils sont profonds et
plus ils sont silencieux, et plus ils s’apparentent à des évidences.
Dans un article (55) postérieur à la
publication de la trame conjugale, Kaufmann fait l’effort d’une synthèse plus
théorique. « L’auteur, dit le résumé, analyse comment l’évolution des trente
dernières années est caractérisée par l’affaiblissement d’une définition
identitaire par les rôles, progressivement relayée par un mécanisme plus
implicite : la réactivation et la
négociation des habitudes incorporées » (303). En trente ans, on serait
passé du dit au non-dit, de l’explicite à l’implicite, du rôle conscient à
l’habitude incorporée inconsciente. L’article porte sur cette distance qui
existe entre le rôle, le statut actuel que l’on met effectivement en œuvre et
la justification que l’on en donne, l’identité que l’on croit avoir. Parfois
ils sont ajustés l’un à l’autre, mais pas toujours.
Ce travail s’inspire directement des études théoriques faites à l’occasion de
la trame conjugale. Elles sont ressaisies ici de manière plus universitaire. La
sociologie connaît bien les difficultés de vocabulaire entre statut et rôle ou
encore entre statut latent et statut actuel et Kaufmann ne les ignore pas.
Notre auteur montre avec pertinence, semble-t-il, que « l’identité (…) se forge
essentiellement par une prise successive de rôles » qui s’exercent plus ou
moins en contradiction avec les habitudes incorporées par le sujet (liées à
l’image de la mère quand ces habitudes portent sur le propre et le rangé) et
dans une négociation explicite ou sourde avec le conjoint, avec des
justifications théoriques qui ne sonnent pas toujours justes (disponibilité, ça
s’est fait comme ça, …).
Cela montre deux choses fondamentales : d’une part que le discours tenu pour
justifier de rôles effectifs n’est pas nécessairement à prendre au comptant ;
d’autre part si au départ les membres d’un couple sont prêts à adopter des
rôles très éloignés du schéma incorporé, il arrive souvent que ce soit le
profond qui finit par l’emporter ou dont on regrette qu’il ne puisse être
actualisé.
Nous avons donc là un modèle d’analyse des
discours de chaque sujet à propos de son identité lorsque cette identité se
construit et se pose aussi en présence d’un autre avec qui l’on vit au
quotidien. Ce modèle nous a paru particulièrement intéressant pour une analyse
de notre société à l’égard du statut matrimonial. Finalement, ce que la société
ou plutôt, ceux qui parlent dans la société, et parfois un peu trop facilement,
en son nom, ont-ils des discours ajustés à ce qui se vit réellement ? Ce qui se
vit est-il vraiment de l’ordre du choix d’un autre mode de vie ou habité du
regret de ne pouvoir ajuster la pratique de la conjugalité à une habitude
incorporée ? Pour être explicite, le concubinage est-il un refus du mariage ou
bien un espace intermédiaire entre le célibat et le mariage ? Pour reprendre
une expression de Martine Segalen, l’institution du mariage ne ferait-elle pas
preuve une fois encore d’une formidable capacité d’adaptation à des conditions
de précarité ?
LES
MUTATIONS DU MODELE FAMILIAL ;
-L’ethnologie remet en questions
l’universalité de notre modèle familial.
-La psychanalyse révolutionne la
compréhension de la sexualité et modifie la vie familiale et l’institution du
mariage.
-Une société industrielle et urbaine, loin
des ruralités, entraînent à leur tour un changement de perspectives.
1.
Du parental au
conjugal.
-Rétrécissement de la famille au couple
avec enfants (famille nucléaire).Jadis, des « lignées » qui se
transmettaient les héritages globaux. Une famille fondée sur le passé. Du lien
de sang au lien d’amour. De la maison familiale à l’appartement d’un avenir
souhaité.
-Evolution historique : au XIX°
siècle, DE BONALD exalte la famille d’ancien régime, fondée sur la terre. Pour
lui, l’état de choses « naturel » débouche sur une famille
patriarcale, se distinguant de « l’état natif » primitif. Il s’agit
d’une sorte de perfection sociale voulue par Dieu et qu’atteint peu-à-peu une
organisation chrétienne de la vie économique et politique. Ici, la Nation
apparaît comme une grande famille hiérarchisée dont le roi est le père. Le Chef
de l’Etat, le père de famille et toutes les hiérarchies intermédiaires,
répercutent l’image du Père céleste.
Dans
le monde bourgeois, ce modèle perdure : le patriarche gère les capitaux et
les alliances matrimoniales. La famille bourgeoise canalise la sexualité qui
libérée, menacerait dangereusement l’ordre public. (Avant son mariage, le fils
va au bordel et la fille est déniaisée par un ami de la famille).
Mais
le bourgeois conservateur, qui défend le droit d’aînesse dans un univers
« terrien » et mise sur les familles nombreuses, source de richesses,
se distingue du bourgeois libéral qui préférera la stratégie de l’enfant unique
pour ne pas morceler son patrimoine.
La
femme apparaît alors comme la gardienne du foyer, dans une fonction plus
domestique que sociale. Elle ne travaille pas, à la différence de l’ouvrière
d’usine.
Monde
contemporain : le monde du travail déborde sur l’univers familial qui
n’est plus une unité économique de production, mais de plus en plus de
consommation globale.
Ville
généralisée produisant des collectivités globales : des métropoles
mondialisées, donc déterritorialisées et « connectées » : ces
nouvelles connections mondialisées estompent les relations de voisinage, donc
aussi les relations familiales. Informatique et transmission du savoir :
parents hyperactifs et vieux qu’on entend plus fragmentent la famille
traditionnelle. La famille devant la télé est-elle encore une famille ? Un
ordinateur « familial » ou un medium technique à usages
segmentés ?
La
femme n’est plus dépendante de son état de « nature » : les
maternités ne sont plus subies, mais elles gagnent en liberté ce qu’elles
perdent en symbolique (fait-on des enfants dans le même ordre symbolique ?
TESTART : la génération comme « rencontre d’un projet parental et
d’une équipe médicale »). La féminité du féminisme a remplacé la maternité
du maternel !
L’homme
« mobile », hors-sol, délocalisé, jugé sur ses seules valeurs et
performances individuelles, peut-il encore « faire souche » dans un
univers atomisé ?
2.
Nouveaux foyers et
nouvelles relations sociales.
-On est passé du parental au conjugal,
d’une institution à une relation interpersonnelle.
-On passe des solidarités de lignage
(parenté large) à la nécessaire séparation d’avec les parents.
-Du mariage comme institution collective à
l’autonomie d’un couple et à la valorisation de l’intimité.
-Une famille ouverte où les choix
remplacent le destin genré.
-Solitude et névrose de la « femme au
foyer ». Sans les enfants assez vite, le couple doit se créer son propre
réseau affectif et social.
-Distinguer en plus les couples à rôles
sociaux homogènes et hétérogènes, ces derniers débouchant sur des réseaux de
relations différents.
-Désormais, la relations des sexes,
d’abord à l’intérieur de la vie familiale, où se répercute la vision que la
société a de la vie sexuelle, construit la personne et la colore de masculinité
et de féminité.
3.
La famille et le
champ de la sexualité.
-L’étude comparative des structures de la
parenté dans le monde démontre que la sexualité ne vise pas d’emblée la
rencontre interpersonnelle de l’homme et de la femme, mais le groupe et sa
permanence.
-La relation sexuelle et la place des
femmes dans un groupe participent d’abord d’une valeur d’échange dans
l’économie du groupe. Amour et érotisme en découlent.
-Masculinité et féminité ne sont plus des
« donnés » structurels inhérents à la famille traditionnelle. Ils
résultent de la relation des sexes dans la famille moderne.
-De ce fait, le corps sexué ne peut plus
être simplement considéré comme instrument pour la transmission de la vie et la
perpétuation du groupe ; il n’est plus un simple donné objectif au service
de l’espèce, mais à la fois l’être au monde et l’être à autrui de la personne.
-La fécondation n’est plus liée à la
construction d’un lignage de transmission, mais plutôt à l’épanouissement du
couple-roi.
-On ne fait plus d’enfants en fonctions de
considérations sociales qui interviennent par exemple pour fixer leur nombre.
On tient compte ici, de plus en plus, de l’équilibre du couple, des relations
frères-sœurs,etc.
-L’accouchement ne relève plus de la
mythologie « naturelle » : il devient un acte socialisé, de plus
en plus médicalisé, avec présence du père…
CONCLUSION :
-La famille, de plus en plus élargie,
recomposée, monoparentale, suit l’histoire des mutations de l’individu et de
ses désirs privés. Ce n’est plus vraiment une cellule sociale. Plutôt une
nébuleuse inter-affective globale, de plus en plus interconnectée, et moins à
l’intérieur qu’à l’extérieur. D’où le recul du patriarche, voire du Père ( cf
le « Mariage pour tous » et le « Parent 1 et 2 »), sa
féminisation face à la masculinisation de la femme que certains considèrent
désormais comme surpuissante (Zemmour). Inversion du paradigme de
l’autorité : des parents vers les enfants, on passe à
« l’enfant-roi » d’ALDO NAOURI.
NOTA: les structures familiales connaîtront dans l'avenir, avec les nouvelles techniques de gestation, une révolution radicale dont la controverse sur le "mariage pour tous" s'est faite l'écho. Ci-après quelques textes qui illustrent ce débat.
Jacques Testart :
« Demain, il n’y aura plus de limite au tri génétique »
Tests
génétiques, sélection des embryons, multiplication des fécondations in
vitro : jusqu’où ira la médicalisation de la procréation ? Avec la
sélection des profils génétiques, « nous finirons par orienter l’espèce
humaine en fonction d’impératifs économiques », prévient Jacques
Testart, biologiste et « père » du premier bébé éprouvette. Dans son
ouvrage Faire des enfants demain, le chercheur alerte sur les risques
d’eugénisme qu’amènent ces démarches. Entretien.
Basta ! : Dans votre ouvrage, vous
dénoncez le recours immodéré à la fécondation in vitro (FIV). Pourquoi une
telle inflation de l’utilisation de cette technique ?
Jacques
Testart [1] : Une grande partie de ces FIV est
justifiée : de plus en plus de gens ont du mal à faire des bébés tout
seuls. La qualité du sperme ne cesse de baisser ces dernières années, en partie
en raison de causes environnementales. On ne peut pas évaluer la qualité des
ovules aussi facilement que celle du sperme, mais elle a sans doute aussi subi
des incidences – l’âge moyen des femmes à la procréation augmente ce qui
explique également des difficultés. Mais au moins un quart des FIV sont
effectuées pour raison idiopathique, c’est-à-dire sans cause apparente de
stérilité. Il s’agit donc d’un abus assez clair. Si on attendait trois ans,
beaucoup de ces gens auraient probablement pu faire un enfant tous seuls. Il
s’agit d’une question de rentabilité – il faut amortir les coûts des Centres
d’Assistance médicale à la procréation (AMP) – mais aussi d’une question
sociétale (impatience des parents, attitude « consommatrice »,…)
On
médicalise de plus en plus la procréation, mais les actions sur les questions
environnementales susceptibles de provoquer ces problèmes se fait attendre. La
stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens a six mois de retard par
exemple…
On commence
quand même à reconnaître les liens entre l’environnement et la santé. Une enquête de l’Institut national de veille
sanitaire et de l’Inserm l’a encore prouvé récemment. Dans les régions où il y
a beaucoup de pesticides, la chute de qualité du sperme est plus importante. Le
problème est qu’on parle uniquement de réduire l’emploi des pesticides et des
perturbateurs endocriniens, alors qu’il faudrait carrément les interdire !
Le risque est tellement important qu’il faudrait aussi faire des recherches
pour inhiber les effets des perturbateurs endocriniens. D’autant que même si
des mesures sont prises (le bisphénol A va être interdit à partir de janvier
2015, ndlr), il faudra des générations avant qu’elles ne soient effectives pour
la santé publique, ces substances persistant dans l’environnement et agissant à
de très faibles doses ! Or, là dessus, il n’y a rien. C’est assez
dramatique.
Vous vous
opposez depuis trente ans au diagnostic pré-implantatoire (DPI), qui permet
d’identifier certaines caractéristiques de l’embryon avant sa transplantation
dans l’utérus. Cette technique aboutirait selon vous à un risque d’eugénisme
« mou ». C’est-à-dire ?
L’eugénisme
est une « pulsion » historique pour améliorer la qualité des enfants
de l’espèce humaine. Quand je parle du diagnostic pré-implantatoire comme
vecteur d’eugénisme, je ne parle pas d’un eugénisme imposé par l’État et
violent, comme il a pu l’être au début du XXème siècle aux États-Unis ou en
Allemagne. Mais d’un eugénisme souhaité par les gens eux-mêmes, afin d’avoir
une certaine garantie de la « qualité » du bébé. Certes, il y a déjà
eu des tentations eugéniques auparavant. Et actuellement existe l’interruption
médicale de grossesse (IMG), qui vise à interrompre une grossesse en cas de
handicap du fœtus par exemple. Mais dans l’IMG, il y a le garde fou de la
souffrance de l’avortement. Alors que le tri embryonnaire est une
révolution : c’est la première fois qu’on peut choisir l’enfant de façon
indolore par sélection au sein d’une population d’embryons ! On choisira
juste de transférer un embryon « sain » dans l’utérus de la femme
plutôt que les autres.
On ne peut
plus nier son potentiel eugénique avec l’élimination d’embryons porteurs de
handicaps aussi légers que le strabisme, en Angleterre. Ou de probabilités
pathologiques plutôt que de certitudes, en France [2]. Aux États-Unis, certaines cliniques proposent même
de sélectionner le sexe et la couleur des yeux des bébés ! Dans les années
80, quand j’annonçais cette perspective de bébé sur mesure, les gens étaient
horrifiés. Maintenant quand je le dénonce, je me fais engueuler.
Le
diagnostic pré-implantatoire n’est autorisé en France que chez les familles à
risque, pour dépister une seule maladie d’une particulière gravité. Cela limite
tout de même les abus.
Au début on
évitera la naissance d’enfants atteints de graves handicaps, comme la myopathie
ou la mucoviscidose. Mais à partir du moment où l’on disposera d’ovules en
grande quantité, et qu’on évitera aussi la pénibilité de la fécondation in
vitro, le diagnostic pré-implantatoire intéressera davantage de monde !
L’État finira par proposer un screening (dépistage) à tout le monde,
comme pour la trisomie 21 (l’État a d’ailleurs choisi de concentrer ses efforts
financiers sur le test de dépistage de la trisomie plutôt que sur la recherche
concernant la maladie, ndlr). Car c’est plus intéressant économiquement de
financer le dépistage de personnes « à risque » que de payer des
frais de santé durant toute une vie. Mais ce screening couvrira la
plupart des maladies et même les facteurs génétiques de risque pour ces
maladies, dont nul n’est indemne.
Oui, mais le
nombre d’ovules est toujours limité chez la femme.
Les équipes
japonaises et coréennes font d’énormes progrès sur ces questions. Il apparaît
possible de transformer des cellules de peau en ovules et donc d’obtenir des
embryons innombrables parmi lesquels on pourra choisir le
« meilleur ». Il se passe actuellement dans la science des choses
incroyables. On attendra peut-être dix, vingt ou trente ans mais il faut s’y
attendre : on arrivera à une production d’ovules à grande échelle. Et
quand on aura cette production, il n’y aura plus de limite au tri génétique.
Le risque
n’est-il pas d’arriver à une situation similaire à celle du film Bienvenue à
Gattaca, où des hommes « améliorés » trustent le pouvoir ?
Oui, on va
arriver à un homme compétitif, « sur mesure », au moins à des actions
généralisées dans ce but. En sélectionnant, génération après génération,
certains profils génétiques, nous finirons par orienter l’espèce en fonction
d’impératifs économiques (efficacité, compétitivité, état de santé…). Cela se
fera sans violence et même, sauf sursaut éthique, à la demande des populations.
Quid de la
possible utilisation judiciaire et policière des données génétiques obtenues
lors d’un diagnostic pré-implantatoire ?
Il y a un
risque sécuritaire évident. Déjà, avec les morceaux d’ADN en théorie « non
informatifs » qui sont déposés au Fichier national automatisé des
empreintes génétiques (FNAEG), on peut déterminer l’origine ethnique de la personne
et certains facteurs de risque. Via le diagnostic pré-implantatoire, ou un
examen plus tardif, on aura accès à la totalité du génome. On peut innocenter
quelqu’un avec une prédisposition à la violence. Ou au contraire en faire une
preuve contre lui. Il y a déjà eu des jugements en ce sens aux États-Unis ou en Italie.
Et quelle
utilisation possible par le système de santé et les assurances ?
Le
diagnostic pré-implantatoire permet potentiellement d’avoir un tableau complet
des facteurs de risque de tout individu. Puisque le bébé parfait n’existera
jamais, on pourrait corréler toutes ces données génétiques avec nos modes de
vie et faire des préventions d’accidents ou de maladies en fonction de
probabilités, nous conseiller d’adopter un mode de vie adapté à notre génome.
Au risque de se passer d’une vraie politique sociale de santé. Je suis inquiet
par exemple du nombre de femmes qui choisissent de se faire enlever les seins
pour une simple prédisposition de risque de cancer du sein. Il y a une
confiance absolue dans le génome : à partir du moment où c’est inscrit
dans les gênes, les gens tiennent cela pour une certitude alors que ce n’est
pas le cas ! Quand aux assurances, elles rêvent de ce genre de
choses ! Elles pourraient établir des assurances à la carte, en fonction
des risques et pénaliser leurs clients s’ils ne font pas ce que les médecins préconisent [3].
N’y a t-il
pas une augmentation de la vigilance des États sur la question des tests
génétiques ? Depuis décembre dernier, la société de biotechnologie
américaine 23andMe par exemple n’a plus le droit de vendre de tests de
prédispositions aux maladies génétiques.
Certes, les
tests sont interdits aujourd’hui et de nombreux textes sont censés protéger
contre ces dérives (l’utilisation commerciale de tests génétiques est
interdites en France, ndlr). Mais je n’y crois pas trop dans la durée. S’il
n’existe pas de règle bioéthique contraignante au niveau international, rien
n’est valable [4].
Outre le
diagnostic pré-implantatoire, vous évoquez une autre possibilité
« d’améliorer » l’homme, la transgénèse, à savoir l’introduction de
gènes supplémentaires dans le génome de l’embryon. En gros, il s’agit de faire
un homme génétiquement modifié ?
Oui, c’est
un projet des transhumanistes. Leur but est d’adapter l’homme à son milieu, ou
de l’améliorer grâce à la biologie de synthèse, en introduisant de nouveaux gènes
dans le génome. Mais cela donne des résultats un peu décevants, même chez les
plantes car on ne maitrise pas réellement les perturbations induites dans
l’ADN. Sans compter qu’il y a des effets inattendus, quelquefois très graves.
Autre question, chez les plantes ou les animaux, on sait ce qu’on veut
obtenir : une augmentation de la production de lait, des meilleurs
rendements, etc.. Mais quelle capacité veut-on introduire chez l’homme ?
Ce qui est
paradoxal, c’est cette confiance accordée aux améliorations
« techniques » pour remédier à des problèmes finalement causés par la
technique (infertilité, problèmes environnementaux …). Pourquoi ?
La technique
a apporté beaucoup à l’homme. Il y a eu une véritable amélioration de la
qualité de vie. Il existe des outils techniquement fabuleux, comme le téléphone
portable par exemple. On est donc élevés dans l’idée que le progrès est par
principe une bonne chose. Alors pourquoi ne pas appliquer les progrès de la
mécanique et de l’informatique à autre chose, comme aux questions de
santé ? Mais il est plus difficile de maitriser le bricolage du vivant que
de fabriquer des objets extraordinaires !
On pourrait
assimiler cet homme amélioré aux fameuses plantes génétiquement modifiées. Les
écologistes font-ils le rapprochement ? Ont-ils pris position sur le
sujet ?
Les
écologistes de la décroissance, des Indignés, sont contre le transhumanisme et,
pour la plupart, contre le tri des embryons. Mais les membres d’Europe écologie
se positionnent pour l’Assistance médicale à la procréation pour tous et
semblent indifférents au diagnostic pré-implantatoire.
Vous prenez
parti dans votre ouvrage contre la gestation pour autrui (GPA) : vous
dites qu’il n’y a pas de droit à l’enfant. Mais vous proposez une GPA dans le
cadre d’une « aide solidaire ». N’est-ce pas un peu paradoxal ?
Je suis
absolument contre la GPA telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui. Par contre si
un homosexuel souhaitant être parent a une cousine qui accepte de porter son
enfant, c’est différent. Là-dessus, je n’ai pas de jugement. J’estime que
l’assistance médicale à la procréation doit échapper au marché et aux médecins.
En refusant la médicalisation de l’acte, on se retrouverait dans une société où
tous les géniteurs, les personnes ayant contribué à la naissance de l’enfant,
comme les mères porteuses ou les donneurs de sperme, apparaitraient dans l’état
civil de l’enfant. Il y aurait plus de transparence, évitant ainsi des
perturbations chez l’enfant. On entrerait dans un autre type de relations,
c’est ce que j’appelle l’aide conviviale à la procréation.
Et les
risques de dérive mercantile ? Les dons d’ovule en France sont
officiellement bénévoles, mais selon un rapport de l’IGAS de février 2011, des
donneuses ont reconnu qu’elles avaient été payées par les receveuses.
C’est pour
cela que la gestation pour autrui me paraît utopique dans cette société. Si une
mère porteuse « altruiste » ne peut pas se trouver, c’est que la
société n’est pas mûre. Et si cela ne peut pas se faire, cela ne se fait pas,
c’est tout. Mais pourquoi serait-ce aux médecins de remédier à une situation
quand on peut trouver des solutions dans la société, comme pour l’insémination
d’un couple de femmes homosexuelles par exemple ? Il suffit d’une
seringue ! Mais il faut bien sûr que cela se fasse sans argent et sans
moyen de pression.
Et la place
des citoyens dans tout ça ? Comment peuvent-ils se réapproprier une place
dans le processus de décision ?
Des
conférences de citoyens, bien formés, connaissant le cœur du problème,
pourraient offrir un véritable renouveau démocratique au delà de la bioéthique
hexagonale. Au sein de Fondation Sciences citoyennes, nous militons pour cela depuis des
années.
Jean-Pierre Michel (PS) : «Je
suis pour la GPA pour tous les couples»
François
Vignal
Le
31.01.2013
Le
rapporteur du texte sur le mariage pour tous au Sénat, le socialiste
Jean-Pierre Michel, est «pour la gestation pour autrui pour tous les couples,
mais pas tout de suite». Il souhaite dissocier cette question du mariage pour
tous. Mais à terme, « ça viendra », estime le sénateur de
Haute-Saône. Entretien.
En janvier
2010, vous aviez cosigné la proposition de loi de la sénatrice PS Michèle André visant à autoriser et encadrer la
gestation pour autrui pour les couples hétérosexuels et pour raisons médicales.
Quelle est votre position aujourd’hui ?
Je suis favorable à la GPA. Je pense qu’on est en pleine hypocrisie
aujourd’hui. Les sénateurs avaient accepté le principe de la GPA dans ce groupe
de travail présidé par Michèle André. Le groupe était majoritairement à droite
et s’était prononcé pour la GPA encadré pour les couples hétérosexuels. Je suis
toujours pour. On avait fait un déplacement à Londres, où c’est autorisé. Ça se
passe très bien. Au ministère anglais de la Santé, une commission recueille les
demandes et les accepte en fonction des situations et fixe le dédommagement à
donner à la mère. On pourrait s’en inspirer. C’est un dédommagement, ce n’est
pas une rémunération. Il tient compte de la situation de la femme. Il faut
faire en sorte que tous les frais occasionnés soient payés. Quant à la
circulaire de la garde des Sceaux, elle dit juste que les enfants nés à
l’étranger par GPA ont la nationalité française.
Allez vous
présenter un amendement sur la GPA lors de l’examen du projet de loi sur le
mariage entre couples de même sexe au Sénat, dont vous êtes le rapporteur ?
Non. Je ne suis pas favorable à ce que ce soit dans le texte sur le mariage
pour tous. En tant que rapporteur du texte au Sénat, je ferai repousser tous
les amendements sur la GPA, comme ceux sur la PMA. La GPA pose des problèmes de
bioéthique. Mais à terme, il faudra l’envisager et faire cesser l’hypocrisie.
Elle est pratiquée à l’étranger et ça coûte cher. Elle est pratiquée en France
aussi, mais de manière clandestine. Il y a même des mères qui portent l’enfant
pour leur fille.
Etes-vous
favorable à la GPA aussi pour les couples homosexuels ?
Bien sûr, je suis pour la GPA pour tous les couples, mais pas tout de suite. Je
suis pour au nom de l’égalité. Pour l’instant, la société n’est peut-être pas
d’accord, on peut attendre. Mais si on permet la PMA pour les couples de
femmes, que fait-on pour les couples d’hommes ? Ils pourraient avoir
recours à la GPA. Mais je suis conscient que pour l’instant, il faut discuter.
Le
gouvernement a clairement dit qu’il était contre toute légalisation de la GPA…
Oui, il est contre, il est contre… Mais contre pourquoi ? L’argument
donné, c’est la marchandisation du corps des femmes. Il ne tient pas.
Malheureusement, le corps des femmes se retrouve marchandé dans d’autres cas, y
compris la publicité.
Votre
position sur la GPA ne va-t-elle pas dans le sens des arguments de certains
parlementaires UMP qui affirment que la gauche compte autoriser à terme la
GPA ?
Mais ces arguments sont nuls. On a entendu les mêmes, au moment du Pacs, dont
j’étais rapporteur à l’Assemblée nationale. Lors des débats, ils disaient
qu’après le Pacs, ce serait l’adoption pour les couples de pacsés. Or après que
le Pacs ait été voté, tout le monde a dit que c’était très bien. Demain, ce
sera la même chose avec le mariage pour tous. Ils sont toujours en retard
d’un TGV.
Mais
pensez-vous que la GPA sera autorisée un jour en France ?
Mais pourquoi pas. Elle peut venir après. Je ne dis pas dans 6 mois, ni un an.
Mais ça viendra. Le mariage pour tous, cela fait plus de 10 ans qu’on en parle.
Regrettez-vous
que le gouvernement s’oppose à la GPA ?
Je ne le regrette pas. Comme sur le Pacs, le gouvernement doit avancer pas à
pas. Cette question cause des oppositions. Il faut ouvrir un débat, faire
évoluer la société petit à petit, au fur et à mesure qu’évolue la science. On
peut ouvrir un débat sur les nouveaux modes de filiation.
Pourquoi nous sommes contre la
Gestation pour Autrui ! (GPA)
Les
campagnes en faveur de la légalisation de la Gestation pour Autrui, sont de
plus en plus insistantes. En juillet dernier, une agence américaine est venue à
Paris proposer des bébés clef en main (choix des donneuses d’ovocytes sur
catalogue, sélection des mères porteuses sur leur performances...). Exprimer un
point de vue fort, résolument contre la GPA nous a semblé nécessaire dans ce
contexte. Le Planning Familial, la Cadac, la Coordination Lesbienne en France
partagent une position commune sur le sujet et communiquent ensemble pour mieux
clarifier les enjeux de la GPA et argumenter contre sa légalisation. Il en est
résulté un texte intitulé « Pourquoi nous sommes contre la Gestation pour
Autrui ! » que nous vous communiquons ci-dessous et en pièce jointe.
Diffuser cette position dans vos réseaux serait une
manière concrète de vous associer à cette campagne contre la légalisation de la
GPA.
Aujourd’hui qu’en est-il de la GPA ?
Notre
législation qui s’oppose à la commercialisation du corps humain et qui stipule,
sans discussion possible, que "la mère est celle qui accouche" fait
barrage au recours à la gestation pour autrui (GPA). Les tenants de la GPA
s’emploient donc à faire sauter ces 2 verrous en relançant le débat en sa
faveur à chaque révision de la loi de bioéthique. Des associations LGBT
(Lesbiennes, gays, bisexuelles et trans) s’y associent, défendant la GPA comme
l’une des réponses à leur demande homoparentale.
Le public,
lui, est partagé entre un sentiment de révolte face à ce qui lui semble choquant
au plan humain, une tentation compassionnelle vis-à-vis de la dramatisation de
l’infertilité et de l’incapacité biologique des hommes à porter un enfant et
enfin une sorte d’oblitération critique devant ce qu’on présente, à tort, comme
une avancée des méthodes de procréation médicalement assistée (PMA).
La GPA est
revendiquée au plan thérapeutique comme palliatif de l’infertilité (sont
évoqués les cas de femmes nées sans utérus fonctionnel) mais aussi, de plus en
plus, comme demande sociale. Ainsi, le bébé "clef en main" répondrait
à une demande homoparentale "gay". II constituerait une alternative
aux procédures d’adoption parfois longues et aléatoires. Enfin, il pourrait
satisfaire l’exigence de confort de certaines femmes en épargnant leur carrière
et leur physique.
Une régression sociale constatée
Le revers de
cette demande est une régression sociale féroce, observée partout où la
libéralisation de la GPA s’est instaurée. Une véritable industrie de
"location de ventres" et de commerce d’ovocytes se développe ainsi en
Inde, en Ukraine et aux USA où des agences proposent une prestation aboutissant
à la livraison d’un produit , "un bébé", avec choix sur catalogue des
donneuses d’ovocyte en fonction de leur physique, sélection des gestatrices sur
leurs performances et procédure juridique organisant la filiation.
Tout y
repose sur un dispositif contractuel d’essence libérale qui spécifie les
obligations et droits des deux parties : les critères de sélection de la
gestatrice, ses obligations tout au long de sa grossesse, les dédommagements
financiers, les conséquences de retrait du contrat avant terme… Il est
symptomatique d’apprendre que les gestatrices sont, en Inde et en Ukraine, des
jeunes femmes pauvres tandis qu’aux USA elles se recrutent parmi les mères au
foyer, c’est à dire parmi les femmes sans revenus propres !
Face à ces
pratiques perçues comme "choquantes" s’est développée une demande
d’encadrement, dite éthique, de la GPA où les conditions d’accès pour les
demandeurs/euses et de participation pour les gestatrices seraient fixées, non
plus par contrat, mais par la loi. Mais, pour nous, cette démarche
"réglementariste" ne saurait faire disparaître l’iniquité
fondamentale de la pratique. Il ne faut pas oublier non plus que toute démarche
législative d’ouverture de la GPA rendrait de facto cette pratique acceptable
socialement.
Une vision de la société que nous ne pouvons partager
Derrière les
arguments en faveur de la GPA se profile une vision de la société que, nous
féministes et lesbiennes féministes, ne pouvons partager :
l’épanouissement de l’individuE passerait par la mise en œuvre irrépressible
d’un projet parental organisé autour de la sublimation du lien génétique. La
société devrait s’employer par tout moyen, y compris en légiférant, à satisfaire
cette demande, même au prix de l’instrumentalisation d’une partie de nos
sociétés, les femmes et de la marchandisation de leur utérus et ovocytes sans
égard pour les principes d’égalité et d’équité. Pour y parvenir, on s’appuie
sur les ressorts classiques de l’aliénation et de la domination : la
glorification de vertus présentées comme "spécifiquement féminines"
telles la générosité, l’altruisme, le don de soi, le bonheur et le rayonnement
de l’état de grossesse, figeant ainsi les femmes dans ce rôle traditionnel
auquel on voudrait les soumettre. Qu’on arrête de jouer les vieux couplets de
l’ère patriarcale. !
L’histoire,
elle aussi, est convoquée pour tenter de prouver l’enracinement de cette
pratique dans notre culture. A l’appui, des cas de dons d’enfant mais qui
relèvent à l’analyse, soit de situations de subordination (Sarah et sa servante
Agar dans la bible), soit de partage d’autorité parentale (confier un enfant à
un couple infertile ou soulager une famille trop nombreuse en prenant en charge
l’un des enfants). Qui plus est, ces exemples viennent d’époques où la
justification sociale de l’existence des femmes passait par leur capacité de
procréation, l’une des impositions du système patriarcal.
Un détournement des luttes féministes
Argument de
choc, les gestatrices et fournisseuses d’ovocytes sont libres, avance-t-on, de
cette liberté revendiquée par les femmes dans les années 1970. Voici un exemple
typique de récupération et de détournement des luttes unitaires féministes. En
affirmant "Notre corps nous appartient" il s’agissait alors de lever
la contrainte reproductive que la société imposait aux femmes en permettant à
toutes de pouvoir accéder à la contraception, à l’avortement gratuit et ainsi
maîtriser la maternité. Échapper à cette astreinte devenait un
"levier" pour libérer le corps des femmes, support d’oppression
sociale et patriarcale. Avec la GPA, pas de volonté de libération collective,
mais la mise en avant d’une vision strictement individuelle "chaque
mère porteuse est libre de disposer de son corps", argument utilisé pour
faire barrage à une réflexion sociale.
D’autres voies sont possibles
Loin de nous
l’idée de juger, a fortiori de condamner, les individuEs qui en tant que
gestatrices ou en tant que demandeurs/euses entrent, ou sont entréEs, dans un
processus de GPA. Nous ne nous positionnons pas en moralistes, nous ne
réfléchissons pas au niveau individuel, mais globalement au niveau de la
société toute entière. Comme d’autres, ces IndividuEs subissent la pression de
la société et le poids de la norme sociale qui imposent la parentalité dans le
cadre du couple, de la sacrosainte famille, au besoin modernisée en y incluant
le couple homosexuel. Plus que jamais cette norme est à déconstruire. Ce
qui se construit autour de la GPA est significatif de la progression de
l’idéologie néolibérale qui, comme le montre Jules Falquet dans son livre
« De gré ou de force, les femmes dans la mondialisation », fait de
plus en plus entrer les femmes dans le rôle de femmes de service. Service qui
se décline maintenant en service à la personne, service sexuel dans la
prostitution et ici service procréatif avec la GPA.
De cela nous
ne serons jamais ni les alliées, ni les complices
Pourtant, il
est envisageable, en ouvrant le champ du possible et avec une vision
progressiste de la société, d’envisager d’autres dispositifs ou de promouvoir
d’autres pistes plus centrées sur la question du bonheur de l’enfant.
 L’adoption plénière accessible à toutes et à
tous, aux homosexuels, aux lesbiennes, aux hétérosexuels …, à toute personne
qui remplit les conditions énoncées par la loi, sans exigence de fonctionnement
en couple ;
L’adoption plénière accessible à toutes et à
tous, aux homosexuels, aux lesbiennes, aux hétérosexuels …, à toute personne
qui remplit les conditions énoncées par la loi, sans exigence de fonctionnement
en couple ;
 La généralisation de l’accès à la PMA pour
les femmes ;
La généralisation de l’accès à la PMA pour
les femmes ;
 La possibilité d’une éducation collective sans
appropriation de l’enfant par le biais de l’adoption simple, de l’accès à la
coparentalité ou à la beau-parentalité.
La possibilité d’une éducation collective sans
appropriation de l’enfant par le biais de l’adoption simple, de l’accès à la
coparentalité ou à la beau-parentalité.
Octobre 2011
Coordination
Lesbienne en France (CLF)
Coordination
des Associations pour le droit à l‘Avortement et la Contraception.
Les aspects juridiques de la
gestation pour autrui en droit comparé ( SLD de Pierre-Henri BRECHAT) ;
Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis).
Nous avons comparé les aspects juridiques et éthiques de la GPA en droit
international, européen et dans trois pays de l'Union Européen.
Les dispositions juridiques relative à ce sujet ne sont pas homogènes. La
GPA n'est encadrée ni en droit international ni en droit européen. Il n'y a ni
définition, ni cadre juridique. En France cette méthode de procréation est
formellement interdite par la loi mais elle est pratiquée en clandestinité ou a
l'étranger. Cela pose de difficultés juridiques concernant le statut et la
filiation des enfants nés par gestation pour autrui a l'étranger. La Pologne ne
possède aucune loi qui pourrait réglementer ce processus. Cela implique des
abus et manquement à la protection des parties. Il faut souligner qu'en Pologne
ce sont des femmes pauvres qui veulent être mère porteuse. En France ce sont
les couples qui cherchent la gestatrice. La Grande-Bretagne a légalisée la GPA
et il n' y a pas de problèmes de filiation et de statut pour l'enfant. Il y a
sélection des gestatrices et des demandeurs, sans rémunération, mais il y a une
indemnisation pour les dépenses pendant la grossesse.
La gestation pour autrui est pratiquée dans chaque de ses pays. En France
avec la violation des réglés de droit et en clandestinité. En Pologne sans
aucune réglé, souvent avec la violation droits de l'homme. En Grande-Bretagne
la gestation pour autrui se passe dans les cliniques spécialisée avec le
respect des droit les parties.
A point de vue éthique aussi il existe des différence liées avec la
religion, la psychologie ou la moralité .
Les différences entre pays implique un ''tourisme procreatif'', la violation
des droits la gestatrice et les parents intentionnels, allant jusqu'à ''marché
d'enfant''.
En effet, on voit la diversité face à ce sujet en droit international,
européen et dans trois pays de l'Union Européen. Il faut une harmonisation
entre eux pour éviter des problèmes et des abus. Soit on interdisse la GPA,
soit on la légalise en prenant comme exemple les États-Unis où les cliniques
américaines seraient plus développées : ils ont légalisé et réglementé cette
pratique, ils protègent les enfants de conflits de filiation et permettent
d'éviter tout problème. En plus, les cliniques américaines spécialisées dans
cette méthode possèdent des professionnels qui s'occupent de tout de la
fécondation à la naissance d'un enfant. Cela permet pour les couples d'avoir l'assurance
de créer sa famille.110
(
*)
Finalement les autorités internationales, européennes et nationales
devraient réagir pour trouver une harmonisation. Dans le cas contraire, la
gestation pour autrui peut devenir un vrai problème international pouvant,
causer beaucoup plus de controverses et d'abus.






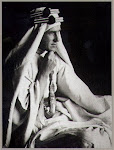
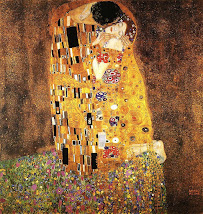


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire