Au début du XX° siècle, la France est un pays riche grâce à son activité industrielle. Mais la faiblesse de ses investissements industriels, l’insuffisance de sa concentration et le déficit de son commerce extérieur hypothèquent l’avenir. Surtout, la démographie est stagnante, le monde rural encore dominant, la classe ouvrière émergente mais complexe et de plus en plus oppositionnelle à une bourgeoisie puissante mais hétérogène. Les classes moyennes et la petite bourgeoisie se sont développés toutefois, formant la base d’une république où la démocratie reste plus politique que sociale. Reste que le prestige de son histoire, conjuguée à la puissance économique et financière, à l’étendue de l’empire colonial et au système d’alliances qu’elle domine, font de la France une grande puissance en 1914 .
I.LES BASES DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA FRANCE.
A/ UNE FORCE D’IMPACT FINANCIERE.
1-liée à un fort stock d’or qui permet, après la crise des années 1880-1896 ,de stimuler le crédit, la production et le profit et fait du franc germinal une des monnaies les plus solides du monde. L’encaisse métallique de la Banque de France s’est élevée de plus de 2 milliards en 1878 à plus de 4 milliards en 1914. A cette date, le plafond d’émission de papier monnaie est d’un peu plus de 7 milliards, soit un taux de couverture de 60% et une inflation limitée .
2-à un assez bon réseau de banques spécialisées très prospères . Les banques de dépôt comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale drainent le capital des petits épargnants et ont multiplié leurs succursales (soit 411 pour le premier et 560 pour la seconde en 1913).Reste que les taux de profit, tout en augmentant, restent inférieurs à ce qu’ils étaient à l’époque pionnière du Second Empire et des débuts de la République : pour le CL, ce taux était de 54% en 1874 ; il n’est plus que de 16,6% en 1913. expérience et assagissement succèdent aux risques et à l’aventure. Les banques d’affaires ont des taux de profit beaucoup plus élevés : 35% pour Paribas, 62% pour la Banque d’Indochine à la veille de la guerre de 1914. De nouveaux établissements apparaissent : B.F.C.I. de Rouvier en 1901,B.U.P. protestante en 1903. Ces banques recherchent avant tout les placements à l’étranger : fers argentin et chiliens, investissements industriels au Maroc ou emprunts russes après 1905 .Alliée au Groupe Schneider, la B.U.P participe à l’exploitation des mines de fer du Donetz et de l’Oural et aux grandes usines métallurgiques Poutiloff de Saint-Pétersbourg (19000 actions/32000),entrant en compétition avec l’allemand Krupp.
3-au service d’investissements extérieurs prioritaires : en 1914 ; ils représentent 45% du total des investissements. 45 milliards, soit 7% de la fortune française évaluée à 300 milliards, sont placés à l’étranger, principalement en Europe (Russie et péninsule ibérique surtout), dans l’empire ottoman, en Egypte et en Amérique latine. Notre empire colonial ne reçoit que 4 milliards, soit 11% de nos investissements extérieurs (contre 60% pour les Anglais) ;
Au total, le capitalisme bancaire va bien et Paris est la seconde place financière du monde après Londres. La fortune nationale a triplé depuis le Second Empire et le revenu national a augmenté, grâce aux revenus bancaires et industriels. Entre 1896 et 1914, la production du pays a augmenté chaque années de 1,6 à 1,8%.
B/ UNE INDUSTRIE PROSPERE ETDYNAMIQUE.
En 1910, l’industrie représente 36% du revenu national et 49% de la production globale. Pour les années 1905-1910, elle atteint un taux de croissance annuelle de 4,50%.
1-Une sectorisation plus moderne.
Part de plus faible du textile dont nous sommes toutefois le troisième exportateur mondial derrière la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Tassement de la production de houille (cf doc p 139 de Noushi) liée à la concurrence (USA, Allemagne) et insuffisance du charbon à coke. Forte poussée sidérurgique toutefois, en particulier en Lorraine dont les gisements de fer fournissent 85% de la production nationale. Entre 1896 et 1913, la France double sa production de fonte (de 2,3 à 5 millions de tonnes)et quadruple celle d’acier(de 1,2 à 4,7 millions de tonnes .Cette poussée du nord et de la Lorraine contraint le Centre (Le Creusot, Saint-Chamond) à se spécialiser dans le matériel lourd (locomotives, canons...) et les aciers spéciaux.
Dynamisme des nouvelles industries nées de la seconde Révolution industrielle : électricité qui permet la fabrication des « aciers électriques » dans les usines fondées à La Praz en 1900 et Ugine en 1908 ; aluminium (montée en puissance du groupe Péchiney) à partir de la bauxite du Var dont la France est le second producteur mondial. Avec 45 000 véhicules produits en 1913, la France est le second producteur mondial derrière les USA et ses marques-Panhard-Levassor,De Dion-Bouton et Renault (qui emploie 13000 des 35000 ouvriers travaillant dans ce secteur)sont connues dans le monde entier. Conséquence : croissance du caoutchouc (Michelin à Clermont-Ferrand).Le cinématographe, inventé par les frères Lumière en 1895,devient avec Méliès, Léon Gaumont et Charles Pathé, une industrie qui produit 90% des films projetés dans le monde. L’industrie chimique occupe 127 000 personnes en 1910 ; Saint-Gobain domine le marché avec 24 usines et 20000 ouvriers en 1914. Fabrication de la soude à partir du nouveau procédé Solvay, d’acides, d’engrais (900 000 tonnes de superphosphates en 1914). Les laboratoires pharmaceutiques se développent (Usines du Rhône à Lyon,Poulenc à Paris) mais ne sont pas au niveau des laboratoires allemands. Par ailleurs, supériorité de ces derniers dans les domaines des explosifs, des colorants et des produits de synthèse.
2-Les communications : réseau ferré achevé et réalisation du plan Freycinet. Avec 49 000 km de voies (soit plus du double du réseau en 1876), il est le plus dense d’Europe (12,6 km pour 10 000 habitants).Il réalise en 1913 2 milliards de recettes contre 1 125 000 francs de dépenses. C’est aussi une véritable industrie qui emploie 360 000 personnes et dont les actions et obligations s’élèvent à plus de 18 milliards en 1907. A partir de la Convention de 1883, l’Etat garantit les emprunts contractés par les compagnies privées pour étendre et moderniser le réseau.En revanche, la flotte française est reléguée au 5° ou 6°rang mondial (2° rang en 1870) et ne représente plus que 4% au lieu de 8 du tonnage mondial, du fait de la place encore trop grande des voiliers. Reste que la C.G.Trans.possède en 1914 une flotte de 84 navires qui participe à l’essor du Havre,second port national derrière Marseille qui, 9 100 000 tonnes de trafic, compte parmi les 20 plus grands ports mondiaux.
Toutefois, l’industrie française, qui représentait en 1869 9% de la production mondiale n’en représente plus que 6% en 1914.
C/ AGRICULTURE ET VALEURS AGRICOLES DOMINANTES.
1-Un solide niveau de production : qui assure encore 35% du revenu national et 42,3% de la production globale en 1910. Malgré la réduction des surfaces cultivées, la production de blé est de près de 100 millions de quintaux au début du siècle (3° rang mondial) tandis-que le troupeau de bovins passe de 11 à 15 millions de têtes entre 1872 et 1910, permettant l’augmentation de la consommation de viande. Après la crise du phylloxera, la production de vin connaît de fortes fluctuations autour de 40 à 50 millions d’hectolitres. Grâce à l’irrigation, les cultures maraîchères et fruitières se développent dans le Comtat-Venaissin et le Roussillon, mais c’est encore une polyculture avec élevage qui domine.De fait, les taux de croissance ne dépassent pas 1,5% par an et l’agriculture est protégée par des barrières douanières récurrentes : tarif Méline de 1892 ; loi du « Cadenas » de 1897 établissant des taxes sur les importations de céréales, de vin et viande ; loi de 1910 qui lève des taxes de 11% sur les produits agricoles (et 13 sur les produits industriels).
2-Le poids de la société rurale : 56% des Français vivent dans des localités de moins de 2000 hab et l’exode rural est faible. La grande propriété aristocratique se maintient dans l’Ouest de la France,en Sologne, dans le Berry et le Bourbonnais. Grande propriété bourgeoise de citadins qui placent leur argent dans la terre et agriculture capitaliste du bassin parisien lié aux meuneries et aux sucreries. Mais la forme dominante reste la petite et moyenne propriété de moins de 10ha (48% des exploitations),surtout au Sud de la Loire. Elle est favorisée par les radicaux qui voient en elle le modèle de la démocratie de petits propriétaires qu’ils rêvent d’instaurer. Une vie encore traditionnelle, mais l’augmentation des revenus agricoles au début du XX° siècle permet une amélioration de l’alimentation (vin et viande). Par ailleurs, le chemin de fer, le service militaire, l’école obligatoire et la presse ouvrent aux paysans des horizons nouveaux, faisant d’eux progressivement des citoyens (E.WEBER, « La fin des terroirs »).
Au total, on a pas assez investi dans l’industrie tout en surprotégeant l’agriculture, en particulier par un protectionnisme récurrent :
-tarif Méline de 1892 ;
-loi du « Cadenas » de 1897 haussant les taux sur les céréales, le vin et la viande ;
-loi de 1910 : taxe de 11% sur les produits agricoles et de 13%sur les produits industriels.
A la veille de la guerre, la France exporte moins de produits agricoles et achète trop de produits industriels (20%).La balance commerciale est déficitaire à partir de 1880. Notre commerce extérieur est au 4° rang mondial derrière celui de la GB, des USA et de l’Allemagne et ne représente que 8%du commerce mondial. Cette faiblesse est contrebalancée par les revenus invisibles, c-à-d les capitaux placés à l’étranger. La part de la France dans ces investissements à l’extérieur est de 21%,au 2° rang derrière la GB mais avec un % de 50% ! Un pays rentier raisonnablement audacieux.
II. UNE SOCIETE TRADITIONNELLE EN MUTATION LENTE .
Idées-forces :
-Stagnation démographique par baisse de la natalité : 39,6 millions d’habitants en 1914 ;
-Une France rurale (56% des Français dans des localités de moins de 2000 habitants)et un idéal de petite et moyenne propriété (48% des exploitations ont moins de 10 ha).
-Une vaste classe moyenne qui aspire à rejoindre la bourgeoisie et à se distinguer d’une classe ouvrière très différenciée qui, tout en représentant 30% de la population active,se sent de plus en plus exclue (encore 60% du budget pour la nourriture et 10 heures hebdomadaires de travail sans congé).
A/ UN PAYS VIEILLISSANT DOMINE PAR LE MONDE RURAL.
1.Un pays vieillissant.
Baisse de la natalité : 19% en 1911.Maintient d’une forte mortalité par rapport à l’Europe en particulier en ville ( 9,6% à Paris aux Champs-Elysées mais 32,4% à Belleville). Le taux de reproduction en 1911 est de 0,96 (1,02 en 1891) contre 1,48 en Allemagne et 1,23 en GB. Causes : allongement de la durée de la vie et malthusianisme lié au désir de promotion sociale de l’enfant : en 1911, 43,5% des familles ont 1 enfant ou pas du tout.
Appel aux étrangers :ils sont 1 160 000 en 1911, soit 3% de la population active ; Italiens,36% ; Belges 24% ;Espagnols, 9%, à Paris,dans le Nord, en Lorraine et dans les midis.
En 1911, les urbains pèsent presque 45% de la population, mais 16 villes seulement dépassent 100 000 habitants, soit seulement 13% de la population totale, alors que l’Allemagne et la GB en comptent une cinquantaine. Paris est hypertrophié, avec 2.880.000 habitants en 1911 et 4 154 000 habitants pour le département de la Seine.
Il ya53% d’actifs en 1911( 21 millions)dont 37% de femmes. Le secteur II totalise 6 millions d’actifs dont 34% de femmes travaillant surtout dans les textile (34%). Le secteur III ne rassemble que 23,7% d’actifs (moins qu’en GB et en Allemagne) du fait du poids de la France rurale.
2.Une société rurale dominante.
-56% de la population totale
-42% des actifs
-35% du revenu national
Prépondérance de la paysannerie moyenne mais forte disparités selon les régions. Des « déserts » comme le Massif Central, les Alpes du Sud ou la Corse ou des « pays » isolés en particulier dans le bocage breton. Mais amorce de spécialisations régionales axées vers la commercialisation :élevage laitier de Normandie et des Charentes (1° coopérative en 1893) ; croissance de la grande propriété viticole dans le Languedoc (lacrise de surproduction de 1907 a surtout touché les moyens et petits propriétaires). Mais prépondérance générale de la petite et moyenne propriété avec 48% des exploitations entre 1 et 10 ha. Fort morcellement en particulier au Sud de la Loire que la loi de 1908 sur le remembrement ne parvient guère à corriger avant 1914. d’où l’idéal républicain de démocratie paysanne égalitaire fondée sur une propriété familiale se suffisant à elle-même (radicalisme, à rapprocher des idéaux jacobins et proudhoniens).
Un individualisme agraire qui freine la lutte collective contre les effets de l’économie de marché. Les caisses régionales du Crédit Agricole sont peu développées (loi de 1899). Syndicalisme agricole (loi de 1884) : de 648 (1890) à 6667 (1914) organisations regroupées en deux fédérations : la Société des Agriculteurs de France (conservatrice) et la Société d’Encouragement de l’Agriculture de Gambetta. Mais les agrariens se soucient avant tout d’encadrer les ruraux afin qu’ils ne versent pas dans le socialisme. En général, idéal mélinien de petite propriété et de protectionnisme. Peu de goût pour l’agronomie et la formation. Une réaction globale d’antagonisme au monde urbain qui annonce le dorgérisme et certains aspects du pétainisme.
B/ LA CLASSE OUVRIERE.
1 .De fortes disparités.
30% de la population active en 1906 (avec patrons et employés)soit environ 4 millions de personnes que l’on a parfois du mal à distinguer du monde de l’artisanat (2 600 000 travailleurs isolés). A part le Nord (pop.act. :63% dans II), pas de grandes concentrations géographiques. 50% des ouvriers travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés.
-3 secteurs principaux :
-textile et confection : 1 147 000
-métallurgie : 600 000
-bâtiment : 93000.
Le taux de chômage est de 5,3% en 1913. Forte disparité des salaires (géographique, sectorielle,sexuée) mais tendance à la hausse du salaire réel (+ 4,8%) entre 1875 et 1905.
Des conditions de vie encore difficiles (62% du budget pour la nourriture) et peu de loisirs malgré le repos dominical institué en 1906. Comme les profits parallèlement augmentent de 200%, renforcement du mouvement ouvrier.
2.Le mouvement ouvrier.
Syndicalisme favorisé par la loi de 1884 mais opposition entre « politiques » et « syndicaux ». La GREVE reste le recours favori (comme à Anzin en 1884 ou à Decazeville en 1886). Les Bourses du Travail, fédérées en 1892, encouragent la mutualité, l’enseignement et la propagande. Fortement marquées par l’esprit libertaire.
Le « I° mai » s’impose comme moment unitaire et en 1895, Fédération des bourses et syndicats fusionnent pour créer la CGT, avec un courant unitaire anarcho-syndicaliste qu’incarnent Victor Griffuelhes (Secr.gl de 1901 à 1909) puis Léon Jouhaux qui lui succède.
-1906 : Chartes d’Amiens et indépendance du syndicalisme par rapport à l’Etat et aux partis, même le mouvement socialiste unifié en 1905 (SFIO).
-Vague de grèves entre 1906 et 1910 puis recul. A la différence de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne ( plus de 4 millions de syndiqués), les syndicats ne totalisent qu’1 million d’adhérents en 1914.
2 .Les acquis sociaux.
Journée de 10 h plus ou moins acquise en 1914 mais cadences infernales.
-1891 : Offices du Travail
-1898 : Responsabilité patronale en cas d’accident du travail. En cas d’incapacité, le patron doit verser une indemnité variant entre 33 et 50% du salaire. Pension à la veuve en cas de décès.
-1899 : Conseil supérieur du Travail.
-1910 : loi sur les retraites ouvrières .Retraite à 65 puis 60 ans. Caisses de retraites alimentées par des cotisations ouvrières et patronales. Mineurs, cheminots et fonctionnaires ont un régime particulier.
C/BOURGEOISIE ET CLASSES MOYENNES.
1.Sectorisation.
4 850 000 personnes dans le III, a quoi il faut ajouter 1 000 000 de patrons et d’employés du II et 560 000 rentiers. Passages assez flous des classes moyennes à la petite et moyennes bourgeoisie.
2.Le bourgeois-type : biens immobiliers et mobiliers, surtout des valeurs d’Etat et l’emprunt russe ; plutôt des valeurs françaises qu’étrangères ou coloniales et il place plus souvent son argent au Crédit Lyonnais que dans des banques locales.
Pour 1880-1890 : la fortune mobilière des français dépasse la fortune immobilière.
-Quelques grandes familles : de Wendel, Schneider, Perier, Rothschild et des nouveaux venus comme Louis Renault et Marius Berliet, plus grands capitaines d’industrie à l’américaine que grands bourgeois à la française.
-Alliance de la politique et des affaires : ex de Rouvier, Président du Conseil et fondateur de la B.F.C.I., de Joseph Caillaux et d’anciens avocats d’affaires comme Paul Doumer, Raymond Poincaré et Louis Barthou.
3. Les classes montantes.
-Les professions libérales : 73000 patrons en 1906, mais surtout la magistrature et le service de l’Etat : Conseil d’Etat, Cour des Comptes, Inspection des Finances. Sciences-Po commence de concurrencer Normale Sup’.
-Dans la classe moyenne : hausse des patrons de l’industrie et du commerce (778 000 et 713 000) au début du siècle, mais aussi des employés et des petits fonctionnaires.
Conclusion : « Un pays de petits rentiers...de fonctionnaires médiocres...de paysans peu progressistes... » (Paul Leroy-Beaulieu),une vision malthusienne qui annonce les descriptions d’Alfred Sauvy après la Seconde Guerre mondiale. Une société àla recherche de statuts, qui se professionnalise. On est dans le contexte de la pensée de DURKHEIM, dérivant de celle d’AUGUSTE COMTE, pour qui les sociétés modernes doivent se construire autour des professions et de hiérarchisations rigides à partir des formations et des grandes écoles. Mais au plan économique, ce « morcellisme industriel » freine la rationalisation du travail. Un univers de statuts rigides qui regarde plus vers l’univers corporatif d’ancien régime que vers la modernité. De fait, l’industrie est restée depuis la Révolution « sous un régime de petites entreprises disséminées,dont les efforts se neutralisent au lieu de s’additionner »(CARLIOZ, responsable de la sidérurgie pendant la Première Guerre mondiale).
A l’intérieur de cette économie en suspens, des pôles de modernité,voire des secteurs de pointe : Jérôme HERSENT qui contrôle les techniques de travail en milieu aquatique (ports) ; Simon BOUSSIRON passé maître dans la technique des voûtes minces en béton (gare de Bercy en 1910) ; Georges CLAUDE, fondateur d’Air Liquide en 1902 :produisant de l’oxygène pur dans l’usine de Boulogne-sur-Seine dès 1905, l’entreprise est présente dans 14 pays entre 1905 et 1915 et lance un secteur d’éclairage au néon en 1910.






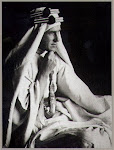
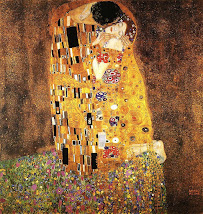


1 commentaire:
Merci pour ce post merveilleux. Admirant le temps et l'effort que vous mettez dans votre blog et des informations détaillées vous offrir.
Enregistrer un commentaire