


Tout public et spécifiquement étudiants prépa HEC et SC-Po.
LA GRANDE DEPRESSION DES ANNEES 1930
Blocage de la croissance dans un contexte de « trend » séculaire à la baisse ou surchauffe capitalistique et spéculative dans un monde privé de régulation monétaire internationale, tous ces phénomènes conjugués aboutissent à la crise de 1929, épisode boursier d’une récession économique de grande amplitude, première grande crise du capitalisme. Ses tentatives de règlement voient émerger une nouvelle théorie économique et sociale globale-le keynésianisme-dont plusieurs aspects perdureront au lendemain de la première guerre mondiale.
-Une crise qui exprime les dysfonctionnements structurels antérieurs du capitalisme.
-Une crise qui amplifie ces désordres antérieurs et enclenche des mutations, à l’origine
d’une nouvelle hiérarchie internationale (conséquences géopolitiques).
I/ANALYSE DE LA CRISE
A.LE MECANISME RECESSIONNISTE
1/ Recul de la production et de l’investissement.
Une crise dont le creux se situe en 1932 et qui passe par une chute de la production, surtout dans les industries produisant des biens de consommation, moins dans les industries d’équipement.
Analyse du tableau : distinguer les cas américain et allemand ; les cas anglais et français (niveaux de production supérieurs) ;les cas japonais et russe qui connaissent des croix de la production industrielle jusqu’en 1937.
Le marasme influe négativement sur les investissements à partir de 1932 et l’on note dans le tableau 2 des reprises à partir de 1937, ce qui illustre la durabilité de la crise.
2/ Baisse des prix et effondrement du commerce international.
Entre 1929 et 1933, les prix de gros et de détail chutent dans les PDEM : 42% et 18,6% aux USA ; 32 et 14% en GB ; 24 et 21% en Allemagne ; 38 et 12% en France. Combinée à la chute de la production, cela aboutit à une forte contraction de la valeur de la production, de 30 à 50 % selon les pays. Ainsi, le PIB des USA tombe-t-il de 104 à 56 milliards de dollars entre 1929 et 1933.
3/ Faillites et chômage.
Le chômage va dépasser selon les pays 15 voire 20% des actifs. Aux USA, de 1929 à 1932, le nombre des chômeurs passe de 1,5 à 12 millions, soit un quart des actifs. Le phénomène est général en Europe, avec un impact moindre en France et en Italie qu’en GB et en Allemagne. Il est la résultante des faillites en chaînes de part et d’autre de l’Atlantique :aux USA, on totalise près de 32 000 faillites en 1932.
B.DES RESPONSABILITES PEU CONTESTABLES.
On peut distinguer trois facteurs de déstabilisation :
1/Consommation et pouvoir d’achat.
Permanence de comportements malthusiens face à la « nouvelle consommation » et insuffisance globale des pouvoirs d’achat liée au vieillissement démographique de l’Europe occidentale, à la pauvreté relative des paysanneries et au médiocre niveau général des salaires ouvriers. Dans cette optique, le recours au crédit anticipe dangereusement sur des revenus qui n’augmentent que lentement. On est donc en présence d’une atonie générale des marchés que traduit le faible dynamisme du commerce international : entre 1913 et 1928, les échanges internationaux ne progressent que de 13% en volume alors que la production s’est accrue de 42%. Surproduction et sous-consommation dans un espace économique mondial segmenté sont donc à l’origine de la dépression.
2/Investissement et spéculation.
-Une fois la reconstruction achevée en Europe, l’investissement a surtout concerné le développement d’un outillage plus productif, répondant ainsi aux nécessités de restructuration économique engendrées par la seconde révolution industrielle et dans le cadre de grandes entreprises-phares. On a donc peu embauché, nourrissant ainsi un sous-emploi chronique. Par ailleurs, l’investissement a été dirigé en priorité vers les activités « de pointe » (électricité, aluminium, pétrole, automobile) au détriment des secteurs anciens (charbon, textile) encore importants et qui vont souffrir d’un manque de capitaux.
-A partir de 1925, l’effort d’investissement se relâche du fait de la stagnation des prix de gros qui jouent un rôle directeur dans la détermination des profits. Aussi, les bénéfices issus de taux de profit élevés (10% par an) alimentent-ils les circuits du crédit et la spéculation boursière déjà dopée par les capitaux flottants : les détenteurs étrangers de capitaux spéculent irrationnellement sur les titres de Wall Street.
3/Les responsabilités américaines
-Abus de crédit et spéculation qui s’envole dès 1928.
-Les USA,quoique I° puissance mondiale et créanciers du monde ne permettent pas à leurs partenaires de reconstituer leurs avoirs, tant par leur intransigeance dans la question des dettes que par les moyens du commerce international du fait de leur protectionnisme dès les années 1920 qui, joint au niveau élevé du dollar, enchérit d’autant plus les importations européennes. Les européens sont donc dépendants des capitaux US dont le flux se tarit à partir de 1928 du fait des profits élevés à court terme que permet la spéculation à Wall Street. L’argent étranger y est en quelque sorte aspiré, structurant le mécanisme aboutissant au krach d’octobre 1929.
C.LA CONTROVERSE THEORIQUE.
1/La vision libérale.
Elle a été relancée par la crise des années 1970. Pour les libéraux, 1929 correspond à un accident cyclique venant perturber des structures saines et la récession est imputable aux excès d’interventionnisme entraînant l’assainissement indispensable à la reprise. Les reaganiens des années 1980 condamneront le NEW DEAL mais aussi la politique tardive et timorée d’HERBERT HOOVER, en particulier le maintient des hauts salaires dans le but d’éviter la contraction de la demande.
2/La vision « structuraliste ».
Critique marxiste de la crise structurelle potentielle du capitalisme (Eugène VARGAS). Critique monétariste du système trop laxiste du gold exchange standard (Jacques RUEFF). Critique keynésienne qui situe le déséquilibre essentiel plutôt dans la distorsion entre production et répartition des biens matériels, du fait d’une sous-consommation relative. Ici, c’est le niveau d’emploi qui est déterminant, conditionné par celui de la production, donc de la demande effective. Cette dernière, pour sa part, reste tributaire du revenu national, lui-même fonction du niveau des investissements. Enfin, ceux-ci sont fonction des taux d’intérêts : s’ils sont trop élevés, il faut agir sur eux par une politique monétaire.
3/ La théorie des cycles.
(cf croquis).
Toutefois, malgré la hausse du crédit, le GES n’a pas vraiment affecté les prix à la veille de la crise ; par ailleurs c’est la crise qui a détruit le système monétaire remis sur pied entre 1922 et 1928,et non l’inverse ;enfin la croissance des années 20-29, avec des rythmes annuels de 3 ou 4% par an, ne permet pas de parler de surproduction.
En fait et surtout, la crise de 1929 a révélé un grave décalage entre les modes de production rationalisés typiques du XX° siècle et des normes de consommation et d’usage de l’argent encore marquées par l’héritage du Xix) siècle. C’est pourquoi, aux yeux de Keynes, niveau de consommation et blocage de l’investissement dans un contexte de « trend » séculaire à la baisse demeurent les facteurs d’explication principaux.
II/ LA GRANDE DEPRESSION AUX USA.
A.LE KRACH DE WALL STREET.
1/La flambée spéculative
Depuis 1926 et accrue par le recours au crédit et l’intervention d’investment trust et de brokers, elle débouche sur une hausse exagérée des valeurs boursières. Le réseau bancaire américain, hétérogène, déséquilibré (la moitié des dépôts gérés le sont dans 1% des banques) et peu contrôlé, est incapable de maîtriser un volume des prêts à la spéculation qui passe de 2,5 milliards de dollars en 1926 à 6 milliards en 1929, l’indice des valeurs boursières passant de 100 à 216.
2/La baisse des taux de profit.
Or, ni le capital ni l’activité des entreprises n’ont suivi cette hausse et les dividendes s’amenuisent par rapport à la valeur des actions ce qui pousse les initiés à vendre. Parallèlement, les taux d’intérêt augmentent et dépassent le seuil « psychologique » des 10%,ce qui sème le doute chez les opérateurs en bourse.
3/La spirale de vente et le krach.
En septembre 1929, la faillite du holding anglais HATRY, qui exploitait le brevet photomaton, accroît la méfiance des spéculateurs. La spirale des ventes est enclenchée et le 24 octobre 1929, 12 millions d’actions sont offertes à la vente, mais comme les acheteurs se dérobent, les cours s’effondrent. La banque MORGAN n’enrayera que provisoirement une chute des valeurs boursières qui se poursuivra jusqu’en 1932.
B. DE LA CRISE FINANCIERE A LA DEPRESSION ECONOMIQUE.
1/L’effondrement financier.
Les débiteurs ne peuvent plus honorer leurs traites et les banquiers et brokers qui avaient accepté des actions en échange de prêts sont acculés à la faillitte. Les taux d’intérêt s’effondrent mais le crédit ne repart pas, faute de confiance, tandis-que les capitaux étrangers refluent vers l’Europe. Cette déflation brusque enclenche la récession.
2/La crise économique.
La surproduction agricole provoque l’effondrement des cours des produits alimentaires, ruinant une paysannerie qui regroupe encore 20% des actifs. Au plan industriel, le marché s’effondre, particulièrement pour les biens d’équipement des ménages (radios, machines à laver...) jadis achetés à crédit, tandis-que les entreprises font faillitte, faute de ce même crédit. Or, les responsables de la Réserve fédérale n’ont pas osé pratiquer une injection massive d’argent frais pour provoquer une « reflation » de l’économie. Fidèles à l’orthodoxie libérale, ils ont laissé au contraire s’approfondir la dépression financière, au moins jusqu’en 1931 (HOOVER), privant les producteurs de capitaux et les consommateurs de moyens de paiement et créant ainsi les conditions du marasme durable des affaires.
3/Le décrochement de l’économie américaine.
De 1929 à 1932, le revenu national des USA s’effondre de 87 à 39 milliards de dollars et l’investissement, qui représentait 15% du PNB, tombe à 1,5%. L’internationalisation de la crise touche le commerce extérieur, d’autant plus que le tarif Hawley-Smoot de 1930 (réaction protectionniste libérale) provoque des représailles douanières qui gênent les exportations américaines, d’autant plus que le dollar reste une devise surévaluée, surtout après la dépréciation de la Livre en 1931.
B. UNE SOCIETE EN CRISE.
1/La montée du chômage.
1,5 million en 1929 (3% de la population active) et 12 millions en 1932, soit un quart des actifs, sans compter le chômage partiel assorti d’une baisse des revenus. Les agriculteurs sont ruinés, contraints de vendre leurs terres à perte pour rembourser leurs dettes. Les okies du midwest migrent vers l « eldorado » californien qui est lui-même touché par la crise (voir JOHN STEINBECK , Les raisins de la colère). Blue collars, mais aussi white collars (employés, membres des professions libérales et hommes d’affaires) n’échappent pas à la paupérisation et au déclassement.
2/Une crise de confiance existentielle.
On ne croit plus à l’avenir et natalité et nuptialité régressent brutalement. La misère génère une angoisse et un désespoir porteurs de violence. Certains s’interroge sur la légitimité même du système capitaliste libéral. De leur côté, les responsables politiques restés trop tardivement optimistes (« La prospérité est au coin de la rue » affirmait HOOVER en 1929 !), songent à des solutions adaptées à l’ampleur du désastre.
Sur cette désespérance américaine, voir les films de FRANK CAPRA , en particulier « Un homme dans la foule », « Que la vie est belle » et « Mr Smith au Sénat »,tous produits par la Warner, spécialisée dans les années 1930 dans les films politiques et sociaux. Au plan littéraire, le thème de l’errance sociale urbaine et de la crise de l’individu américain apparaît avec force dans l’oeuvre de JOHN DOS PASSOS (« Manhattan transfer », « L ‘an premier du siècle », « La grosse galette »).
III/ DE LA CRISE AMERICAINE A LA CRISE MONDIALE.
A. LA PROPAGATION DE LA CRISE ET LES ETAPES DE LA DEPRESSION.
1/Contraction des échanges et effondrement du crédit international.
Ralentissement des prêts américains à partir de 1927, affectant déjà les économies de l’Allemagne et du Japon. Après le krach de 1929, la contraction des échanges mondiaux se répercute aussi sur la GB et la France.Du fait de la baisse des prix, le commerce mondial diminue du quart en volume et de près des deux tiers en valeur entre 1929 et 1932.Cette baisse de liquidités prive la plupart des pays des ressources nécessaires au paiement de leurs importations et au remboursement de leurs dettes. L’aggravation du déficit extérieur provoque une crise de confiance et une fuite des capitaux qui menacent les monnaies.
L’effondrement du crédit international est amplifié par le retrait des capitaux américains d’Europe. En 3 ans, le volume des prêts internationaux à court terme est divisé par deux,entraînant une déflation du crédit international qui soutenait l’économie mondiale.Il en découle une crise financière en 1931 : le président Hoover suspend pour un an les paiements intergouvernementaux (juillet 1931-juin 1932).
2/Etapes et aspects de la dépression mondiale.
Plus sensibles aux influences et dépendantes des capitaux américains, les économies autrichienne et allemandes s’effondrent au printemps et à l’été de 1931 (faillite du Kredit Anstalt viennois et de la Danatbank allemande) ; le chancelier allemand Brüning décrète la fermeture des banques et isole le mark de l’extérieur.
Puis la GB,déjà touchée par les faillites bancaires en Europe et subissant une spéculation sur la Livre, abandonne le Gold Exchange en septembre 1931,ce qui atteint le système bancaire français où la devise britannique est détenue comme monnaie de réserve par la Banque de France.
En décembre,le Japon, dont le déficit commercial s’aggrave et dont les réserves en Livres se déprécient, abandonne à son tour le Gold Exchange Standart.
L’économie britannique, déjà languissante, amortit mieux la crise que l’économie allemande, déjà rationalisée dans les années 1920 ou que l’économie japonaise, très dépendante de l’extérieur (capitaux, approvisionnement en matières premières). Quant à l’économie française, moins dépendante du marché international, elle est touchée plus tardivement mais plus durablement.
En 5 ans, de 1929 à 1933, la dépression a détruit les trois piliers de l’économie mondiale : la production, le commerce international et le système monétaire international.
B/ DES POLITIQUES ANTI-CRISE PEU EFFICACES.
1.Les politiques déflationnistes.
Cas français et allemand jusqu’en 1935,conforme à l’orthodoxie libérale. Visant la protection de la monnaie,elle privilégie l’équilibre budgétaire par la réduction des dépenses publiques et la stabilisation de la balance commerciale par une compression des prix de revient favorable aux exportations, mais obtenue par la baisse des salaires, possible en période de chômage.
Mais la crise ampute les recettes de l’Etat et augmente ses charges (indemnisation du chômage) tandis-que les syndicats font obstacle à la réduction des salaires ; par ailleurs, les autres pays défendent leur position commerciale par la dévaluation monétaire et le protectionnisme. Aussi la déflation creuse-t-elle une dépression déjà liée à l’insuffisance de la monnaie et du crédit.
2.Les politiques de relance.
Elles supposent l’augmentation des dépenses de l’Etat (grands travaux, indemnisation du chômage, aide aux entreprises) donc l’acceptation du déficit budgétaire et la dévaluation monétaire pour stimuler les exportations. Préconisée par Keynes, elle sera adoptée précocement par la GB, les USA (New Deal), la France (Front Populaire) et l’Allemagne hitlérienne. Elle ne permettra qu’une reprise économique partielle. (cf cours sur l’évolution des structures économiques). Elle marquera l’évolution historique des économies des PDEM par un interventionnisme d’Etat qui perdurera après 1945.
C/UN CLOISONNEMENT DANGEREUX DE L’ECONOMIE MONDIALE.
1.Le cloisonnement de l’économie mondiale
Echec de la conférence mondiale de Londres en juin-juillet 1933 et triomphe des égoïsmes nationaux à travers la montée du protectionnisme. Alors que l’URSS ne parvient pas à rompre son isolement, deux groupes de pays s’opposent :
-Les « pays riches » (USA,GB, France) qui détiennent 80% du stock d’or mondial et contrôlent des marchés protégés comme les empires coloniaux : ce sont les « nantis » que dénonce un Mussolini.
-Les « pays pauvres » (ces « nations prolétaires » du même Mussolini), lourdement endettés, sans grandes solutions extérieures et réduits à leurs seules ressources.
2. L’émergence de zones « réservées » qui amortissent les effets de la dépression.
Les USA multiplient les accords commerciaux avec les Etats du continent américain qui ont suivi la dévaluation du dollar en 1934. La GB prend la tête d’une zone sterling qui s’aligne sur la devise britannique à partir de 1931 (Commonwealth, Etats ibériques et scandinaves). En 1932, elle établit par les accords d’Ottawa un système de préférence impériale avec son empire. De son côté, la France prend la tête d’une zone franc avec son empire tout en maintenant des contacts avec la zone sterling dont témoignent les dévaluations successives du franc à partir de 1936.
3.Les « pays pauvres » de l’autarcie à l’expansion.
Italie, Allemagne et états d’Europe centrale, subissant plus durement les effets de la crise (à quoi s’ajoutent pour ces derniers des structures économiques et sociales encore archaïques) se dotent de régimes autoritaires dont le nationalisme expansionniste est exacerbé par les difficultés économiques. Mais autarcie, dirigisme, protectionnisme et contrôle des changes ne sont pas suffisants : la lutte contre le chômage passe par la croissance des industries de guerre et la fermeture des marchés découche sur la préparation d’une guerre de conquête.
Ainsi, à partir de 1938 (Conférence de Munich en septembre ; axe Berlin-Rome dès 1936)se constitue une zone mark en Europe centrale, qui entretient des relations privilégiées avec l’Italie et le Japon, deux Etats dont l’expansion territoriale (Ethiopie en 1936 pour la première et Mandchourie en 1937 pour le second) agressive se conjugue avec les coups de force de la politique étrangère allemande depuis 1935.
CONCLUSION.
La crise de 1929 et la grande dépression révèlent les fragilités du capitalisme libéral (croissance « sauvage », spéculation, absence d’ordre économique (en particulier monétaire) international ) et débouchent sur un monde cloisonné en zones monétaires et commerciales qui deviennent bientôt des blocs rivaux engagés dans une guerre économique qui entraîne une guerre tout court avec la rechute de 1937 et la course aux armements qui la suit.
Sur le sujet, voir JACQUES NERE, "La crise de 1929" chez Colin (collection U).
Les photographies en tête de l'exposé sont extraites du livre de GILLES MORA, "Les photographes de la FSA" qui présente les photos commandées à cet organisme par la RA (Resettlement Administration) chargée de promouvoir le New Deal de Roosevelt et dont le travail évoluera vers une présentation de l'Amérique aux Américains dans une perspective documentaire et identitaire qui touche aussi la littérature (Le Dos Passos de "42° parallèfe" ou le Steinbeck des "Raisins de la colère") et la peinture d'Edward Hoper dont voici deuxexemples:










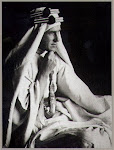
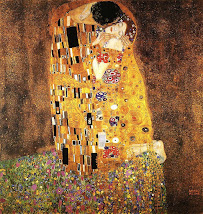


1 commentaire:
"Au lendemain de la première guerre mondiale"
De la seconde non?
Enregistrer un commentaire